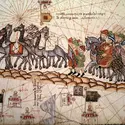LUOYANG [LO-YANG]
Article modifié le
Deuxième ville de la province chinoise du Henan (1 059 000 hab. selon les estimations de 2002), Luoyang est située sur la rive nord de la Luo à environ 60 kilomètres de son confluent avec le fleuve Jaune.
C'est au ~ xie siècle, juste après avoir imposé leur domination sur la grande plaine du Nord, que les Zhou choisissent le site pour y établir leur capitale secondaire, Chengzhou (la capitale formelle, Zongzhou, est près de l'actuelle Xi'an). Le duc de Zhou en est le premier gouverneur. Pendant la phase ascendante des Zhou occidentaux, c'est de Luoyang que sont contrôlés les territoires centraux et lancées des expéditions vers le nord, l'est et le sud ; c'est également là qu'affluent tributs et impôts, et que sont convoqués à intervalles réguliers les vassaux du roi Zhou. La localisation exacte du site de Chengzhou n'est toutefois pas absolument claire. En revanche, on a pu mettre au jour la ville de l'époque des Printemps et des Automnes, qui devient la capitale formelle des Zhou (désormais « orientaux ») à partir de ~ 770 ; mais dès cette époque les véritables centres de pouvoir sont ailleurs. Capitale secondaire au début de l'empire, Luoyang redevient capitale principale à l'avènement des Han postérieurs, en 25. Sa muraille mesure 9 li du nord au sud et 6 li d'est en ouest (1 li = 576 m environ). Elle souffre considérablement des désordres de la fin des Han, mais les Wei qui leur succèdent en 220 remontent palais et bâtiments publics. De nouveaux faubourgs sont construits par les Jin occidentaux. Les trois ateliers (shangfang) attachés au palais produisent un riche artisanat dont maints exemples ont été retrouvés dans des tombes d'époque Jin. La plupart des édifices construits à cette époque sont incendiés lors de la prise de la ville par les Xiongnu (311) : c'est pour Luoyang la fin de sa première période de grandeur.
La deuxième période débute en 493, lorsque l'empereur Xiaowendi de la dynastie tabgač des Wei du Nord vient visiter les vestiges de Luoyang et décide d'y établir sa capitale. Ce déménagement s'inscrit dans une politique de sinisation radicale, visant à terme à la conquête des dynasties rivales (200 000 soldats sont transférés à Luoyang). La reconstruction proprement dite commence en 501. Cinquante-cinq mille corvéables sont mobilisés pour ériger une muraille extérieure de 20 li sur 15 li, l'ancienne cité devenant du coup « ville intérieure ». Un réseau d'avenues se coupant à angle droit délimite 323 « blocs » enclos de murs. Ce type d'urbanisme inspirera la Chang'an des Tang. Un recensement donne cent dix mille familles, incluant un nombre notable de marchands étrangers. Le bouddhisme jouit d'une faveur extraordinaire : il y aurait eu 500 monastères en 518, et 1 367 (occupant un tiers de la superficie de la ville) à la veille de la chute des Wei du Nord ; c'est à la même époque qu'est entrepris le grand ensemble bouddhique des grottes de Longmen, à 14 kilomètres au sud de Luoyang. Cette superbe métropole est entièrement saccagée pendant les troubles qui entraînent la fragmentation de l'empire des Wei (534). Une quinzaine d'années plus tard, la vue de ces ruines inspirera à un visiteur une description nostalgique des splendeurs de la capitale déchue, le Luoyang jialanji.
La troisième grande période correspond aux dynasties des Sui et des Tang, dont Luoyang est la capitale orientale. Les Sui choisissent un nouveau site, 10 kilomètres plus à l'ouest, et conçoivent un plan entièrement nouveau. Yangdi, le second souverain Sui, en fait sa capitale de facto. La muraille, de 9 kilomètres de côté, est construite en 605-606 par des centaines de milliers de corvéables. Plusieurs milliers de familles marchandes sont contraintes de venir y résider ; Yangdi lui-même s'installe dans un palais construit dans le nord-ouest de l'enceinte. Plusieurs souverains des Tang y résideront aussi, notamment l'impératrice Wu Zetian, qui rebaptise la ville « capitale sainte » (Shendu). Située à l'articulation des plateaux du Nord-Ouest et de la Grande Plaine, Luoyang est en fait le centre économique de l'empire. Le Grand Canal (construit à la même époque que la ville des Sui) y aboutit, et les produits qui convergent de toutes les provinces y sont entreposés : on les retrouve sur les trois grands marchés de la ville, dont l'un est réservé aux marchands des « contrées occidentales ». La ville change plusieurs fois de mains pendant la rébellion d'An Lushan et de Shi Siming, au milieu du viiie siècle. En 904, Zhu Wen, l'un des gouverneurs militaires qui ont accaparé le pouvoir des Tang, oblige l'empereur Zhaozong à s'installer à Luoyang. On aurait, pour reconstruire palais et bâtiments officiels, démoli ceux de Chang'an (dont c'est l'extinction définitive en tant que métropole impériale) et transporté les matériaux à Luoyang. Zhu Wen fonde la dynastie des Liang postérieurs en 907, mais il choisit Kaifeng comme capitale. Luoyang retrouvera brièvement son statut sous le régime suivant, celui des Tang postérieurs (923-936).
Pendant le IIe millénaire, Luoyang n'est plus qu'une métropole d'importance provinciale. Sous la république populaire de Chine, la ville, qui reste un carrefour important (elle est traversée par le chemin de fer du Longhai), devient avec Zhengzhou la principale base industrielle du Henan (textile, métallurgie, constructions mécaniques, au nombre desquelles une usine de tracteurs, verrerie).
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Pierre-Étienne WILL : directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales
Classification
Média
Autres références
-
AN LUSHAN [NGAN LOU-CHAN] RÉBELLION D' (755-763)
- Écrit par Pierre-Étienne WILL
- 673 mots
An Lushan (705-757) n'est en fait que le principal héros d'un épisode central dans l'histoire de la Chine impériale. Né dans le Nord-Est d'un officier sogdien et d'une mère turque, polyglotte, propulsé au sommet de la hiérarchie militaire par ses prouesses et par un talent exceptionnel pour l'intrigue,...
-
CHINE - Les régions chinoises
- Écrit par Pierre TROLLIET
- 11 778 mots
- 3 médias
-
CHINE - Histoire jusqu'en 1949
- Écrit par Jean CHESNEAUX et Jacques GERNET
- 44 602 mots
- 50 médias
...occidentale (établie dans la vallée de la Wei) par la poussée de tribus du Nord-Ouest, s'installent de façon définitive au Henan, à l'emplacement de l'actuelle Luoyang. Aussi la période qui commence en 770 est-elle connue sous le nom d'époque des Zhou orientaux (les Zhou seront détruits par le royaume de Qin... -
CHINOISE CIVILISATION - Les arts
- Écrit par Corinne DEBAINE-FRANCFORT , Daisy LION-GOLDSCHMIDT , Michel NURIDSANY , Madeleine PAUL-DAVID , Michèle PIRAZZOLI-t'SERSTEVENS , Pierre RYCKMANS et Alain THOTE
- 54 390 mots
- 37 médias
...entreposés en 771 lors des troubles au cours desquels la royauté a quitté la région de Xi'an pour la capitale secondaire du royaume. Chengzhou (aujourd'hui Luoyang). Ce fait rend difficile l'établissement de leur chronologie. Certains vases du début des Zhou portent cependant de longues inscriptions gravées...
Voir aussi
- TANG [T'ANG] LES (618-907)
- ZHOU OCCIDENTAUX ou XI ZHOU [SI TCHEOU] dynastie chinoise (1111 av. J.-C. ou 1050-771 av. J.-C.)
- WEI, royaumes et dynasties chinois
- CHINE, histoire : des origines à la fondation de l'Empire (221 av. J.-C.)
- CHINE, histoire : l'Empire, des Qin aux Yuan (1280)
- YANGDI, empereur de Chine (604-618)
- LONGMEN, Chine