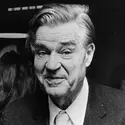MACROÉCONOMIE Croissance économique
Article modifié le
Optimalité, incitations et intervention de l'État
La croissance est le fruit de l'accumulation d'un capital multidimensionnel. Faut-il en déduire que les États dans le monde devraient chercher à augmenter le plus possible ce taux d'accumulation ? Dans les économies de marché, l'accumulation résulte de décisions privées. Ce sont les ménages qui épargnent, qui déterminent leur montant de capital humain, et les entreprises qui investissent et innovent. Pour modifier ces comportements, il faut comprendre leurs déterminants et, plus généralement, dégager les conditions d'une croissance optimale. À cet égard, le taux d'accumulation optimal n'est pas nécessairement maximal. Il ne faut pas oublier, en effet, qu'une élévation du niveau du revenu par tête n'implique pas nécessairement que les conditions de vie s'améliorent : une accumulation plus intense peut se faire au détriment de la consommation.
Et ce n'est qu'une fois définies les conditions d'une croissance optimale que doit se poser la question de savoir si les décisions décentralisées des agents privés sont suffisantes pour les atteindre ou si l'intervention de l'État est nécessaire. L'État peut alors inciter les agents à intensifier leur accumulation individuelle, si cette dernière est socialement sous-optimale. Il peut même suppléer à l'accumulation privée là où il est nécessaire de faire des investissements collectifs.
La croissance optimale
La croissance est-elle globalement synonyme de plus de bien-être ? Cette question est essentielle et pose le problème de l'optimalité de la croissance.
La règle d'or
Les économistes sont les premiers à reconnaître que la croissance du revenu par tête ne peut être une fin en soi. Si les individus devaient renoncer à consommer leur revenu afin d'épargner et ainsi accumuler du capital permettant de produire toujours plus de machines, la production augmenterait certainement, mais leurs besoins et leurs désirs ne seraient pas satisfaits. Or, parce que la croissance désigne une augmentation continue de la quantité et de la qualité des biens et des services, elle peut conduire à satisfaire plus de besoins et de désirs. La question de l'optimalité de la croissance du revenu par tête prend en compte ces antagonismes potentiels et renvoie alors moins au niveau du revenu qu'aux conditions de vie appréhendées par la consommation moyenne.
Le modèle de croissance proposé par Solow permet de montrer qu'il existe un sentier de croissance régulier qui maximise le niveau de la consommation par tête, lorsque coût et gain en termes de consommation d'une accumulation plus élevée s'égalisent, c'est-à-dire lorsque la productivité marginale du capital, nette de la dépréciation du capital, est égale au taux de croissance de l'économie : c'est le sentier de la règle d'or (Phelps, 1961). La règle d'or identifie le niveau de capital et, donc, le taux d'épargne qui permettent d'atteindre la consommation maximale, une fois le sentier de croissance régulier atteint.
Préférence pour le présent et altruisme intergénérationnel
Si le niveau d'accumulation dépasse celui de la règle d'or, baisser le taux d'épargne conduit à augmenter le niveau de la consommation à la fois dans la transition et sur le sentier de croissance régulier de la règle d'or, ce qui ne devrait pas remettre en cause le souhait d'atteindre ce sentier. Partant en revanche d'un niveau de capital d'état stationnaire plus faible que celui de la règle d'or, l'augmentation du taux d'épargne provoque transitoirement un taux de croissance du capital supérieur à celui de long terme. Les premières générations doivent ralentir leur consommation afin de soutenir cet effort d'accumulation. Or elles n'accepteront pas forcément d'élever leur taux d'épargne afin que la consommation dans le futur, y compris peut-être la leur, soit plus forte. Tout dépend de leur préférence pour le présent, de leur horizon de vie, de la façon dont elles valorisent le bien-être de leurs descendants, autrement dit de leur degré d'altruisme intergénérationnel.
Les incitations privées
Traiter du niveau d'accumulation optimal ne peut se faire sans étudier les comportements individuels qui en sont à l'origine. L'optimalité se définit par rapport aux préférences des agents, en particulier leurs préférences intertemporelles. En outre, il est crucial de savoir si les décisions individuelles conduisent naturellement vers ce niveau optimal ou bien si l'intervention de l'État est nécessaire, et alors sous quelles formes.
Le capital physique, le capital humain et le capital technologique sont des facteurs accumulables et font l'objet de décisions conscientes : les entreprises achètent des machines, des logiciels afin d'augmenter leur volume de production ; les individus se forment et s'éduquent, acquérant ainsi des connaissances générales et techniques qui leur permettent d'être plus productifs ; les entreprises font de la recherche-développement pour innover. L'ensemble de ces décisions est caractérisé par une dimension intertemporelle, faisant intervenir des dépenses présentes et des revenus futurs. Or ces derniers sont incertains. Seuls l'espérance d'un rendement important permettant de compenser la préférence des agents pour le présent et le caractère risqué de ces investissements peut inciter les agents privés à accumuler.
Institutions et incitations privées
Si le rendement futur de l'accumulation est fondamentalement incertain, il ne doit exister aucune incertitude pour l'investisseur sur son appropriation. C'est pourquoi le système juridique doit garantir à l'investisseur la propriété de ce revenu futur. Les droits de propriété, y compris sur les connaissances, doivent être clairement établis et garantis par l'État. Mais ce dernier doit aussi laisser espérer la possibilité d'un revenu élevé, y compris et surtout après impôt, pour rémunérer la renonciation à la consommation présente et la prise de risque inhérente à un investissement en univers incertain.
Prenons l'exemple des investissements en recherche-développement pour expliciter ces différents points. Pourquoi une entreprise cherche-t-elle à innover ? Son objectif est de se différencier des autres entreprises et de jouir ainsi d'un pouvoir de monopole assurant des profits élevés par une tarification au-delà du coût marginal. L'État doit-il chercher à éliminer ces rentes monopolistiques ? Ces dernières rémunèrent-elles une activité socialement utile ou proviennent-elles d'une rente de situation indue ? En fait, cette position de monopole est nécessaire pour rentabiliser les importants coûts fixes engendrés par l'activité préalable de recherche. Or, comme les idées sont non rivales, seul l'État peut garantir l'exclusivité de leur exploitation industrielle, au moins pendant une période transitoire. L'existence de droits de propriété intellectuelle matérialisés par des brevets assure que la recherche peut être profitable si elle est couronnée de succès, rien évidemment ne garantissant cette réussite. Douglas North (1990) prétend que ce n'est qu'à partir du moment où les innovateurs ont eu l'assurance légale de bénéficier des retombées financières de leurs découvertes que le rythme du progrès technique s'est accéléré. Si l'on comprend l'intérêt pour une entreprise de préserver l'exclusivité de l'utilisation de son innovation, c'est donc aussi l'intérêt de la collectivité de mettre en place cette protection juridique. Mais l'État ne doit pas non plus bloquer la diffusion des connaissances qui est au centre du processus de la croissance par les rendements d'échelle qu'elle engendre. C'est pourquoi les brevets, proposant une description complète et détaillée de l'innovation, et surtout d'une durée limitée, sont cessibles. En outre, une situation de monopole qui perdure peut être socialement défavorable. Les autorités de la concurrence sont donc prises entre deux objectifs contradictoires : d'un côté, inciter à l'innovation, et donc en limiter la diffusion ; de l'autre, faciliter sa diffusion au risque de réduire l'innovation.
North a particulièrement souligné le rôle historique des institutions – ensemble de contraintes imaginées par l'homme qui structurent les interactions politiques, économiques et sociales – dans l'émergence et la pérennité de la croissance. Les institutions doivent limiter au minimum les coûts de transaction dont Ronald Coase a montré l'importance dans une économie capitaliste. Il s'agit de l'ensemble des dépenses relatives à la définition, la protection et la mise en application des droits de propriété sur les biens. Fondamentalement, les institutions déterminent les règles du jeu et, ce faisant, les incitations à investir et à innover. Les causes du progrès technique doivent donc être aussi recherchées dans l'efficacité des institutions.
Certains pays sont parvenus à mettre en place des institutions qui permettent et encouragent l'initiative privée, tandis que d'autres la brident. L'exemple historique de la croissance de la Grande-Bretagne et de la stagnation jusqu'à une période récente de l'Espagne apporte, selon North, la preuve de l'importance du cadre institutionnel. Les incertitudes sur les droits de propriété dans certains pays africains, sud-américains et de l'Est expliquent partiellement le déficit d'investissements directs dans ces pays, ce qui limite la diffusion du progrès technique. Les coûts de transaction apparaissent trop élevés aux investisseurs étrangers, en particulier en raison de la corruption. L'État peut dans certains pays être le principal responsable de la violation du droit de propriété privée. C'est d'ailleurs pourquoi la démocratie va souvent de pair avec la croissance (Barro, 2000).
L'État peut aussi être un frein à cause d'une fiscalité trop importante sur l'épargne et sur l'investissement, les hauts salaires ou les profits. En abaissant le rendement (après impôt) de l'innovation, de l'épargne ou la rémunération (après impôt) des travailleurs les plus qualifiés, il diminue les incitations à investir dans le capital technologique, dans le capital physique et dans le capital humain. Ce n'est cependant pas l'impôt qui est à proscrire, mais une assiette trop concentrée sur des activités productives. Toute une série de défaillances liées au fonctionnement décentralisé d'une économie justifie aussi l'intervention de l'État afin de réguler le taux d'accumulation.
Les interventions de l'État
Si la première fonction de l'État est de mettre en place des institutions favorisant la croissance, son intervention répond aussi à une série de dysfonctionnements intrinsèques à une économie de marché, à l'impossibilité de nouer des contrats financiers entre les générations présentes et leurs descendants, à la nature publique de certains biens d'équipement, en passant par l'existence d'externalités et d'imperfections sur les marchés financiers.
Inefficience dynamique
Comme nous l'avons déjà souligné, les générations présentes ne souhaitent pas nécessairement faire l'effort d'accumulation qui assurerait aux générations suivantes une consommation maximale, sauf à faire preuve d'un altruisme intergénérationnel élevé. L'État n'a pas ici de raisons d'intervenir pour avantager les uns aux dépens des autres, d'autant que ce sont les générations actuelles qui votent...
De façon apparemment plus paradoxale, on peut également ne pas atteindre la règle d'or parce que l'économie se trouve en situation de suraccumulation. Dans un modèle à générations imbriquées, où les différentes générations se succèdent dans le temps et ne vivent qu'un nombre fini de périodes (Diamond, 1965), elles gagneraient à épargner moins et à substituer des transferts intergénérationnels à des transferts intertemporels. Les jeunes générations seraient d'accord pour transférer une partie de leurs revenus aux vieilles générations à condition que les prochaines générations en fassent de même, à leur profit lorsqu'ils seront devenus vieux. Cependant, ces transferts mutuellement avantageux ne peuvent pas être directement mis en place entre les générations actuelles et les générations à venir. Ils ne peuvent s'organiser sans l'intervention de l'État qui, seul, peut donner l'assurance aux jeunes générations actuelles que les suivantes seront obligées de respecter leurs engagements envers elles. C'est le principe même de la retraite par répartition, qui s'avère plus efficace qu'une retraite par capitalisation en cas de suraccumulation. Au-delà de ce problème relatif aux liens intergénérationnels, les marchés financiers ne permettent pas toujours la réalisation des bons niveaux d'épargne et d'investissement.
Imperfection des marchés financiers
Il n'est pas toujours possible d'emprunter le niveau de fonds souhaité, ce qui peut limiter l'investissement et l'accumulation. Comme il existe un risque de non-remboursement pour le prêteur, ce dernier peut exiger des collatéraux ou garanties (cautions, hypothèques, etc.). Il faut donc être suffisamment riche pour emprunter. Il s'agit là obstacles qui peuvent entraver notamment le financement des dépenses d'investissement en capital humain ou en recherche-développement et qui légitiment l'intervention publique. Il serait ainsi difficile, par exemple, d'engager des dépenses d'éducation si l'État n'avait pas institué un système public financé par ceux qui en ont profité précédemment, les actifs qui paient des impôts, et qui ne font finalement que rembourser la dette qu'ils avaient contractée implicitement pendant leurs études. Le financement des projets industriels impliquant des coûts de recherche gigantesques fournit un autre exemple convaincant. Le risque (de non-remboursement) peut apparaître trop important et seul l'État est à même de prendre à sa charge le financement de ces activités.
Il faut souligner cependant que des innovations en matière financière, adaptées à la nature spécifique de la recherche-développement, ont permis d'améliorer l'efficacité des systèmes financiers. Le capital-risque est un type de contrat financier adapté au cas de l'innovation permettant une rémunération plus élevée pour les créanciers destiné à compenser les risques plus importants. On considère que l'expansion technologique de la Silicon Valley dans les années 1990 s'est produite grâce à ce type de financement. Des marchés financiers spécialisés, et donc adaptés à ce type de risques, peuvent aussi être créés, tels que le Nasdaq aux États-Unis, en 1971, ou le nouveau marché en France, en 1996.
Indépendamment de ces problèmes liés à l'imperfection des marchés financiers, l'État peut être amené à intervenir, voire à se substituer à l'initiative privée, afin de rapprocher les décisions privées de celles qui sont requises pour atteindre une croissance optimale.
Externalités
Les agents privés ne perçoivent pas toujours toutes les conséquences de leurs décisions en matière d'accumulation. Ainsi, les investissements en recherche-développement permettent des découvertes qui profitent ensuite à tous ceux qui entreprennent des activités de recherche (externalités de connaissances) : leur rendement social est supérieur à leur rendement privé. Et si le niveau socialement optimal de ces investissements est supérieur à celui qui résulte des décisions privées, alors l'État doit soutenir la recherche par une politique de subventions spécifiques (le crédit d'impôt recherche, par exemple), ou même par une prise en charge totale si le rendement privé est quasi nul et le rendement social élevé, comme pour la recherche fondamentale (C.N.R.S.). La part de l'État dans le financement de la recherche est proche de 50 p. 100 en France ; elle n'est que de 32 p. 100 dans l'ensemble des pays de l'O.C.D.E.. Il existe toute une série de crédits distribués par l'Anvar (Agence nationale pour la valorisation de la recherche), parfois à taux zéro, remboursables en cas de succès. Autre exemple, la formation d'un travailleur exerce également des externalités positives sur la productivité des autres travailleurs. Or les efforts individuels de formation sont certainement insuffisants par rapport à ceux qui seraient optimaux ; c'est pourquoi l'État finance largement ce secteur, l'éducation étant en partie gratuite.
Des investissements publics
Certains équipements sont des biens publics, c'est-à-dire des biens non rivaux et non exclusifs. C'est le cas de l'éclairage et du réseau routier. Seul l'État est à même de financer de tels investissements grâce à l'impôt obligatoire, qui permet d'éviter le phénomène de « passager clandestin » ; on n'imagine pas des péages à toutes les intersections de routes. En outre, certains investissements impliquent de tels coûts fixes que seul l'État peut atteindre l'efficacité économique en tarifant au coût marginal, et donc à perte (réseau ferroviaire). Dans tous ces cas, l'État joue un rôle direct dans la croissance. Il est reconnu que les infrastructures publiques, le capital public, exercent des effets positifs sur la productivité des facteurs de production privés. La qualité des équipements publics est d'autant plus cruciale que ces derniers sont par définition spécifiques à un pays et intransférables internationalement, à la différence du capital physique ou technologique et, dans une moindre mesure, du capital humain, qui peut être transféré grâce à une migration de main-d'œuvre qualifiée. L'accumulation du capital public explique donc aussi une partie des disparités observées entre pays (Barro, 2000).
En conclusion, la croissance, source essentielle d'amélioration des conditions de vie, ne tient pas du miracle, elle traduit les performances économiques d'institutions et d'infractructures publiques favorisant l'accumulation privée. Parmi l'ensemble des facteurs qui sont à l'origine de la croissance, seule la qualité du cadre institutionnel et du capital public est apparue comme une condition nécessaire. Un pays peut, en effet, profiter de la diffusion du progrès technique. Il n'est d'ailleurs pas certain que les pays en avance technologique soient favorisés par rapport aux pays qui se contentent d'imiter avec retard. Ces derniers peuvent, en effet, consacrer davantage de ressources au secteur de production de biens finals. Un pays peut aussi bénéficier de l'épargne mondiale grâce aux marchés de capitaux internationaux, qui permettent de déconnecter épargne et investissement nationaux. Enfin, la main-d'œuvre qualifiée peut migrer vers les pays en retard, même si l'on assiste en réalité à des flux dans l'autre sens. En revanche, certains pays ne parviennent pas à décoller, principalement en raison de l'indigence de leur système public au sens large (juridique, fiscal, infrastructures...).
Si l'État joue un rôle essentiel dans la croissance des pays développés, on ne doit pas oublier que son rôle consiste principalement à inciter les agents privés à innover, à se former et à épargner. Ainsi, s'il participe largement au financement de la recherche, cette dernière demeure essentiellement le fait des entreprises privées. Comme le soulignait Schumpeter, la croissance semble fondamentalement assurée par la recherche du profit maximal dans le cadre d'une économie de marché. Quant aux craintes d'un épuisement de certaines ressources naturelles (pétrole, environnement) à l'appui de son pessimisme sur la pérennité de la croissance, gageons que l'homme sera assez ingénieux et imaginatif pour inventer des procédés de production qui surmonteront ces obstacles.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Jean-Olivier HAIRAULT : professeur à l'université de Paris-I-Panthéon-Sorbonne
Classification
Média
Autres références
-
AGRÉGAT ÉCONOMIQUE
- Écrit par Marc PÉNIN
- 1 488 mots
Au sens premier, un agrégat est un assemblage de parties qui forment un tout. Dans le vocabulaire économique moderne, le mot désigne une grandeur caractéristique de l'économie nationale et, plus généralement, une grandeur globale synthétique représentative d'un ensemble de grandeurs particulières. Le...
-
ANTICIPATIONS, économie
- Écrit par Christian de BOISSIEU
- 6 072 mots
- 4 médias
Puisque les variables macroéconomiques résultent de la conjugaison des actions individuelles, elles sont également conditionnées par les prévisions. Donnons quelques exemples : -
CAPITAL
- Écrit par Ozgur GUN
- 1 387 mots
Cette façon de concevoir la société est, en partie, sous-jacente dans les représentations actuelles de ce que les économistes appellent lamacroéconomie, lorsqu'ils considèrent que le produit national est obtenu à partir du capital et du travail. Mais à la vision d'une lutte pour le partage du produit... -
CHÔMAGE - Politiques de l'emploi
- Écrit par Christine ERHEL
- 7 303 mots
- 2 médias
Les évaluations macroéconomiques mesurent l'impact des politiques de l'emploi sur l'emploi, le chômage, les salaires, ou encore sur les flux sur le marché du travail, au niveau global. Elles utilisent des données agrégées, et éventuellement des modèles macroéconométriques existants. - Afficher les 27 références
Voir aussi
- CAPITAL HUMAIN
- MONOPOLE
- FORMATION PROFESSIONNELLE
- NÉO-CLASSIQUE THÉORIE ÉCONOMIQUE
- ÉCONOMIE DE MARCHÉ
- CAPITAL ACCUMULATION DU
- BIEN-ÊTRE ÉCONOMIE DU
- MARCHÉS DE CAPITAUX
- AGENTS ÉCONOMIQUES
- RETRAITE PAR RÉPARTITION
- PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
- INNOVATION FINANCIÈRE
- RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT
- NOUVELLE ÉCONOMIE
- PAYS EN DÉVELOPPEMENT (PED)
- PROFESSIONNELLE QUALIFICATION
- ÉDUCATION ÉCONOMIE DE L'
- SOUS-DÉVELOPPEMENT
- PRODUCTIVITÉ
- SERVICE PUBLIC
- CROISSANCE ÉCONOMIQUE
- DÉPENSES PUBLIQUES
- PENSÉE ÉCONOMIQUE HISTOIRE DE LA
- POLITIQUE FISCALE
- FACTEUR DE PRODUCTION
- DIVISION INTERNATIONALE DU TRAVAIL
- BIENS D'ÉQUIPEMENT
- CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE
- INNOVATION TECHNOLOGIQUE