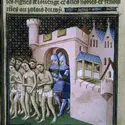MAL
Article modifié le
Le propre du mal tient en ceci qu'il ne peut être nommé, pensé, vécu qu'en relation avec une certaine idée du bien. Qu'il n'y ait pas de bien en soi, que ce que les hommes appellent le bien soit relatif aux situations et aux cultures, et le mal se trouve radicalement relativisé, lui qui du coup peut être le bien d'hier, de demain ou d'ailleurs. Qu'il y ait un absolu du bien, un « souverain bien » comme l'affirmaient les sages antiques, ou un « unique nécessaire » comme disent les religions du salut, et le mal, sous la forme de la folie ou de la perdition, se trouve ici encore cerné et délimité, au moins sur l'une de ses frontières, comme le contraire de ce bien, tout en gardant quelque chose d'obscur et d'indéfini, semblable – la métaphore est classique – à la part d'ombre dans un monde que la lumière ne saurait visiter. Le mal, contraire du bien, cette apparente lapalissade a donné d'autant plus à penser aux philosophes que la relation du mal au bien est à sens unique, car si le mal n'est jamais tel que par rapport à un bien au moins possible et représentable, le bien paraît avoir une positivité propre qui lui permettrait, quelle que soit sa figure, de se poser dans toute l'innocence de son ignorance du mal. L'idée du mal, qui doit avoir quelque réalité, puisque abondent et surabondent de tout temps et en tout lieu les discours sur le mal, est donc dialectique et interrogative : dialectique, puisqu'elle n'est pensable que par un entrecroisement de négations, c'est-à-dire par référence à la norme ou à la valeur que le mal nie existentiellement, lesquelles à leur tour le nient rationnellement ou idéalement ; interrogative, car le mal, ne pouvant être appréhendé que comme contestation scandaleusement heureuse du bien, pose par l'équivoque même de sa nature le problème de son origine et de sa signification. Le mal, en effet, ne saurait se montrer sans être aussitôt dialectiquement mis en question, et, de plus, il n'y a du mal dans le monde et dans l'histoire que parce qu'il existe pour l'homme un problème du mal.
Deux assurances, qui font antinomie, commandent et animent toute réflexion sur le mal : d'une part, si le mal ne suscitait la question : pourquoi le mal ? il ne serait pas le mal ; d'autre part, si la réponse à la question : pourquoi ? allait de soi dans une évidence naturelle, le mal disparaîtrait en même temps que serait effacée l'angoisse de la question. Si l'on appelle idéologie toute retombée, utilisable sociologiquement ou psychologiquement, de la pensée philosophique, la réflexion sur le mal aura pour premier devoir de récuser un certain nombre de fatalités idéologiques, telles les rhétoriques, conjoncturellement et culturellement nécessaires, de l'optimisme ou du pessimisme. Ce décapage effectué, il s'agira en fin de compte non pas de comparer les unes aux autres, en faisant le bilan de leurs inconvénients ou de leurs avantages, telles et telles solutions du problème, mais plus radicalement de se demander si la problématique du mal, engendrée par une dialectique destructrice d'elle-même, ne serait pas un faux problème, contraint ainsi à avouer son caractère idéologique. Mais l'interrogation sur le problème laisse intacte l'alternative ; il se pourrait que, même si toute solution au problème du mal relevait d'une idéologie, le problème lui-même doive se formuler avec une rigueur universelle, invincible à toute réduction idéologique. Ce problème du mal – obsession à psychanalyser ou interrogation authentique –, l'homme se l'est posé à travers tous ses modes de pensée, mythiques, philosophiques, religieux, dont il conviendra d'examiner quelques exemples particulièrement représentatifs.
Les mythes
On doit à Freud l'idée selon laquelle ce que le rêve est au dormeur singulier les mythes pourraient l'être à l'humanité globalement considérée, c'est-à-dire l'expression travestie d'une inquiétude qu'il est impossible de démasquer si l'on néglige, au profit exclusif de leurs structures, le contenu concret du mythe comme du rêve. Découvrir la finalité de cette inquiétude, ce serait comprendre le sens des mythes. Or, de même que le rêve, interprété par Freud, est un exorcisme joué qui conjure, en lui inventant une satisfaction imaginaire et symbolique, une frustration d'origine sexuelle, de même l' angoisse devant le mal, refoulée parce que censurée, et travaillant à se donner un apaisement irréel par l'invention d'images belles et équivoques, pourrait bien rendre raison de l'origine et du contenu des récits mythologiques. L'angoisse est la peur de l'esprit devant le non-sens, et elle est plus ancienne et plus profonde que tout savoir organisé, philosophique ou scientifique ; le mal, pour la sensibilité qu'il blesse d'une blessure qui est aussi d'esprit – d'où la vanité de la distinction scolaire entre les diverses sortes de mal : physique, moral, métaphysique –, c'est le malheur irréparable ou le crime inexpiable qui amènent à se demander si, du mal dans l' existence, on ne devrait pas conclure au mal de l'existence ; celle-ci serait alors totalement absurde et injustifiable ; cette angoisse insupportable dans la lucidité du jour, le rêve éveillé des mythes la trompe et la rend tolérable par l'aveu et le désaveu mêlés que fait de sa cruauté l'idéalité bien composée de la fable surnaturelle. Et parce que l'esprit réagit partout à sa propre angoisse en usant des mêmes subterfuges à la fois complaisants et répressifs, on ne s'étonnera pas que, dans les cultures les plus différentes dans l'espace et dans le temps, il y ait, en dépit d'un foisonnement en apparence gratuit, de si nombreuses et saisissantes analogies entre les mythes.
La faute originelle
Le mythe pose, en un premier moment, un monde en dehors du monde et un temps avant le temps dans lequel se déroulent des existences bienheureuses à l'abri de la douleur, de la faute et de la mort, c'est-à-dire de toutes les formes du mal. Tout se passe comme si le refoulement du mal avait fait surgir un imaginaire espace divin ; puis, en un deuxième moment, se produit l'inévitable retour du refoulé ; le mal envahit cette sphère supérieure et antérieure de l'existence qu'avait suscitée le refus du mal ; les dieux se font la guerre ; quelques anges se changent en démons et les êtres surnaturels se mêlent des passions et des affaires des hommes, donnant au mal des profondeurs d'abîme. Ces deux temps qui composent en antithèse le récit mythologique se retrouvent notamment dans les mythes du paradis perdu.
Il suffit de rappeler les premiers chapitres de la Bible, qui font se succéder le récit d'une Création dans laquelle toutes choses s'ordonnent, sans le moindre défaut, selon l'ordre et la clarté de la puissance divine, et un deuxième récit des origines, d'une lourdeur naturaliste très appuyée, dans lequel Dieu, plus fabricateur que créateur, fait figure de Dieu manqué, jaloux de sa créature, où le Paradis, gâté d'interdictions provocatrices, contaminé par la présence d'une bête infernale, est, avant même la faute et le châtiment, un paradis perdu, cependant que l'homme et la femme, désaccordés, exilés de l'unité humaine avant d'être chassés de l'Éden, ne sont capables de désobéir, d'être séduits, de se séduire l'un l'autre que parce que le mal est déjà là, énigmatiquement antérieur à son propre commencement, irréparablement mêlé aux choses telles qu'elles sont, au point que l'humanité ne peut acquérir la connaissance, travailler, se multiplier, c'est-à-dire devenir ce qu'elle est appelée à être, qu'après avoir rompu avec l'innocence et l'inconscience et commis une faute, qui parle d'autant plus violemment à l'imagination qu'elle est, en elle-même, irreprésentable, inconceptualisable, et qu'elle cumule les contradictions : libre et fatale, temporelle et intemporelle, inventant le mal et consentant à un mal préexistant. Le mythe biblique est d'autant plus significatif que les Écritures juives, appelées par les chrétiens Ancien Testament, représentent dans l'histoire de l'esprit l'effort le plus rigoureux pour exclure toute mythologie de la religion, c'est-à-dire du rapport de l'homme à l'Absolu. Et, cependant, lorsqu'elle se heurte aux problèmes jumeaux de l'origine des choses et de l'origine du mal, la plus authentique des pensées religieuses, la plus vigilante à ne pas sacraliser les phantasmes de l'homme se réfugie, comme Adam se cache après la faute, dans l'ombre du mythe, mais d'un mythe qui, avouant comme cyniquement sa nature de mythe, pourrait bien sonner le glas de la mythologie.
Le mythe ne saurait en effet proposer, sous le revêtement du symbole, une solution philosophique ou ésotérique au problème du mal, c'est-à-dire de sa nature et de son origine. Ce que la fonction fabulatrice projette dans le récit mythique, ce n'est ni un savoir sécurisant, ni un tourment fruste, sauvage, informel, mais une interrogation structurée, une angoisse qui est problème, un problème qui est angoisse : le mal dans le mythe de la Genèse est agressivement réel et conceptuellement insaisissable ; il est partout et nulle part, ou, s'il est quelque part, c'est dans le vide qui sépare le premier récit – triomphaliste – de la Création et le second récit, laborieux et éprouvant, de cette Création qui, dans un intervalle nul, est devenue, on ne saura jamais pourquoi, autre qu'elle-même, lorsqu'on passe de l'ordre des essences à l'ordre des existences. Le mal est là, dévisagé sournoisement à l'ombre des images, dans cette incompréhensible inégalité, qui vaut pour Dieu comme pour l'homme, de l'essence et de l'existence, et ce passage de l'une à l'autre qui devrait être une promotion se révèle comme dégradation. Dans le mythe, une pensée interrogative se donne une réponse fallacieuse dont elle joue à être complice sans en être véritablement dupe. Le mythe est le gardien du sommeil de l'esprit que son inquiétude a failli éveiller, mais il est aussi le témoin d'une inquiétude qui, elle, ne dort jamais. La beauté étrange et triste du mythe de la Genèse vient de ce que l'équilibre y est rompu, que l'amertume du « questionnement » sur le mal rend les apparences de la fable plus troublantes que rassurantes, que le dormeur est en train de s'éveiller à la peine de vivre, et qu'il s'apprête, au lieu de chercher la raison du mal dans le double lointain d'une poétique des origines, à en demander raison au Principe des choses dans un affrontement direct, toute mythologie congédiée, comme le fera plus tard dans les mêmes Écritures l'auteur du Livre de Job.
La tragédie et le destin
La même créativité qui révèle et trompe l'angoisse de vivre s'exerce dans le mythe et dans l'art. N'interrogeons ici que les littératures, notamment dramatiques et romanesques, qui s'apparentent aux mythes dans la mesure où elles inventent des personnages en conflit les uns avec les autres dans des situations imaginaires. Elles n'ont d'autre matière, à moins de se détruire en un vain formalisme, que l'existence humaine vulnérable et coupable, vouée à la monotone répétition du malheur, du crime, de la mort, mais traduite dans le déroulement rythmé d'une représentation ou d'un récit qui prend les orages de la passion dans les pièges et les sortilèges d'une beauté apaisante et irréelle. L'art dramatique de tous les temps, et d'abord dans ses modèles originels de la Grèce antique, vise à ce paradoxe, passablement scandaleux en son fond, de faire supporter à l'homme, dans une sorte de joie que les puritains et les jansénistes de toutes obédiences n'ont pas eu tort de juger suspecte, ce qu'il y a de plus insupportable dans la condition humaine : ainsi, la tragédie grecque porte le mal à son comble, faisant les dieux criminels et appelant sur l'héroïsme humain l'injustice de châtiments démesurés, montrant aussi – selon la célèbre interprétation hégélienne – le droit opposé au droit, et, par exemple, dévoilant l'incompatibilité entre le droit de la cité et le droit de la famille, partage indépassable des valeurs qui voue Antigone à la mort et Créon au déshonneur ; comme si le mal s'introduisait au cœur même du bien pour l'opposer contradictoirement à lui-même ou encore, autre langage, mais qui désigne la même extrémité de mal, comme si le sublime humain se retournait contre l'homme pour le défaire et le déshumaniser. Poussant le mal à l'absolu d'une manière exactement spectaculaire, le tragique poétiquement représenté en propose aussi une sorte d'absolution par recours au destin qui enveloppe les dieux et les héros, les crimes et les malheurs, dans une totalité nécessaire et belle au sein de laquelle les antagonismes se compensent et s'annulent de façon qu'au terme l'injustifiable apparaisse – mais ce n'est qu'une apparence – comme absolument justifié. D'où une sérénité qui est mystification. La pensée à l'œuvre dans la représentation tragique, en donnant à la question du mal la réponse du destin, brouille l'une avec l'autre les deux réponses contradictoires du sens total et de l'absolu non-sens. Ainsi, l'interrogation reste béante et la possibilité est maintenue que le destin, c'est-à-dire l'infigurable, l'inéluctable, l'inscrutable, soit la parabole de la mort qui rend tout tumulte humain « au silence pareil ».
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Étienne BORNE : inspecteur général honoraire de l'Éducation nationale
Classification
Autres références
-
ANTÉCHRIST
- Écrit par Hervé SAVON
- 1 183 mots
- 1 média
C'est dans un texte du Nouveau Testament — la première Épître de Jean (fin ier/déb. iie s.) — qu'apparaît pour la première fois le mot grec antichristos, dont le français « antéchrist » est le calque imparfait. Cependant, on voit se former l'idée d'un antimessie — c'est...
-
CATHARES
- Écrit par Christine THOUZELLIER
- 6 765 mots
- 2 médias
Pour les cathares, le problème crucial est celui du mal, qu'on trouve dans l'univers rempli de créatures vaines et corruptibles, et qu'ils ne peuvent imputer à Dieu. Leur foi repose sur la conviction commune que ce monde visible et tout ce qu'il renferme est l'œuvre du diable. Selon le traité de Bartholomé... -
DEVOIR (notions de base)
- Écrit par Philippe GRANAROLO
- 2 244 mots
L’homme serait donc le seul être doté de moralité, le seul qui aurait accès aux notions de bien et demal, alors que les autres créatures ne connaissent que l’instinct et la logique des rapports de force. D’ores et déjà pointe un paradoxe : dans la tradition judéo-chrétienne, la connaissance... -
EICHMANN À JÉRUSALEM, Hannah Arendt - Fiche de lecture
- Écrit par Vincent LEFEBVE
- 1 026 mots
...avec les autorités allemandes au-delà de ce qui était nécessaire. Secundo est mise en cause sa dénonciation de l’instrumentalisation politique du procès par l’État d’Israël. Tertio sont soumises à la critique sa façon d’aborder la personnalité d’Eichmann et la thèse corrélative de la banalité du mal. - Afficher les 22 références
Voir aussi