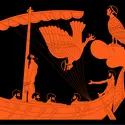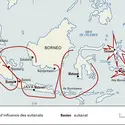MALAISIE ET INDONÉSIE, langues et littératures
Article modifié le
La littérature indonésienne
S'il n'y a aucune solution de continuité entre le malais et l'indonésien, il y a rupture – et rupture consciente de la part des auteurs – entre l'ancienne « littérature malaise » et la nouvelle « littérature indonésienne ». La société indo-néerlandaise des années 1920 était évidemment très différente de celle des sultanats du xviie siècle, et les fougueux étudiants de Batavia – bientôt « indonésiens » – entendaient rompre d'avec les formes littéraires traditionnelles (hikayat, syair, etc.). Ils se tournent tout naturellement vers l'Occident dont les échos affaiblis leur parviennent par l'intermédiaire des traductions néerlandaises.
Quatre faits sont à signaler à l'origine de cette spectaculaire renaissance : l'essor d'une presse en malais dès les dernières décennies du xixe siècle ; le développement, à partir de 1880 environ, d'une abondante littérature sino-malaise (romans, pièces de théâtre, rédigés en malais par des Chinois d'outre-mer) ; la création en 1908, par les autorités coloniales, d'une maison d'édition (Balai Pustaka) chargée de faire connaître, par des traductions, la littérature de la métropole et de publier les œuvres originales des premiers auteurs « indigènes » ; la publication, en 1911, des Lettres d'une jeune Javanaise de famille noble (originaire de Japara), Radén Ajeng Kartini. Rédigées en néerlandais et adressées à une correspondante des Pays-Bas, ces lettres reflètent les aspirations et les déceptions de l'auteur, victime de l'ancienne coutume qui cloîtrait les filles de la noblesse dès qu'elles atteignaient l'âge de douze ans. Toute une génération se reconnut dans Kartini, qui devait devenir comme une des pionnières de la lutte pour l'émancipation féminine.
On s'accorde pour distinguer cinq grandes périodes dans le développement de la littérature indonésienne.
L'éveil (1920 env.-1933)
La première phrase s'inscrit sous le signe de l'« occidentalisation ». Les auteurs sont surtout des Sumatranais (pour qui le malais-indonésien est la langue maternelle), issus de l'aristocratie ; ils ont rencontré l'Europe au cours de leurs études secondaires, poursuivies dans l'une des très rares écoles que le gouvernement colonial entrouvre aux élites.
Les premières grandes œuvres sont des romans, axés sur quelque drame psychologique, souvent fort longs et excessivement sentimentaux pour le goût occidental ; ils présentent néanmoins un grand intérêt, celui de traiter de problèmes propres à l'Indonésie, comme celui du mariage forcé (alors fréquent à Java et à Sumatra), ou encore celui du mariage interracial (entre Hollandais et Indonésiens). Parmi les titres les plus célèbres, citons Sitti Nurbaya, de Maha Rusli (1922, et nombreuses rééditions), et Éducation manquée (Salah asuhan), de Abdul Muis (1928). Nur Sutan Iskandar, Suman Hasibuan et surtout Sutan Takdir Alisjahbana devaient occuper bientôt une place prépondérante dans le mouvement littéraire.
La poésie innove également en empruntant aux modèles européens (notamment le sonnet) ; en 1920 paraît Patrie (Tanah air), recueil de M. Yamin ; en 1925 paraît Jaillissement de pensées (Percikan permenungan), recueil de Rustam Effendi. En matière de théâtre, les jeunes auteurs acclimatent le « drame » et écrivent des pièces, divisées en scènes et en actes (généralement cinq) et souvent rédigées en vers. Le sujet est parfois emprunté, à dessein, au passé glorieux et semi-légendaire de Java (Airlangga et La Chute de Mojopahit par Sanusi Pané) ; le public n'est pas sans comprendre les allusions et la police est parfois obligée d'interdire la distribution des livrets (comme celui de Bebasari par Effendi).
Il faut noter encore que, durant cette première période, plusieurs auteurs écrivent en néerlandais ; les premières revues littéraires, Jong Java, Jong Sumatra, sont en bonne partie rédigées dans cette langue, et le bimensuel Timboel (Surgissement) paraît d'abord en néerlandais, avant d'opter pour le malais en 1932 (grâce aux efforts de Pané). L'apport positif de cette première génération peut se résumer en quatre points : volonté de rompre avec le passé, naissance d'une première conscience nationale, début d'une lutte – encore timide – contre certains abus, tendance au réalisme et tentative pour décrire la société contemporaine. Parallèlement, la littérature sino-malaise poursuit son développement.
L'âge de « Pujangga Baru » (1933-1942)
La deuxième période va de la fondation de la revue littéraire Pujangga baru (Écrivains nouveaux) par S. T. Alisjahbana, Amir Hamzah et Armijn Pané, jusqu'à l'arrivée des Japonais et l'effondrement du pouvoir colonial hollandais. C'est l'époque qui suit immédiatement la grande crise mondiale dont les conséquences ont été lourdement ressenties dans les « Indes ». Devant une autorité qui se durcit, les jeunes nationalistes prennent de mieux en mieux conscience du sens de leur lutte. Sur le plan linguistique, on assiste parallèlement à un progrès de la langue malaise (appelée « indonésienne » depuis 1928) ; elle s'enrichit et s'assouplit ; en juillet 1938, un congrès tenu à Solo (Java central) enregistre les résultats dans ce domaine. À côté des Sumatranais, jusqu'alors les plus nombreux à écrire, on va voir désormais nombre de Javanais et de Balinais adopter l'indonésien comme langue littéraire.
Le grand poète du moment est Amir Hamzah (apparenté au sultan de Langkat, près de Médan) ; ses principaux recueils sont : Chants de solitude (Nyanyi sunyi, 1937) et Fruits de nostalgie (Buah rindu, 1941). Citons encore, parmi les poètes, le Batak Armijn Pané et J. E. Tatengkeng (originaire de l'archipel de Sangihe, au N.-E. de Célèbes). Parfois, l'inspiration patriotique se dissimule sous un symbolisme subtil, pour échapper aux foudres de la censure. Le genre « roman » continue à connaître un grand succès ; S. T. Alisjahbana écrit Voile au vent (Layar terkembang, 1936), et Armijn Pané Chaînes (Belenggu, 1940). À signaler aussi l'œuvre de Hamka (originaire du pays Minangkabau) qui reflète l'atmosphère imprégnée d'islam de son pays natal. On continue d'écrire des drames d'inspiration historique (Kén Arok et Kén Dedes de M. Yamin), mais certaines pièces se déroulent aussi dans un cadre plus moderne, tel Manusia Baru (L'Homme nouveau) de S. Pané.
Sur le plan des idées, on assiste aux débuts d'une polémique lourde de signification. Aux partisans de l'occidentalisation à outrance, regroupés derrière S. T. Alisjahbana, s'opposent les partisans de la tradition orientale, notamment le Dr Soetomo et surtout Ki Hadjar Dewantoro, qui, soucieux de renouer avec les antiques valeurs javanaises, crée en 1922 le Taman siswa, organisation visant à ranimer les principes d'éducation traditionnels (en 1935, il y aura 200 écoles, avec 17 000 élèves) ; ses adversaires l'accuseront d'adopter un point de vue étroitement javanais et non pas national et « indonésien ». Tant que les autorités hollandaises se maintinrent, les contacts avec l'Europe et la culture européenne restèrent relativement aisés – bien que les voyages aux Pays-Bas n'aient toujours été réservés qu'à une infime minorité (il n'y avait, en 1942, que cinq Indonésiens à avoir reçu le titre de docteur ès lettres en métropole). Cependant, lorsque l'ordre japonais se fut établi à travers tout l'Archipel, la situation se trouva radicalement transformée.
La mutation (1942 env.-1950)
L'occupation nipponne de 1942 à 1945, puis la lutte armée pour l'indépendance (la « révolution physique » contre les Hollandais, de 1945 à 1949) représentent pour la littérature indonésienne, comme pour l'histoire du pays, un tournant décisif. Les Japonais interdisent systématiquement l'usage du néerlandais et rompent brutalement tous les liens qui unissaient la colonie à la métropole ; ils tentent d'attirer à eux les auteurs indonésiens et de leur faire adopter l'idéal d'une « plus grande Asie orientale » ; certains périodiques, comme Jawa Baru (Nouvelle Java) et Asia Raya (Grande Asie), font une place aux œuvres littéraires ; la revue Kebudayaan Timur (Culture orientale), dirigée par S. Pané, mais contrôlée par les autorités d'occupation, publie des articles sur les civilisations indonésienne et nipponne (sur le wayang, sur le théâtre nō), ainsi que sur leurs similitudes supposées. On ne doit pas sous-estimer le rôle joué par les Japonais dans le processus de prise de conscience des Indonésiens ; néanmoins, rares furent les écrivains qui s'inscrivirent sous leur bannière.
Les nouveaux talents vont se révéler ailleurs, dans une nouvelle génération de jeunes issus de milieux plus humbles que leurs prédécesseurs d'avant-guerre (fils de petits fonctionnaires ou d'instituteurs) et considérablement moins nourris de culture occidentale ; il se désigneront eux-mêmes du nom de « génération de 1945 » (Angkatan empatpuluh lima). Fait important, Jakarta cesse pour un temps d'être le centre essentiel ; c'est là que le contrôle étranger, nippon puis hollandais, s'exerce avec le plus de facilité ; les nationalistes, devenus républicains, se réfugient dans les maquis provinciaux, notamment à Java central (autour de Yogyakarta). C'est là que plus d'un auteur rédigera ses premières œuvres, courts pamphlets, articles destinés à quelque journal local, pièces radiophoniques diffusées par une radio de campagne.
L'inspiration change du tout au tout et l'expression gagne en vigueur ; on ne dissimule plus ses revendications, on les crie à la face du monde. Les auteurs transcrivent la réalité mouvementée qui les investit : combats, exodes, prisons. La personnalité d'un grand poète domine toute cette période, celle de Chairil Anwar (1922-1947) ; les titres de ses recueils indiquent déjà le ton adopté : Cailloux pointus (Kerikil tajam), Vacarme dans la poussière (Deru campur debu) ; un de ses poèmes surtout, intitulé Moi (Aku), devait obtenir une grande célébrité. Il commence ainsi :
Aku ini binatang jalangDari kumpulannya terbuang.Je suis une bête sauvage rejetée de son troupeau.
En matière de théâtre, on note également un certain renouveau ; on cultive encore le drame allégorique en vers, tel La Flûte (Suling) de U. T. Sontani, mais les sujets sont plus généralement empruntés à l'actualité et à la société contemporaine (pièces d'Usmar Ismail et d'El Hakim).
La grande nouveauté consiste dans l'apparition du cerpén, abréviation de cerita péndék ou « histoire courte », c'est-à-dire de la nouvelle. Le temps n'est plus au roman fleuve, trop long à lire et trop cher à imprimer. Quelques pages, une vingtaine au plus, devront désormais suffire à relater un événement, à typer un personnage ou à esquisser une introspection fugitive. Le grand nom est ici celui d' Idrus (1921-1979), qui joua pour la prose indonésienne un rôle comparable à celui de Chairil Anwar pour la poésie ; ses meilleures nouvelles datent de l'occupation japonaise : Notes souterraines (Corat-corét dibawah tanah, 1942-1943) ; citons encore Asrul Sani (originaire de Sumatra) et U. T. Sontani (Soundanais).
De 1950 à 1965
Le mois de décembre 1949 voit le transfert de souveraineté, et donc la fin de la lutte armée. La cessation des hostilités ne signifie pas l'apparition d'une rupture brusque dans le domaine de la littérature. Certains changements néanmoins sont à signaler : le rétablissement de Jakarta comme centre principal des activités culturelles ; l'apparition d'un grand nombre de revues littéraires, souvent de courte durée mais parfois aussi destinées à un bel avenir (Pujangga baru reparaît en 1948 et cède la place à Konfrontasi en 1954, Kisah dure de 1953 à 1957, Indonesia de 1950 à 1965, Sastra de 1961 à 1964) ; l'apparition de tendances et de groupes au sein d'un milieu que la lutte pour l'indépendance avait un temps cimenté.
Sitôt après la victoire, le problème se posa en effet de savoir selon quels principes il conviendrait de développer à l'avenir la culture « indonésienne ». Beaucoup proposaient, avec le président Sukarno, de préserver ce qu'ils appelaient « l'originalité nationale » ; mais cela impliquait, à plus ou moins longue échéance, un retour à la tradition, une récupération du passé historique, et donc du legs culturel javanais, ce que précisément bon nombre de non-Javanais n'étaient pas disposés à accepter. Faute d'une tradition commune admise par tous, on fut obligé de chercher ailleurs et, dès 1950, deux nouvelles tendances se précisent : d'une part, les tenants de « l'art pour l'art » se proposent d'acclimater un « humanisme universel » ; d'autre part, les tenants de « l'art pour le peuple » prônent l'avènement d'un « réalisme créatif » et fondent un Institut de culture populaire, ou « Lekra ». Les premiers regardent surtout vers l'Europe et l'Amérique et s'inscrivent dans la ligne des occidentalistes d'avant-guerre ; les seconds s'inspirent plutôt des modèles soviétiques, tout en reprenant certaines idées des anciens partisans des valeurs « orientales ».
Le théâtre disparaît presque totalement ; la poésie est en déclin ; les traductions se multiplient (d'œuvres venues tant d'Occident que des pays socialistes) ; le cerpén connaît un extraordinaire succès : plus de deux cents auteurs dont quatre-vingts au moins ont écrit plus de cinq nouvelles. Les grands noms sont ceux de Mochtar Lubis (auteur de Senja di Jakarta, ou Clair-obscur à Jakarta, rédigé en prison et interdit par le gouvernement de Sukarno), de Sitor Situmorang et de Pramudya Ananta Tur (également auteur de romans dont le célèbre Keluarga Gerilya, ou Famille de maquisards). À partir de 1957 (début de la « démocratie dirigée »), et surtout à partir de 1960-1962 (début de la politique « anti-impérialiste »), la politisation s'intensifie ; plusieurs auteurs s'exilent (en Malaisie, en Australie). Le drame de 1965 résout douloureusement la tension qui depuis quelques mois montait à travers tout le pays.
Après 1966
Les années 1965-1966 marquent un tournant important dans l'histoire de la littérature indonésienne. Les membres et sympathisants du Lekra sont éliminés ; la plupart sont mis en prison ou déportés dans l'île de Buru. Leurs anciens adversaires profitent du champ libre, et l'on parle bientôt de la nouvelle « génération de 1966 » (Angkatan enampuluh enam), qui s'exprime dans cinq revues littéraires (dont Horison). La poésie connaît un renouveau, notamment avec Rendra, qui fait aussi du théâtre et se donne un profil de contestataire ; mais le fait le plus notable est la renaissance du roman (avec N. Dini, l'épouse d'un diplomate français, qui excelle dans l'introspection, et Ramadhan K. H., d'origine soundanaise, dont le récit autobiographique – Spasmes d'une révolution – connaît localement un grand succès). À signaler, un peu à part, la figure originale de Ajip Rosidi, resté très proche de sa culture soundanaise, et versé dans tous les genres : poésie, nouvelle, roman, essai ; Ajip a de plus le mérite d'animer une nouvelle maison d'édition, Pustaka Jaya, qui s'efforce de promouvoir la lecture dans tous les milieux, et notamment chez les enfants.
À partir de 1978, les autorités commencent à élargir, l'un après l'autre, les anciens auteurs arrêtés en 1965-1966, et l'attention se porte naturellement sur ces ombres qui se sont tues pendant douze ans et plus. Certaines restent muettes, mais d'autres reprennent la plume et publient à nouveau, fortes d'une expérience irremplaçable. Après Sitor Situmorang, qui recommence à composer des poèmes et rédige son autobiographie, c'est surtout Pramudya Ananta Toer (1925-2006) qui va se révéler la figure la plus marquante de la littérature indonésienne. Tant sur le mode de la fiction (Ceux qu'on entrave, 1951) que sur celui de l'autobiographie (Soliloques d'un muet, 1995), son œuvre embrasse toutes les vicissitudes du xxe siècle : occupation japonaise (Le Fugitif, 1950), premiers temps de l'indépendance (Corruption, 1954). Le thème de la prise de conscience, qu'il concerne l'oppression coloniale (La Maison de verre, 1988) ou l'inégalité des sexes et des conditions sociales (La Fille de la côte, 1987), est déterminant chez lui.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Denys LOMBARD : directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales
Classification
Autres références
-
ANANTA TOER PRAMOEDYA (1925-2006)
- Écrit par Etienne NAVEAU
- 847 mots
Romancier, essayiste et biographe, auteur d'une œuvre largement diffusée et traduite, Pramoedya Ananta Toer (dit Pram) est sans conteste la figure la plus marquante de la littérature indonésienne du xxe siècle. Né en 1925 à Blora, ville située sur la côte nord de Java, Pram prit part...
-
BOUGI ou BUGI
- Écrit par Yvan BARBÉ
- 461 mots
Population numériquement la plus importante de la péninsule septentrionale de Célèbes (Sulawesi) en Indonésie, les Bougi étaient environ 3,5 millions dans les années 1990. Cette ethnie fut, avec les Makassar, parmi les premières populations malaises à se convertir au bouddhisme et à faire leurs...
-
ÉPOPÉE
- Écrit par Emmanuèle BAUMGARTNER , Maria COUROUCLI , Jocelyne FERNANDEZ , Pierre-Sylvain FILLIOZAT , Altan GOKALP , Roberte Nicole HAMAYON , François MACÉ , Nicole REVEL et Christiane SEYDOU
- 11 783 mots
- 7 médias
...Kampuchéa. Au xe siècle, on connaît une version en kawi d'un des livres de cette épopée : Bishmaparvan. Il y a d'autres versions attestées au Siam et en vieux malais ainsi qu'en Birmanie et au Tibet. De nombreuses compositions littéraires et des épisodes entiers en sont dérivés. -
INDONÉSIE - Histoire
- Écrit par Denys LOMBARD
- 10 660 mots
- 7 médias
...Dans ces ports nouvellement créés, où confluaient les nationalités les plus diverses, la nécessité d'une langue d'échanges se fit bientôt sentir ; le malais put de ce fait acquérir la place prépondérante qui est la sienne à présent. Dans les creusets linguistiques que formaient tous ces carrefours commerciaux,... - Afficher les 7 références
Voir aussi
- SOUNDANAIS
- ABDULLAH IBN ABDUL KADIR MUNCHI (1796-1864)
- BANDJAR
- BALINAIS, langue
- SASAK
- PRAPAÑCA (XIVe s.)
- MALGACHE, langue
- NOUSANTARIENNES LANGUES
- JAVANAIS, langue
- MADOURAIS, langue
- JAVANAISE LITTÉRATURE
- MPU KANWA (XIe s.)
- MPU TANTULAR (XIVe s.)
- HIKAJAT HANG TUAH (XVIe s.)
- HAMZAH AMIR (1911-1946)
- IDRUS (1921-1979)
- ALEXANDRE ROMAN D'
- PANTOUM ou PANTUN
- PANÉ ARMIJN (1908-1970)
- ALISJAHBANA SUTAN TAKDIR (1908-1994)
- ANWAR CHAIRIL (1922-1947)
- MOJOPAHIT ou MODJOPAHIT
- AJIP ROSIDI (1938- )