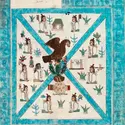MARINE
Article modifié le
Les puissances navales dans le monde contemporain
Depuis le milieu du xixe siècle, les possibilités techniques, le rôle et la répartition des forces navales ont complètement changé. Au risque de schématiser, on pourrait distinguer quatre phases caractéristiques : les premières expériences de la nouvelle marine de guerre (guerres de Crimée et de Sécession), l'apparition de marines nationales et le développement des marines impériales, enfin la guerre navale à l'échelle mondiale.
Propulsion à vapeur, canons-obusiers, blindage des navires, tous fruits de la révolution industrielle, ont transformé la silhouette des navires de guerre, créé de nouveaux types en quelques décennies et modifié la composition des flottes militaires plus rapidement que celle des flottes marchandes. L'accroissement de vitesse acquis grâce à la vapeur bouleversait les conditions de la guerre, permettait la surprise, affranchissait la manœuvre des servitudes du vent, accélérait le transport à longue distance de corps expéditionnaires nombreux.
Mais ces progrès dispendieux n'étaient accessibles qu'aux États riches. La France en attendait son renouveau naval, l'Angleterre industrielle le maintien de sa prééminence et de son expansion. Toutes deux, de concert, avec le concours italien, expérimentèrent la nouvelle marine contre un adversaire fort éloigné, la Russie. La logistique réussit un premier coup de maître : le transport et le ravitaillement en armes, munitions et vivres d'une armée qui s'éleva à 150 000 hommes. Opération combinée sur mer et sur terre, appuyée par une puissance de feu inusitée. L'expérience de la guerre de Sécession, aux États-Unis, fut un peu différente. Elle démontra la supériorité navale du Nord industriel, et c'est au cours de ce conflit que fut livré le premier combat de l'histoire entre navires cuirassés ; la compétition entre le blindage et le canon commençait, et l'on s'aperçut par ailleurs que c'était à partir des tourelles que l'artillerie disposait du champ de battage le plus étendu. Toutefois, le conflit terminé, l'isolationnisme américain laissa à d'autres marines le soin de tirer parti des expériences.
Le rôle de la marine dans l'expansion coloniale des puissances européennes a été fondamental. Les méthodes ont cependant été différentes selon les pays. Ainsi la marine française a, très souvent, ouvert le chemin à la pénétration militaire par des opérations de détail et l'occupation de points d'appui (Courbet en Indochine, Pierre à Madagascar, Brazza au Congo). La répression de la traite des Noirs en a été l'occasion, à plusieurs reprises. L'Angleterre disposait déjà en Afrique et en Asie de bases de départ, et sa flotte a surtout joué un rôle de soutien (Égypte, Afrique du Sud, Afrique orientale, Birmanie). Quant aux points d'appui, leur fonction était technique (approvisionnement en eau et en charbon) et stratégique (escales sur les routes propres à chaque pays et aux points de passage obligés de la circulation mondiale) : Gibraltar, Malte, Chypre, Alexandrie, Aden, Ceylan, Singapour, Hong Kong, Maurice, Le Cap, Sainte-Hélène, les Falkland, pour l'Angleterre ; Bizerte, Djibouti, Saigon, Nouméa, Diego-Suarez, Dakar, Fort-de-France, pour la France.
Tard venus à l'unité politique ou à l'industrialisation, entre 1870 et 1914, l'Allemagne et l'Italie, la Russie et le Japon se dotèrent de flottes non négligeables. Les États-Unis, qui avaient désarmé après la guerre de Sécession, reconstruisirent la leur, instrument de leur expansion de la fin du siècle (Hawaii, Cuba). Venaient ensuite l'Autriche-Hongrie, la Chine et les États sud-américains (Chili, Pérou surtout). La flotte japonaise, pourvue de trois escadres modernes, infligea un désastre à la marine russe, hétérogène et gênée par l'extension de ses lignes de communication. La bataille de Tsushima (1905) mit en évidence les problèmes de la stratégie maritime mondiale : répétition, avant les drames ultérieurs. Guillaume II, de son côté, proclamait : « Notre avenir est sur l'eau. » En 1914, la marine allemande venait au second rang, après l'Angleterre, et elle était neuve.
Les épreuves des deux guerres mondiales donnèrent raison aux partisans de la force navale. La conquête du terrain, qui assure la victoire, est, sans doute, l'œuvre des armées terrestres ; mais, lors de conflits mondiaux, la maîtrise de la mer – et celle de l'air, qui lui est liée – s'est révélée une condition absolue. Ainsi s'explique le rôle assigné à la Home Fleet anglaise et le soin mis par les marines alliées dès 1914-1915 à chasser des mers les croiseurs ennemis, comme à verrouiller la Baltique, l'Adriatique et les Dardanelles. La réplique allemande fut le sous-marin, qui, depuis les essais du Gustave-Zédé (1893) et du Narval (1899) en France, avait démontré son efficacité contre les gros navires de surface (type Dreadnought, 1907). Étendue à toute forme de navigation (torpillage du paquebot anglais Lusitania, le 7 mai 1915) pour répondre au blocus allié, l'action sous-marine en arriva à intercepter, en 1917, le quart du ravitaillement britannique, mais la réplique fut dure (199 sous-marins allemands coulés en 1917) et les excès des attaques allemandes furent une des raisons de l'intervention des ÉtatsUnis. Or, dès ce moment, le repérage et la chasse aux sous-marins par des flottilles spécialisées, le minage des chenaux menacés et la protection des convois avaient réussi à neutraliser l'action des sous-marins allemands, et le rythme de leur destruction était plus rapide en 1918 que celui de leur renouvellement. L'acheminement vers l'Europe d'un million de soldats américains et de leur train de combat se fit sans pertes.
Vulnérable aux sous-marins et aux avions, le navire de surface fut cependant loin de disparaître, et l'entre-deux-guerres vit le développement et la concentration des forces navales au profit des plus grandes puissances. La conférence de Washington (1921) classa au premier rang les États-Unis et la Grande-Bretagne, puis le Japon, et enfin, à égalité, l'Italie et la France. Cette dernière put construire, sous l'impulsion de Georges Leygues, une flotte moderne. L'Allemagne pour sa part, en dépit du traité de Versailles, disposait de « cuirassés de poche » et d'une flotte de sous-marins à grand rayon d'action, et le Japon, qui avait, comme les États-Unis, accordé une attention toute spéciale à l'aéronavale, possédait plusieurs porte-avions.
Considérée dans son ensemble, la guerre navale de 1939-1945 a confirmé l'efficacité du sous-marin, capable, grâce au schnorchel, d'effectuer des plongées prolongées et donc de parcourir de grandes distances, échappant ainsi aux radars encore rudimentaires ; mais les progrès de la détection permirent aux Alliés de ne pas abandonner la maîtrise de l'Atlantique. En revanche, la bataille du Pacifique, entre les États-Unis et le Japon, ranima un nouveau type de guerre de surface, dominée par le porte-avions ; les navires n'arrivaient plus à portée de canons et livraient bataille à des distances variant entre 300 et 700 kilomètres, et l'affrontement fut principalement aérien. Cette stratégie valut aux Japonais leurs premiers succès (Pearl Harbor, 7 déc. 1941), puis aux Américains de se ressaisir et de l'emporter (mer de Corail, juin 1942 ; Philippines, oct. 1944). Sur tous les fronts, les flottes ont joué un rôle essentiel de soutien logistique, sans oublier les nombreuses opérations amphibies qui, d'archipel en archipel, permirent la reconquête américaine du Pacifique. Tous les grands débarquements manqués (Alliés en Norvège, Allemands en Angleterre, 1940) ou réussis en Afrique (Alliés, 1942) et surtout en Europe (Italie, 1943 ; Normandie et Provence, 1944) ont comporté l'action combinée d'une force opérationnelle (Task Force), d'une flotte de débarquement, avec navires spéciaux et ports préfabriqués, sous une écrasante couverture aérienne. À la même stratégie se rattache l'ouverture de l'océan glacial Arctique aux convois de Mourmansk, destinés au ravitaillement de l' U.R.S.S. par les Alliés.
Après la Seconde Guerre mondiale, la répartition des forces navales a été modifiée par l'apparition d'une marine de guerre soviétique, riche notamment en sous-marins, œuvre de l'amiral Gorchkov, présente sur toutes les mers. Surtout, dans tous les pays, la possession d'une marine est devenue une entreprise très coûteuse et avant tout technique, dont les conditions exigent une révision des conceptions stratégiques et tactiques. Les flottes opèrent désormais loin de leurs bases nationales (guerre d'Indochine pour la France puis les États-Unis, de Corée pour les États-Unis, démonstrations soviétiques à Cuba, et internationales dans le golfe Arabo-Persique). La fin des empires coloniaux maritimes a obligé les puissances navales à négocier l'usage de certains ports et les a contraintes à manifester leur présence au moyen de forces mobiles et autonomes. Le fait nucléaire a profondément transformé les grandes marines, car elles seules sont capables d'en tirer parti tant pour la propulsion que pour l'armement des navires. Celui-ci connaît de grandes modifications : l'artillerie est reléguée au second plan par le développement de toute une gamme de missiles surface-surface, air-mer, mer-air. L'hélicoptère s'assure une place essentielle dans la lutte contre les sous-marins. L'amélioration de la détection sous-marine devient un enjeu fondamental car elle seule paraît susceptible de remettre en cause la capacité des sous-marins stratégiques, équipés de missiles balistiques nucléaires, à assurer la politique de dissuasion.
La puissance navale, se mesure désormais à l'aune d'une double capacité : la capacité de dissuasion et de rétorsion, dont les armes par excellence sont le sous-marin nucléaire lanceur de missiles balistiques nucléaires et le sous-marin nucléaire d'attaque, munis l'un et l'autre de missiles tactiques ou de croisière ; la capacité d'intervention qui se manifeste par la possession de flottes de surface articulées autour de porte-avions, de porte-hélicoptères et de bâtiments de débarquement, soutenus par des navires logistiques (pétroliers-ravitailleurs, navires-ateliers).
La mobilité stratégique des flottes suppose liberté de mouvement en haute mer (reconnue dans le droit de la mer) et capacité de durer. Cette autonomie, rendue possible par un important soutien logistique et des télécommunications par satellites, permet de pratiquer un blocus ou de soutenir une intervention terrestre. La guerre des Malouines (1982) ou les conflits du Golfe (1991 et 2003) n'auraient pu avoir lieu sans la capacité de se déployer et de se maintenir des flottes occidentales. Ces exemples montrent bien, s'il est besoin, que de telles actions navales ne sont à la mesure que de nations riches et développées.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Michel MOLLAT DU JOURDIN : directeur de l'Institut d'économie des transports maritimes, Arcueil
Classification
Médias
Autres références
-
AMIRAL
- Écrit par Ulane BONNEL
- 538 mots
Venu du mot arabe amīr ou emīr (chef), le terme « amiral » désigne dès le xvie siècle, selon Jal (Glossaire nautique, 1848), « le chef des flottes, des armées et de la police navale d'un État ». Il s'applique, d'une part, à celui qui est revêtu de la charge d'amiral, d'autre part, à celui...
-
AZTÈQUES
- Écrit par Rosario ACOSTA NIEVA , Alexandra BIAR et Mireille SIMONI
- 12 581 mots
- 22 médias
...l’importance de la flotte aztèque, estimée par les premiers chroniqueurs espagnols entre soixante et soixante-dix mille pirogues, en faisait une véritable puissance navale. De plus, nombre de témoignages relatent les guerres menées par cette flotte pour assujettir les villages riverains à Tenochtitlán. Mais... -
BREST
- Écrit par Jean OLLIVRO
- 1 068 mots
- 2 médias
-
GUERRE MONDIALE (PREMIÈRE) - Mutineries et désobéissances collectives
- Écrit par André LOEZ
- 2 955 mots
- 2 médias
...protestations se multiplient pendant l’été de 1917. Deux des matelots arrêtés, Albin Köbis et Max Reichpietsch, marqués par des idées de gauche, sont fusillés. Des mutineries de plus grande ampleur surviennent quelques mois plus tard dans la marine austro-hongroise, sur la base navale de Cattaro (Kotor, aujourd’hui...
Voir aussi
- MIGRATIONS HISTOIRE DES
- DISSUASION NUCLÉAIRE
- PACIFIQUE GUERRE DU ou GUERRE NIPPO-AMÉRICAINE (1941-1945)
- NORMANDS
- MARINE HISTOIRE DE LA
- ROYAUME-UNI, histoire, de 1914 à 1945
- NUCLÉAIRES SOUS-MARINS
- ESPAGNE, histoire : XVIe et XVIIe s.
- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, de 1865 à 1945
- JAPON, histoire, de l'ère Meiji à 1946
- PAYS-BAS, histoire, de 1579 à 1830
- GRANDE-BRETAGNE, histoire, les Tudors (1485-1603)
- GRANDE-BRETAGNE, histoire : XVIIIe s.
- GRANDE-BRETAGNE, histoire, de 1914 à 1945
- FRANCE, histoire, du Ve au XVe s.
- FRANCE, histoire, du XVIe s. à 1715
- FRANCE, histoire, de 1789 à 1815
- URSS, histoire
- POLYNÉSIENS
- FRISONS