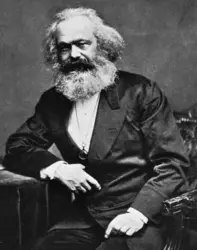MARXISME La théorie marxiste
Article modifié le
Si elle implique nécessairement des problèmes philosophiques, la théorie de Marx n'est donc pas un système philosophique. Il en résulte, d'abord, qu'elle n'est pas achevée et, d'autre part, que son exposé n'a pas de commencement absolu, ni dans son ensemble, ni dans telle de ses parties (par exemple, dans sa partie « économique », qu'expose Le Capital). D'où la fameuse réplique de Marx (à propos des guesdistes français) : « Ce qui est sûr, c'est que moi je ne suis pas marxiste... »
Mais cela ne signifie pas que la théorie de Marx ne soit pas systématique au sens scientifique, c'est-à-dire qu'elle ne définisse pas son objet d'étude de façon à en expliquer la nécessité objective. Ce qui confère à cette théorie son caractère systématique, en ce sens, c'est l'analyse des différentes formes de la lutte des classes et de leur connexion. C'est la meilleure définition qu'on puisse en donner, si tant est que le contenu d'une science puisse être enfermé dans une définition.
Classes et luttes de classes
Dans le Manifeste, Marx écrit : « L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de luttes de classes. » Cette proposition doit être prise au sens fort : elle ne signifie pas que les luttes de classes ont été le principal phénomène qu'on puisse observer dans l'histoire ; ni même que les luttes de classes sont la cause profonde, plus ou moins directe, des phénomènes historiques. Elle signifie que les phénomènes historiques, qui sont la seule réalité de l'histoire, ne sont pas autre chose que des formes (diverses, complexes) de la lutte des classes. La précision apportée par Marx : « jusqu'à nos jours » – précision qu'on peut répéter aujourd'hui encore sans modification – ne signifie donc pas que la définition apparaîtrait partielle, inexacte, si l'on prenait en considération les « sociétés sans classes » qui ont précédé ou qui suivront l'histoire des sociétés « de classes ». Les sociétés sans classes ne révèlent pas (et ne révéleront pas) une réalité sociale plus profonde, plus générale que la lutte des classes, ou lui échappant (c'est généralement ce que l'anthropologie sociale va y rechercher), et par là même « sans histoire ». Les sociétés sans classes de l'avenir – dont les tendances de la société actuelle indiquent seulement certains traits – ne peuvent être que le résultat de la transformation de la lutte des classes sous l'effet de cette même lutte de classes. C'est pourquoi Marx et Engels ont toujours insisté sur le fait que les communautés primitives que découvrent la préhistoire et l'ethnographie n'ont rien de commun avec le communisme qui succédera au capitalisme comme mode de production et d'organisation sociales. L'analyse de tendances, qui est l'objet du matérialisme historique, ne peut consister, comme chez Hegel, à rechercher la vérité des fins dans l'accomplissement des origines.
Il importe de bien saisir ce point pour comprendre l'usage et la signification du concept de classe sociale dans le marxisme. En 1852, Marx écrivait à son ami Weydemeyer : « Ce n'est pas à moi que revient le mérite d'avoir découvert l'existence des classes dans la société moderne, pas plus que la lutte qu'elles s'y livrent [...]. Ce que j'ai apporté de nouveau, c'est de démontrer : 1o que l'existence des classes n'est liée qu'à des phases historiques déterminées du développement de la production ; 2o que la lutte des classes mène nécessairement à la dictature du prolétariat ; 3o que cette dictature elle-même ne représente qu'une transition vers l'abolition de toutes les classes et vers une société sans classes. » Cette déclaration, faite à une époque où cependant Marx n'avait pas encore élaboré le concept de survaleur ou plus-value, c'est-à-dire le concept de l'exploitation spécifiquement capitaliste, nous éclaire sur la nature du renversement, mieux, de la révolution théorique opérée par Marx dans l'usage du concept de classes sociales. Les économistes et les philosophes classiques avaient déjà développé une théorie de la division de la société en classes en fonction des sources de revenus et de leur rôle dans l'accroissement du « produit net ». Témoin Quesnay dans son Tableau économique : « La nation est réduite à trois classes de citoyens : la classe productive, la classe des propriétaires et la classe stérile », désignant respectivement les fermiers capitalistes, les propriétaires fonciers et le personnel d'État, enfin l'ensemble de la population occupée dans l'élaboration (artisanale, industrielle) des « matières premières » (cette classification est très proche, on le voit, de celle qui distingue aujourd'hui les secteurs « primaire », « tertiaire » et « secondaire »). La Révolution française avait déterminé une substitution générale des représentations de la société en termes de classes aux représentations fondées sur les ordres ou les états. Saint-Simon et les saints-simoniens généralisaient cette idée : « Avant la Révolution, la nation était partagée en trois classes, savoir : les nobles, les bourgeois et les industriels. Les nobles gouvernaient, les bourgeois et les industriels les payaient. Aujourd'hui la nation n'est plus partagée qu'en deux classes : les bourgeois et les industriels. » (Catéchisme des industriels.) Puis ils la radicalisaient : « L'exploitation de l'homme par l'homme, voilà l'état des relations humaines dans le passé [...]. Les hommes sont donc partagés alors en deux classes, les exploitants et les exploités. » (Exposition de la Doctrine saint-simonienne, 1829.) De son côté, Ricardo montrait que la distribution de la valeur produite entre salaires et profits (abstraction faite de la rente foncière) détermine une opposition d'intérêts, qui se résout toutefois dans le mouvement de l'accumulation. Mais, pour Marx, c'est la lutte des classes, avec ses effets historiques et ses tendances, qui détermine l'existence des classes, et non pas l'inverse. Autrement dit, les classes sociales ne sont pas des choses ou des substances (par exemple, une partie de ce « tout » qu'est la société, un sous-groupe de ce « groupe », une subdivision, etc.) qui entreraient ensuite en lutte. Ou, si l'on préfère, l'analyse historique des classes sociales n'est rien d'autre que l'analyse des luttes de classes et de leurs effets.
Ainsi, l' idéologie historique d'une classe (la conscience de classedu prolétariat, par exemple) n'est pas créée, élaborée, inventée par celle-ci à la façon dont la première psychologie venue s'imagine qu'un sujet (individu ou groupe) invente, consciemment ou inconsciemment, ses idées : elle est produite dans des conditions matérielles données en face de l'idéologie adverse et en même temps qu'elle, comme une forme particulière de la lutte de classes, et elle s'impose dans la société (elle existe tout simplement) avec le développement de cette lutte.
Par là, la théorie de Marx rend tout à fait caduc le débat traditionnel entre les tenants d'une définition « réaliste » des classes et ceux d'une définition « nominale » (est-ce que les classes sont des unités réelles ou seulement des collections d'individus rassemblés pour les besoins de la théorie d'après un ou plusieurs critères ?), c'est-à-dire le débat entre sociologues qui, tous, recherchent une définition des classes sociales « avant » d'en venir à l'analyse de la lutte des classes. En pratique, cette démarche correspond à une tendance fondamentale de l'idéologie bourgeoise qui cherche à montrer que la division de la société en classes est éternelle, mais non pas leur antagonisme ; ou encore que celui-ci n'est qu'un comportement particulier des classes sociales, lié à des circonstances historiques (comme le xixe s.) et idéologiques (influence du communisme) transitoires, un comportement à côté duquel on pourrait en imaginer et en pratiquer d'autres (conciliation...).
C'est pourquoi Marx peut écrire en toute rigueur dans le Manifeste : « La société bourgeoise moderne n'a pas aboli les antagonismes de classes. Elle n'a fait que substituer de nouvelles classes, de nouvelles conditions d'oppression, de nouvelles formes de luttes à celles d'autrefois. » Il faut lire au sens fort : de nouvelles classes, c'est-à-dire de nouvelles conditions d'oppression, c'est-à-dire de nouvelles formes de luttes.
On est conduit par là à la proposition fondamentale selon laquelle les classes sociales sont déterminées par leur rôle économique, ou plus exactement par leur place dans la production matérielle. Cette proposition est identique à celle-ci : l'ensemble des luttes de classes est déterminé, en dernière instance, par la lutte économique des classes, par la lutte des classes dans la production. Cela signifie que les classes sociales ne s'opposent pas en prenant parti pour ou contre des conceptions du monde, pour ou contre un statut juridique, pour ou contre des formes d'organisation politique, pour ou contre des modes de répartition de la richesse sociale, pour ou contre des formes d'organisation de la circulation des biens matériels, sinon à cause de la lutte des classes dans la production, et finalement en vue de cette lutte. Et cela, parce que c'est la lutte des classes dans la production qui entraîne l'existence matérielle des classes, leur « subsistance » : c'est la lutte de classe quotidienne menée dans la production par le capital qui fait du procès de travail un procès de production de survaleur (et, donc, de profit, qui n'en est qu'une fraction), base matérielle de l'existence d'une classe capitaliste ; c'est la lutte de classe quotidienne menée dans la production par les travailleurs qui assure, contre la tendance du capital au profit maximal, les conditions de travail et les conditions matérielles (notamment le niveau des salaires) nécessaires à la reproduction de la force de travail, à l'existence de la classe ouvrière.
Cette proposition, qui est la base de la théorie historique de Marx, est aussi pour lui la base de la tactique de la lutte de classe du prolétariat : elle en éclaire le point de départ et le point d'arrivée. Le point de départ : la lutte du prolétariat commence avec sa lutte économique et elle continue en permanence à se fonder sur elle. Le point d'arrivée : la lutte politique du prolétariat n'atteint son objectif qu'à la condition de se poursuivre jusqu'à l'abolition du salariat, du rapport capital-travail salarié qui est le rapport social de production fondamental. Les objectifs politiques sont le moyen de parvenir à ce but, qui en commande la mise en œuvre selon les conjonctures historiques (Misère de la philosophie ; Salaire, prix et profit ; Critique du programme de Gotha).
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Étienne BALIBAR : philosophe, professeur à l'université de Paris-I
- Pierre MACHEREY : maître assistant à l'université de Paris-I
Classification
Médias
Autres références
-
ABENSOUR MIGUEL (1939-2017)
- Écrit par Anne KUPIEC
- 898 mots
- 1 média
Utopie, émancipation, critique, politique – tels sont les termes qui peuvent qualifier le travail conduit par Miguel Abensour, professeur de philosophie politique, éditeur et penseur.
Miguel Abensour est né à Paris le 13 février 1939. Agrégé de sciences politiques, auteur d’une thèse d’État (...
-
ADLER MAX (1873-1937)
- Écrit par Raoul VANEIGEM
- 648 mots
Longtemps occulté par la prépondérance de l'idéologie bolchevique, le rôle de Max Adler, l'un des principaux représentants de l'austro-marxisme, s'éclaire d'une importance accrue à mesure qu'on redécouvre les tendances anti-autoritaires apparues dans l'évolution de la doctrine marxiste....
-
ALTHUSSER LOUIS (1918-1990)
- Écrit par Saül KARSZ et François MATHERON
- 4 571 mots
Références philosophiques et politiques majeures, les écrits de Louis Althusser comme ceux qu'il a inspirés exercèrent une forte emprise, bien au-delà de la France, de 1960 à 1978. La lente, la tragique agonie de l'auteur, le triomphe des idéologies libérales dans les pays capitalistes, la crise et...
-
ANTHROPOLOGIE
- Écrit par Élisabeth COPET-ROUGIER et Christian GHASARIAN
- 16 161 mots
- 1 média
Certes,la conception que se font les marxistes de l'histoire est différente de celle de Lévi-Strauss, mais, d'un côté comme de l'autre, les débats portent sur les mêmes problèmes fondamentaux, essentiellement celui de savoir quel statut et quelle priorité accorder aux systèmes symboliques. Même si,... - Afficher les 110 références
Voir aussi
- SOCIOLOGIE HISTOIRE DE LA
- PRODUCTION MODES DE
- CAPITAL CONSTANT & CAPITAL VARIABLE
- VALEUR AJOUTÉE
- CAPITAL ACCUMULATION DU
- PLUS-VALUE
- VALEUR LOI DE LA
- TRAVAIL PARCELLAIRE
- PRODUCTIVITÉ
- CONCENTRATION ÉCONOMIQUE
- MARCHANDISE
- SOCIALISATION, économie
- LUTTE DE CLASSES
- PENSÉE ÉCONOMIQUE HISTOIRE DE LA
- DURÉE DU TRAVAIL