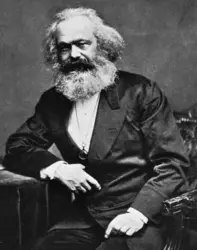MARXISME La théorie marxiste
Article modifié le
Capital et travail salarié
Dans cette perspective, il n'est pas difficile de déterminer ce qui constitue, selon l'expression de Marx lui-même, la « quintessence » de la théorie du mode de production capitaliste exposée dans Le Capital, et ce qui indique le lieu précis de la rupture opérée par Marx à l'égard de l'économie politique, de la sociologie et de l'historiographie bourgeoises : l'analyse de la survaleur (en allemand, Mehrwert, qu'on avait traditionnellement traduit par « plus-value », malgré le sens différent de ce terme en français).
Le mouvement du capital et l'origine de la survaleur
Ce qui définit le capital dans la pratique de l'économie bourgeoise, c'est la mise en valeur d'une quantité de valeur donnée. Toute somme de valeur n'est pas du capital, cela dépend de son utilisation : les valeurs thésaurisées ou consacrées à la consommation individuelle ne sont pas du capital. Il faut pour cela que la valeur soit investie de façon à s'accroître d'une quantité déterminée. Cette quantité constitue par définition la survaleur. En ce sens, la notion de survaleur est formellement présente dès qu'on se donne un capital quelconque : chaque capital individuel réalise pour son compte le même mouvement général, qui le définit, en dégageant de la survaleur et en se l'incorporant dans un processus qui, par définition, est sans fin. Selon une métaphore mathématique insistante, Marx appelle ainsi « survaleur » la différentielle d'accroissement du capital-argent.
Mais ce processus peut apparaître de façon différente selon les modes d'investissement (et, par suite, aussi selon les points de vue qu'ils définissent dans la pratique et la théorie économiques) : capital financier, capital commercial, capital industriel. La survaleur semble alors se dissoudre dans les différentes formes d'accroissement du capital : intérêt, bénéfice commercial, profit industriel, dont le mécanisme est en pratique tout à fait différent. Du même coup, le capital s'identifie à une forme particulière sous laquelle se présente sa valeur : argent, marchandises, moyens de production. Cependant, la forme « argent » est toujours présente et privilégiée : comme l'argent est l'équivalent de toutes les marchandises (y compris les moyens de production et le travail nécessaires au fonctionnement du capital industriel), il représente la valeur en soi, indépendamment des objets matériels auxquels elle est attachée. Or le mouvement du capital ne s'intéresse pas à ces objets, mais seulement à l'accroissement de la quantité de valeur. Le mouvement du capital apparaît donc essentiellement comme l'accroissement d'une quantité monétaire, une forme développée de la circulation monétaire.
Si l'on considère l'existence du capital à l'échelle sociale, et si l'on pose le problème de l'origine de la survaleur, il apparaît cependant que celle-ci ne peut résider dans la circulation marchande ni, par conséquent, dans les opérations spécifiques du capital commercial, ni dans celles du capital financier, bien que les formes de la circulation marchande, généralisée par le capitalisme, en soient apparemment l'essentiel. En effet, la circulation marchande et monétaire, à l'échelle de la société, est régie par la règle de l'échange entre valeurs équivalentes, qui préside à chaque acte individuel d'échange, à chaque contrat. Aucune valeur nouvelle ne peut donc être créée dans la sphère de la circulation. Le seul capital dont le mouvement peut créer de la valeur est donc le capital industriel, le capital productif, dont les opérations spécifiques se déroulent hors de la sphère de la circulation, et ne consistent pas en échanges, mais, une fois rassemblés les facteurs de production nécessaires (matières premières, moyens de travail, travailleurs salariés), consistent en transformation matérielle, c'est-à-dire en travail.
Il faut donc renverser notre première définition : le profit industriel ou commercial, l'intérêt (et également la rente foncière) ne sont pas des formes autonomes de l'accroissement du capital ; ce sont (y compris le profit industriel) des formes dérivées, transformées, de la survaleur sociale provenant de la sphère de la production. Chaque capitaliste industriel fonctionne ainsi, quelle que soit la part qu'il s'en approprie finalement, en faisant rendre de la survaleur au travail pour le compte du capital social tout entier, comme son représentant. L'autonomie apparente du profit, de l'intérêt, etc. ne provient que de la complexité des rapports concurrentiels qui rattachent les unes aux autres les différentes fractions du capital social, et qui se reflète dans les catégories de la comptabilité et de l'économie politiques bourgeoises. Pour en comprendre les lois, il faut d'abord percer le secret de la production de survaleur, puis découvrir les mécanismes de sa transformation dont la pratique économique ne révèle que les résultats.
Travail et surtravail
Le capital productif se divise alors en deux parties dont le rapport quantitatif varie : celle qui s'investit en moyens de production, qu'ils soient fixes ou circulants (machines, matières premières), consommés dans le procès de travail ; et celle qui s'investit en salaires, prix de la force de travail que le capital achète pour un temps déterminé. Marx appelle la première capital constant, la seconde capital variable. En effet, les moyens de production, qui sont le produit d'un travail passé et représentent une certaine quantité de valeur, ne peuvent par eux-mêmes introduire aucune valeur nouvelle. Plus précisément, ils transfèrent au produit leur propre valeur, au fur et à mesure de leur consommation productive (transformation, usure) par le travail. Inversement, le travail humain a la double propriété de conserver la valeur des moyens de production qu'il consomme, en la transférant au produit, et d'y ajouter une valeur supplémentaire en fonction de la quantité de travail dépensée (temps, intensité, nombre de travailleurs).
Cette théorie n'est rigoureuse qu'à la condition de définir le travail comme l'usage d'une marchandise particulière, la force de travail, que le capitaliste achète au travailleur. Définition conforme, précisément, aux conditions du mode de production capitaliste dans lesquelles (contrairement à ce qui se passe, par exemple, dans l'esclavage) le travailleur n'est pas lui-même une marchandise, achetée et vendue, mais apparaît (sur le marché du travail) en face du capitaliste comme le vendeur, le partenaire d'un contrat d'échange (force de travail contre salaire). Elle est masquée par la fiction juridique (mais fiction nécessaire, on va le voir) du salaire, qui présente celui-ci comme « prix du travail » proportionnel à la quantité de travail fournie (alors que le travail n'est pas, en fait, une marchandise).
La valeur d'une marchandise comporte donc toujours elle-même deux parties : l'une, qui est transférée des moyens de production dans le procès de travail et est proportionnelle à la quantité de travail passé nécessaire à leur production ; l'autre, qui est créée (ajoutée) par ce procès et proportionnelle à la quantité de travail présent – à condition du moins qu'il s'agisse dans tous les cas de travail socialement nécessaire, dépensé dans les conditions moyennes de productivité et correspondant à un besoin effectif de l'ensemble de la production sociale, ce qui n'est généralement vrai qu'en moyenne (la concurrence se chargeant d'imposer cette norme aux capitaux individuels comme « loi coercitive externe »).
Le mode de production capitaliste ne peut se développer que sur la base d'une productivité suffisante du travail (dépendant elle-même des progrès des instruments et techniques de production) : il a pour condition historique un état donné du développement des forces productives matérielles. Sur cette base, l'emploi du travail salarié a pour conséquence que la quantité de valeur nouvellement créée dans chaque procès de production excède la valeur de la force de travail elle-même. En d'autres termes, une partie seulement du travail dépensé est nécessaire à la reproduction de la force humaine de travail qui est utilisée (donc usée, consommée) dans le procès de travail ; le reste délivre, par rapport à ce travail nécessaire, un surproduit, il constitue un surtravail d'importance variable. En d'autres termes encore, une partie seulement de la valeur nouvellement produite représente l'équivalent des marchandises que le travailleur doit consommer pour reproduire sa force de travail, le reste constitue de la survaleur.
Quant à la valeur transférée aux produits par les moyens de production à proportion de leur utilisation, elle représente évidemment l'équivalent des nouveaux moyens de production qui doivent être acquis pour que le processus de production puisse continuer, donc pour que le capital puisse fonctionner comme tel ; le processus de production a pour condition l'appropriation permanente des moyens de production par le capital que son fonctionnement même reproduit.
Le « mystère » de la création de survaleur par le mouvement du capital n'a donc pas d'autre secret que l'ensemble des conditions techniques (productivité du travail) et sociales (forme du travail salarié) qui permettent au travail de créer une valeur excédant celle de la force de travail. La survaleur a donc une limite supérieure, constituée par la capacité de travail de la classe ouvrière, et une limite inférieure, représentée par la valeur de la force de travail à un moment donné. Le mécanisme de production de la survaleur, c'est le mécanisme des rapports de production capitalistes, c'est-à-dire le mécanisme qui oblige le travailleur à dépasser cette limite inférieure correspondant à sa propre reproduction et à repousser la limite supérieure de sa capacité de travail. C'est un mécanisme d'exploitation, c'est-à-dire de lutte économique de classes : lutte du capital assurant l'extraction de survaleur ; lutte des travailleurs préservant leur propre subsistance.
Les deux formes de la survaleur
Marx analyse séparément les deux formes typiques sous lesquelles cette lutte de classes se déroule en permanence : il les désigne comme production de survaleur absolue et production de survaleur relative.
La survaleur absolue (Le Capital, liv. Ier, sect. III) correspond à une productivité donnée du travail social, à une valeur donnée de la force de travail. Elle révèle tout simplement, sous une forme immédiate, l'extraction d'un surtravail qui est l'essence de l'accroissement du capital : contraindre le travailleur à dépenser sa force de travail au-delà des nécessités de sa propre reproduction, du fait qu'il ne dispose pas lui-même des moyens de production nécessaires. Le moyen fondamental pour y parvenir est l'allongement de la durée du travail, la fixation du salaire de telle façon que le travailleur ne puisse reproduire sa force de travail qu'en travaillant plus longtemps. Cette tendance apparaît isolément (ou comme forme principale) avec les débuts du capitalisme, mais elle continue de jouer sur la base de n'importe quelle productivité du travail social.
Elle suscite directement la lutte économique de classe des travailleurs pour la journée de travail « normale », qui s'efforce de contrecarrer la tendance à l'allongement de la durée du travail, y compris par des mesures légales (Le Capital, liv. Ier, chap. x). Mais la survaleur absolue a pour limite la préservation de la classe ouvrière elle-même. L'histoire montre éloquemment l'élasticité de cette limite, dès lors que la concurrence de la main-d'œuvre et sa faiblesse d'organisation rendent le rapport des forces défavorables à la classe ouvrière. Inversement, la résistance organisée de la classe ouvrière rend cette limite plus étroite. Elle contribue à orienter le capital vers une seconde forme de survaleur.
La survaleur relative (Le Capital, liv. Ier, sect. IV) a un principe inverse : l'augmentation du surtravail n'y est pas obtenue directement par prolongation du travail nécessaire, mais par la réduction de celui-ci, en faisant baisser la valeur de la force de travail, c'est-à-dire la valeur des marchandises nécessaires à sa reproduction. Ce résultat est obtenu par l'élévation de la productivité du travail qui est, en pratique, inséparable de l'accroissement de son intensité. L'analyse des « méthodes » diverses utilisées par le capital pour produire une survaleur relative met bien en évidence la solidarité qui, par-delà leur concurrence, réunit les différentes fractions du capital social dans le procès d'exploitation : chaque capitaliste accroît son profit individuel en augmentant chez lui la productivité du travail, mais il ne contribue finalement à la production de survaleur, sur laquelle sont prélevés tous les profits individuels, que dans la mesure où il contribue à abaisser ainsi la valeur des moyens de consommation de la classe ouvrière.
Les méthodes qui permettent ainsi d'élever la productivité du travail ne comportent pas, contrairement à l'allongement du travail, de limite absolue. C'est pourquoi elles engendrent le mode d'organisation de la production matérielle spécifique du capitalisme. Elles reposent sur la coopération, sur la division du travail poussée entre les individus (division manufacturière en attendant l'organisation « scientifique » du travail et le taylorisme), sur l'utilisation des machines remplaçant partiellement l'activité humaine (ou plutôt se la subordonnant) et sur l'application des sciences de la nature au procès de production. Toutes ces méthodes concourent à élever le degré de socialisation du travail, en remplaçant le travailleur individuel, autrefois susceptible de mettre en œuvre à lui seul les moyens de production, par un travailleur collectif, complexe et différencié. Elles présupposent la concentration des travailleurs, donc la concentration du capital à une échelle toujours plus grande. Elles généralisent la division du travail manuel et du travail intellectuel dans la production elle-même.
L'analyse de la survaleur relative illustre ainsi la théorie marxiste de la combinaison des rapports sociaux de production et des forces productives matérielles (qui incluent la force de travail humaine) : elle montre comment le capitalisme, qui suppose historiquement un état donné du développement des forces productives, détermine la transformation incessante, le développement nécessaire des forces productives comme moyen de produire une survaleur, comment il détermine une révolution industrielle ininterrompue (alors que l'idéologie bourgeoise représente volontiers la révolution industrielle comme une évolution naturelle dont le contenu ne dépend en rien des rapports de production capitalistes). Elle montre que le développement des forces productives est la réalisation matérielle des rapports de production capitalistes. Elle montre que, dans ce développement, c'est toujours la transformation des moyens de production qui précède et impose les transformations dans la qualité de la force de travail.
L'analyse de Marx révèle que le développement des forces productives dans le capitalisme, qui tranche avec le conservatisme relatif de tous les modes de production antérieurs, n'est pas un développement absolu ; il n'élève la productivité du travail social que dans les limites qu'impose à chaque capital la recherche du profit maximal. Cependant, ce développement ne comporte aucune borne supérieure au-delà de laquelle il ne pourrait se poursuivre, sinon en raison des contradictions que détermine en son sein le caractère antagonique des rapports de production, et qui alimentent la lutte de classes. Précisément, cette lutte y est présente sous de multiples formes qui sont indissociables de l'organisation technique du procès de travail lui-même : dans le mode de production capitaliste, le développement de la productivité de travail a pour conditions nécessaires l'intensification permanente du travail (les cadences infernales qui relaient l'allongement de la durée du travail), la parcellisation des tâches, la déqualification relative des travailleurs, l'aggravation tendancielle de la division du travail manuel et du travail intellectuel (qui assure au capital le contrôle absolu des moyens de production dans leur usage), le chômage technologique des travailleurs éliminés par la mécanisation, etc.
L'accumulation
Le mouvement du capital ne produit de la survaleur que pour se reproduire lui-même comme capital, et même se reproduire sur une échelle élargie. La reproduction simple du capital intervient lorsque la survaleur est tout entière consommée par la classe capitaliste de façon improductive. La reproduction élargie, l'accumulation du capital, est le véritable objectif de la production capitaliste. Elle en est en même temps le moyen, car seule elle permet la concentration du capital dont dépend l'élévation de la productivité, la survaleur relative.
En apparence, dans chaque cycle de production pris isolément, le capital et le travail proviennent de deux pôles distincts ; le capitaliste et le travailleur salarié, l'un et l'autre propriétaires d'une marchandise, concluent un contrat d'échange entre valeurs équivalentes (salaire contre force de travail). En réalité, dès qu'on considère la transformation de la survaleur en capital – le procès de reproduction du capital au cours de cycles de production successifs –, le capital se révèle constitué de survaleur accumulée ; le capital est du surtravail extorqué servant à l'extorsion d'un nouveau surtravail.
Marx écrit dans Le Capital (liv. Ier, chap. xxiv) : « Chaque transaction isolée respecte la loi de l'échange des marchandises exactement, le capitaliste achetant continuellement la force de travail, le travailleur la vendant continuellement (on admettra même qu'il l'achète à sa valeur réelle) ; dans cette mesure, la loi d'appropriation qui repose sur la production et la circulation des marchandises (ou loi de la propriété privée) se transforme manifestement en son contraire direct par sa dialectique propre, interne et inéluctable. L'échange d'équivalents qui apparaissait comme l'opération originelle s'est retourné de façon que l'échange n'a lieu qu'en apparence, tandis que, premièrement, la part du capital échangée contre la force de travail n'est elle-même qu'une part du produit du travail d'autrui approprié sans équivalent et, que, deuxièmement, elle doit être remplacée par son producteur, le travailleur, en y ajoutant un nouveau surplus. Le rapport d'échange réciproque entre le capitaliste et le travailleur n'est donc plus qu'une apparence appartenant au procès de circulation, une simple forme [...]. La séparation entre propriété et travail devient la conséquence nécessaire d'une loi qui, apparemment, découlait de leur identité. »
Les formes économiques de la circulation marchande et les formes juridiques bourgeoises (liberté, égalité, propriété individuelles), qui leur sont exactement adaptées, ne sont donc pas l'essence ou l'origine des rapports de production capitalistes, elles sont le moyen nécessaire de leur reproduction.
L'accumulation du capital est le phénomène tendanciel fondamental auquel se rattachent les lois économiques du mode de production capitaliste. C'est son rythme conjoncturel qui commande le rythme d'accroissement de la masse des salaires (et non l'inverse, comme s'efforce de le faire croire le capitaliste). Mais celui-ci ne dépend pas seulement du taux global de l'accumulation : il dépend surtout des transformations qu'elle entraîne dans la composition organique du capital, qui est par définition le rapport de sa fraction constante (valeur des moyens de production) à sa fraction variable (valeur de la force de travail). En tant qu'elle repose essentiellement sur l'élévation de la productivité du travail et les révolutions technologiques productives de survaleur relative, l'accumulation s'accompagne d'une élévation tendancielle de la composition organique moyenne du capital social, c'est-à-dire d'une disproportion croissante entre la fraction du capital (machines, matières premières) qui matérialise du travail passé – « mort » – et celle qui s'investit en travail vivant.
C'est pourquoi l'accumulation du capital produit un double résultat historique : d'une part, la concentration toujours plus grande des moyens de production, la concentration inéluctable du capital sous ses différentes formes ; d'autre part, la création, en permanence, d'une surpopulation relative des travailleurs, ou « armée industrielle de réserve », qui est la véritable loi de population de la société capitaliste, ce qui peut prendre diverses formes selon la conjoncture et les époques historiques : les différentes formes du chômage ouvrier, partiel ou total ; les différentes formes de surpopulation « latente » créées par le capital dans les campagnes et les pays coloniaux.
La conjonction nécessaire de ces deux effets – et leur explication – montre que la reproduction de la force de travail (donc la consommation des travailleurs, leur nombre, leur qualité) est un aspect de la reproduction du capital social. « Au point de vue social, la classe ouvrière est donc, comme tout autre instrument de travail, une appartenance du capital dont le procès de reproduction implique, dans certaines limites, même la consommation individuelle des travailleurs [...]. Une chaîne retenait l'esclave romain, ce sont des fils invisibles qui rivent le salarié à son propriétaire. Seulement ce « propriétaire », ce n'est pas le capitaliste individuel, mais la classe capitaliste [...]. Le procès de production capitaliste, considéré dans sa continuité, ou comme reproduction, ne produit donc pas seulement marchandise, ni seulement survaleur ; il produit et éternise le rapport social entre capitaliste et salarié. » Il n'y a donc pas d'autre moyen d'en pallier les effets que d'abolir ce rapport lui-même, en transformant la lutte économique de classe quotidienne, grâce à quoi la classe ouvrière assure sa survie, en une lutte politique de classes pour la transformation des rapports sociaux. Le capital en fournit lui-même les bases en concentrant la classe ouvrière et en aggravant son exploitation.
Plus généralement, Marx analyse (au livre II du Capital) les conditions d'ensemble qui permettent la reproduction du capital et son accumulation : reprenant et transformant certaines idées de Quesnay, il montre que ces conditions sont des conditions d'inégalité entre les investissements dans le secteur I du capital social (branches de production de moyens de production) et le secteur II (production de moyens de consommation), qui correspondent, à l'échelle sociale, à la division de chaque capital individuel en capital constant et capital variable. Karl Marx en esquisse l'étude mathématique en construisant les schémas de reproduction du capital social. Ce sont ces conditions qui, à la fois, permettent la réalisation de la survaleur (sa transformation en argent capitalisable), et font que chaque capital productif trouve sur le marché les facteurs matériels de sa reproduction. Elles impliquent l'avance permanente de la production des moyens de production sur celle des moyens de consommation : le fait que le secteur I du capital social constitue pour lui-même son principal marché, la production pour la production.
Mais ces analyses soulèvent des difficultés, dont la liaison interne n'a pu être aperçue que peu à peu, avec l'étude des phases successives de l'accumulation capitaliste et des conditions historiques de leur « régulation » économique.
D'une part, si la reproduction du capital définie chez Marx est bien globale, elle n'est cependant pas complètement analysée. La reproduction de la force de travail (où interviennent des institutions étatiques, mais aussi des rapports sociaux et idéologiques, familiaux, scolaires, etc., et enfin tout le système des inégalités entre formations sociales « développées » et « sous-développées », avec leurs effets de migrations et de surexploitation) n'est envisagée qu'à travers son résultat « comptable » : la valeur moyenne de la force de travail équivalente à la valeur des moyens de consommation produits. Les contradictions sociales, les aspects supplémentaires de la lutte des classes qu'elle comporte restent donc implicites. L'apparence se reconstitue, paradoxalement, d'une régulation automatique de la reproduction sociale.
D'autre part, la « réalisation » de la survaleur ne s'effectue jamais dans des conditions d'équilibre entre les deux « secteur », mais nécessite leur réajustement périodique, prenant la forme de crises. Quel en est le mécanisme ? Sur ce point, les marxistes se sont aussitôt divisés. Les uns (comme R. Luxembourg) ont repris l'explication par la « sous-consommation » des travailleurs inaugurée par Sismondi et en ont déduit la nécessité absolue pour le capitalisme d'une expansion « extérieure » (pillage colonial, conquête de nouveaux marchés). Si cette expansion ne peut se poursuivre indéfiniment (« puisque la Terre est ronde »), le mode de production capitaliste va vers une catastrophe finale. Les autres (tels Lénine et Hilferding) ont développé l'hypothèse inverse : celle d'un déséquilibre ou d'une « surproduction relative », structurelle, des moyens de production, conduisant aux formes du capitalisme de monopole industriel et financier. Dans les deux cas, l'articulation entre la base productive des crises et leur forme monétaire reste une difficulté permanente.
Les lois économiques du capitalisme
Du moins les « lois économiques » énoncées par Marx possèdent-elles deux caractéristiques remarquables : d'une part, ce sont des lois nécessaires, déduites du mécanisme fondamental de la production, et non pas de simples modèles des variations des grandeurs économiques définies au niveau de la circulation des marchandises et des capitaux ; d'autre part, ce sont des lois tendancielles, dont les effets sont contrecarrés par suite des rapports de production mêmes dont elles dérivent, et qui conduisent ainsi à des contradictions. Elles dépendent, dans leur réalisation, du développement historique de l'accumulation capitaliste (la concurrence des capitaux prend des formes différentes en fonction de leur degré de concentration, du développement inégal du marché mondial, etc.). Elles débouchent ainsi directement sur l'étude de l'impérialisme.
Les analyses qu'on vient de résumer constituent le cœur même de la théorie de Marx, où se concentre sa nouveauté révolutionnaire. Elles impliquent l'énoncé d'une série d'autres lois économiques, dont Marx a lui-même précisé qu'il n'avait pu, dans Le Capital, les étudier complètement, et qui apparaissent soit comme des présupposés, soit comme des conséquences de l'analyse du surtravail et de la reproduction du capital social.
L'analyse de Marx implique l'énoncé et la vérification d'une loi de la valeur. Cette loi est généralement énoncée comme loi de l'échange des marchandises à leur valeur, elle-même proportionnelle à la quantité de travail nécessaire à leur production. Cette formulation est cependant inexacte.
Marx a repris aux économistes classiques (A. Smith, D. Ricardo) le principe de la détermination objective de la valeur des marchandises par le temps de travail nécessaire à leur production. Mais les économistes classiques (y compris Ricardo) n'ont pas été en mesure de développer scientifiquement ce principe ; ils ont dû en revenir plus ou moins vite à d'autres principes d'explication, relevant de l'observation empirique de la circulation marchande (de la concurrence). Cette incapacité est liée à l'absence d'une analyse de la survaleur et des mécanismes de sa production comme sources des « formes transformées » du profit, de l'intérêt et de la rente, qu'ils cherchent à expliquer directement. Elle est liée à l'erreur (héritée d'Adam Smith) qui consiste à réduire, en remontant de proche en proche aux cycles de production antérieurs, la valeur de toute marchandise à du salaire et du profit, c'est-à-dire à du capital variable. Autrement dit, cette incapacité vient de ce que les économistes ne voient pas que la production capitaliste est production de marchandises et de valeur uniquement en tant que production de survaleur ; ils ne voient pas dans cette production le rôle des moyens matériels de production (capital constant) dont l'appropriation capitaliste reproduite en permanence permet seule de créer de la valeur, de dépenser du travail vivant en l'ajoutant au travail mort capitalisé. D'où la nécessité d'une « critique de l'économie politique » : c'est le sous-titre du Capital.
Dans la première section du Capital (liv. Ier), Marx fait l'analyse de la notion de valeur. Il montre la différence radicale entre les deux aspects de la marchandise : sa valeur d'usage (son utilité) et sa valeur d'échange. L'utilité sociale des marchandises (pour la production ou la consommation) renvoie aux caractères concrets (singuliers, incommensurables) du travail qui les produit et les transforme. La valeur d'échange renvoie uniquement au travail abstrait, c'est-à-dire à la quantité de force humaine dépensée dans la production et, en tant que telle, homogène, interchangeable. En second lieu, il distingue clairement la quantité de valeur des marchandises de leur forme de valeur, qui fait que, dans la pratique de l'échange, une quantité d'une marchandise donnée représente la quantité de valeur d'une autre marchandise. Cette distinction lui permet d'exposer une genèse logique des formes développées successives de la valeur, dont le terme est une théorie de l'argent, équivalent universel de toutes les autres marchandises, en qui la valeur semble se matérialiser « par nature » (ou bien « par convention »). La distinction de la valeur et de la forme de valeur permet ainsi de comprendre comment le prix des marchandises (leur équivalent en argent) peut différer quantitativement de leur valeur.
Mais cette explication n'est que formelle, au sens littéral du terme. Elle ne permet pas de comprendre pourquoi ni comment la valeur des marchandises détermine leur prix. Pour cela, il faut précisément considérer les marchandises en tant que produits de capitaux. C'est l'objet du livre III, sections I et II, où Marx montre la nécessité d'un taux général de profit qui soit le même pour tous les capitaux, aux fluctuations conjoncturelles près. En effet, des capitaux différents, investis dans des branches de production différentes, ont généralement des compositions organiques différentes ; et, comme seul le capital variable est producteur de survaleur, ils rapporteraient par là même, dans des conditions données d'exploitation de la force de travail, des profits très inégaux si les marchandises étaient vendues à leur valeur, si la survaleur produite par chaque capital constituait directement le profit qu'il s'approprie. Cette inégalité tendancielle entraîne la concurrence des capitaux, qui produit à son tour la péréquation des taux de profit et la fixation d'un taux général moyen. Les marchandises se vendent alors (sous réserve des variations individuelles du marché) non pas à leur valeur, mais à leur prix de production, obtenu en additionnant les coûts de production (prix des moyens de production, salaires) et le profit moyen. Mais il va de soi (bien que Marx n'ait pu véritablement développer ce point, d'une importance pratique considérable) que le mouvement des prix dépend directement des conditions dans lesquelles peut s'exercer la concurrence des capitaux, et se former le « profit moyen », conditions qui se transforment avec l'histoire du capitalisme. Il va de soi également que, au niveau de la société tout entière, la somme des valeurs reste toujours strictement égale à la somme des prix de production.
Sur cet axiome reposent toutes les théories marxistes de la « régulation » du procès de production capitaliste. Rien d'étonnant qu'il soit à la fois l'enjeu des rectifications (incorporant aux schémas d'explication de Marx une définition plus complexe de leurs conditions de validité historique) et des révisions (substituant à la détermination matérialiste de la valeur travail des postulats formalistes ou psychologistes d'« équilibre », d'« utilité » ou de « rationalité des agents économiques »).
On peut en rapprocher directement la loi de baisse tendancielle du taux de profit (Le Capital, liv. III, chap. xiii-xv), qui résulte de l'accumulation capitaliste même ; avec elle, la composition organique moyenne du capital social tend à s'élever en permanence. Et, par conséquent, même si le capital augmente sans cesse la masse du travail salarié en élargissant l'échelle de la production, en détruisant toutes les formes d'économie antérieures, il tend sans cesse à en diminuer l'importance relative, à faire baisser ainsi la survaleur en proportion du capital total investi (donc, le profit). Les différents moyens que le capital met en œuvre pour contrecarrer cette tendance historique se ramènent tous, en dernière analyse, soit à élargir le champ de l'exploitation, soit à intensifier celle-ci en compensant la diminution relative de la masse de survaleur par l'élévation absolue de son taux. Ils conduisent donc tous à l'aggravation et à la généralisation de l'antagonisme des classes.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Étienne BALIBAR : philosophe, professeur à l'université de Paris-I
- Pierre MACHEREY : maître assistant à l'université de Paris-I
Classification
Médias
Autres références
-
ABENSOUR MIGUEL (1939-2017)
- Écrit par Anne KUPIEC
- 898 mots
- 1 média
Utopie, émancipation, critique, politique – tels sont les termes qui peuvent qualifier le travail conduit par Miguel Abensour, professeur de philosophie politique, éditeur et penseur.
Miguel Abensour est né à Paris le 13 février 1939. Agrégé de sciences politiques, auteur d’une thèse d’État (...
-
ADLER MAX (1873-1937)
- Écrit par Raoul VANEIGEM
- 648 mots
Longtemps occulté par la prépondérance de l'idéologie bolchevique, le rôle de Max Adler, l'un des principaux représentants de l'austro-marxisme, s'éclaire d'une importance accrue à mesure qu'on redécouvre les tendances anti-autoritaires apparues dans l'évolution de la doctrine marxiste....
-
ALTHUSSER LOUIS (1918-1990)
- Écrit par Saül KARSZ et François MATHERON
- 4 571 mots
Références philosophiques et politiques majeures, les écrits de Louis Althusser comme ceux qu'il a inspirés exercèrent une forte emprise, bien au-delà de la France, de 1960 à 1978. La lente, la tragique agonie de l'auteur, le triomphe des idéologies libérales dans les pays capitalistes, la crise et...
-
ANTHROPOLOGIE
- Écrit par Élisabeth COPET-ROUGIER et Christian GHASARIAN
- 16 161 mots
- 1 média
Certes,la conception que se font les marxistes de l'histoire est différente de celle de Lévi-Strauss, mais, d'un côté comme de l'autre, les débats portent sur les mêmes problèmes fondamentaux, essentiellement celui de savoir quel statut et quelle priorité accorder aux systèmes symboliques. Même si,... - Afficher les 110 références
Voir aussi
- SOCIOLOGIE HISTOIRE DE LA
- PRODUCTION MODES DE
- CAPITAL CONSTANT & CAPITAL VARIABLE
- VALEUR AJOUTÉE
- CAPITAL ACCUMULATION DU
- PLUS-VALUE
- VALEUR LOI DE LA
- TRAVAIL PARCELLAIRE
- PRODUCTIVITÉ
- CONCENTRATION ÉCONOMIQUE
- MARCHANDISE
- SOCIALISATION, économie
- LUTTE DE CLASSES
- PENSÉE ÉCONOMIQUE HISTOIRE DE LA
- DURÉE DU TRAVAIL