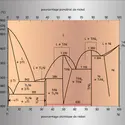MATÉRIAUX
Article modifié le
La deuxième génération
De notre analyse, on retiendra que l'ancienne substance renaît toujours>, en quelque sorte, de ses cendres : la pierre (par le biais des nombreux ciments), l'acier (la gamme des « spéciaux ») et surtout le verre (la moderne fibre optique) l'attestent. Tous connaissent un nouvel essor. Chacun de ces derniers se situe d'ailleurs à la naissance d'une famille arborescente : par exemple, on ne saurait oublier que le fer, allié au carbone (de 0 à 6 p. 100), suivant les proportions du mélange, offre une gamme illimitée de produits différents. Le plus connu reste la « fonte » (de 2 à 6 p. 100), qui peut être moulée. Si l'Anglais Darby en 1709 coule pour la première fois cette fonte, la France suivra plus tardivement : en 1722, Réaumur publia son célèbre ouvrage L'Art d'adoucir le fer fondu et de faire des ouvrages de fer fondu aussi fins que du fer forgé. En 1786, Berthollet, Monge et Vendermonde précipitent l'évolution technologique avec leur Mémoire sur le fer considéré dans ses différents états métalliques.
Impossible de photographier cette nébuleuse ! De plus, on alliera encore ces mélanges à d'autres éléments (nickel, manganèse, vanadium, etc.) ; on les transforme tous par de nombreux moyens (le recuit, la trempe, le revenu) ; on changera éventuellement leur surface, qui s'opposera à la fatigue ou à l'usure (cémentation, nitruration, carbonitruration). L'un des moyens de déterminer ces différents produits a été, en quelque sorte, emprunté à la biologie : la micrographie, la mesure de la grosseur des grains cristallins, l'examen tissulaire et la recherche des moindres discontinuités à la surface. Non seulement les « matériaux premiers et ancestraux » se différencient avec l'ère industrielle, mais il en surgit de nouveaux – comme les adhésifs, les réfractaires, les abrasifs, les élastiques (le caoutchouc), ainsi que tous les métaux non ferreux, la triade cuivre, aluminium et zinc. Les céramiques (du grec kéramikos, argile cuite) viennent de la cuisson à haute température du sable, du kaolin ou du feldspath – qui est un produit siliceux –, mais, au lieu de rester cantonnées comme jadis dans la vaisselle, la poterie ou la brique, elles alimentent des opérations ou des fabrications modernes. On exploite aussi bien leur résistance à la chaleur et aux chocs thermiques que leur possibilité ou d'isoler ou de favoriser une conductibilité élective (en effet, à l'égal des semi-conducteurs, des impuretés fourniront des électrons mobiles sous l'effet d'un champ électrique).
Cependant, nous ne dressons pas la liste des innovations. Mentionnons qu'aucun « ancien » ne disparaît vraiment mais que des inconnus ne cessent de les rejoindre. Ils forment les matériaux de la deuxième génération (les artificiels ou les vraiment synthétiques qui changent entièrement les questions d'approvisionnement, de confection et d'usinage). Ils ne se réfèrent plus à un modèle naturel mais résultent d'une néo-structure. Les plus notables – les modernes plastiques – déferlent et prennent partout le dessus. Ils sont appelés à tout investir (les fils ou les fibres, le bois, le cuir, d'où leur entrée dans les biens d'équipement, les moyens de transport et les carrosseries, le bâtiment, etc.). L'ingénieur décide de leur « texture » – linéaire, ramifiée, réticulaire ; il les fabrique à la demande et règle, en conséquence, leurs propriétés (inaltérabilité, légèreté, rigidité, résistance, couleur, forme, etc.). Leur découverte, comme leur expansion, s'opère toutefois avec lenteur : on n'entre en eux qu'à petits pas. Ces substances complexes, nées au début du xxe siècle principalement (elles relèvent de la jeune chimie du carbone, sont alors constituées de longues chaînes polymériques, parce qu'elles assemblent effectivement des unités appelées monomères), ramollies par la chaleur, peuvent être facilement « moulées » ou modelées. Les premières d'entre elles se bornent cependant à user encore de substrats végétaux ou animaux, qu'elles modifient plus ou moins (des semi-artificiels). La corne, par exemple, bouillie, pouvait alors être mise en forme et pressée : elle donnait aussi bien des « boîtes », des « tabatières » que des « broches ». De son côté, Goodyear, dès 1835, combinait au latex (caoutchouc naturel), sorti de l'hévéa, des quantités variables de soufre (la vulcanisation) qui lui conféraient plus de solidité, sans qu'il perdît sa souplesse ou son élasticité. L'ébonite (des coffrets encore, des bijoux) noire – qui contient davantage de soufre – accentue la dureté : on ne cesse pas d'amplifier le spectre des semi-synthétiques. La combinaison de la cellulose avec l'acide nitrique nous vaut le nitrate de cellulose, une molécule qui possède justement des particularités différentes de celles de la cellulose comme de l'acide nitrique (le coton fulminant). Plus tard, Pelouze et Ménard, par l'intermédiaire d'un solvant fait d'éther et d'alcool, transformeront encore cette nitrocellulose en un liquide sirupeux, le collodion, qui durcit lentement à l'air libre. Les médecins l'adopteront les premiers afin de panser les blessures et de protéger les plaies (le colmatage). On passera rapidement du collodion au celluloïd (collodion et camphre).
La route vers les « matériaux synthétiques » est ponctuée d'imprévus et de détours. Nous ne pouvons pas ne pas évoquer ici la démarche insolite du comte de Chardonnet qui le conduit vers « la soie artificielle » à la suite de fausses évaluations. Les élevages de « vers à soie » sont décimés par la maladie. On manque donc de leurs « fils ». Cet amateur s'imagine que le ver métabolise le bois, après dissolution de sa lignine, c'est-à-dire de la cellulose qui vient des feuilles, des tiges et de l'écorce qu'il dévore ; il en résulterait une sorte de substance pâteuse qu'il étirerait. En réalité, on ne va pas directement du bois à la soie. Les vers se nourrissent bien de l'arbre mais ils fabriquent eux-mêmes une protéine mucilagineuse (la fibroïne). Le comte de Chardonnet a cru à une transformation simple et directe : du même coup, il valorise la cellulose qu'il dissout, liquéfie et pourra « filer » (la soie Chardonnet, le précurseur de la rayonne moderne). On marche bien, avec ce premier nitrocellulosique, vers la viscose et, plus tard, le Nylon, les authentiques synthétiques.
Au début du xxe siècle, on peut abandonner les ressources naturelles qu'on dénaturait. Ainsi, Leo Baekeland crée le premier plastique véritable, la bakélite. Il part de l'acide phénolique et du formol, en présence de catalyseurs alcalins, d'où une sorte de gomme-laque, capable de remplacer des productions connues et diverses – comme l'onyx, la porcelaine, le marbre –, elle-même légère, résistante et semi-transparente. Les néo-produits, qui sont appelés à révolutionner la « science des matériaux » et ne cessent ni de s'étendre ni de pulluler, dépassent largement les ingrédients naturels ; ils allient généralement les contraires, telles la plasticité (on peut les mouler) et la dureté (ils résistent à la corrosion ainsi qu'à la déformation), ou encore la légèreté, la minceur et la ténacité. De plus, ils coûtent de moins en moins cher, se prêtent à tous les rôles ! L'un des plus connus, le P.V.C. (polyvinyl-chloride) que les Français ont parfois désigné C.P.V. ( chlorure de polyvinyle), vient de l'acide chlorhydrique agissant sur l'acétylène, en présence ou à l'aide de catalyseurs appropriés. Or l'acétylène lui-même se prépare par l'action de l'eau sur le carbure de calcium, lui-même, à son tour, obtenu au four électrique par l'action du carbone sur la chaux. On devine le faible « prix de revient » de la polymérisation du chlorure de vinyle (CH2 = CHCl). Il nous vaudra – parce qu'amorphe, inerte, malléable à souhait, souple et ferme – tous les tuyaux ou tubes qu'on souhaite, des gainages, des récipients, etc.
Le Nylon – autre classique et aussi peu cellulosique que le précédent –, mis au point en 1938 par Wallace Carothers, vient de la réaction d'un diacide (groupe carboxylique – COOH) sur une diamine (−NH2), pour donner un polyamide (−CO−NH), une polycondensation linéaire. On sait les étonnantes propriétés de cette première fibre de laboratoire : sa résistance à la rupture, son ininflammabilité, son infroissabilité, sa minceur extrême, son élasticité, sa résistance aux lavages répétés, son inaltération, son inertie chimique, etc. Le schéma visualise les phases de sa fabrication industrielle. Adieu aux fibres végétales ou à la laine des animaux ! L'usine nous inonde de ses fils toujours nouveaux. Toutefois, malgré sa diffusion généralisée et son déferlement, que de résistances ! « Il [lui et ses semblables] devint la matière de l'utilitaire, ou celle du pauvre, ou bien encore de l'homme sans goût, celle de celui qui ne peut ou ne veut accéder au noble, c'est-à-dire au vrai. Perdant toute valeur, le plastique a gagné la guerre du faux : fausses matières nobles, faux marbre, faux ivoire, fausse écaille, faux bronze, faux bois, faux textiles, laine, soie, velours, fausse fourrure. Pauvre nature à jamais rigidifiée sous la poussière depuis les faux gazons qui tapissent les terrasses des gratte-ciel de New York [...], les grappes inflétrissables et sans parfum que les années fanent sans flétrir des jardins d'hiver ou restaurants citadins impérissablement champêtres, aux légumes et comestibles divers en présentation à la devanture de tous les restaurants du Japon [...]. De toute façon, on le sait, le plastique, ça vieillit mal. Ça jaunit, ça s'écaille, ça se craquèle [...]. Par réaction, dans une volonté affichée d'opérer une réhabilitation, les décorateurs des années 1970 remettent en honneur les matières naturelles, le bois brut, la laine non traitée, le cuir sans teinture, dans le même temps que renaît l'intérêt pour la facture artisanale et que se répand le goût de la nourriture biologique » (H. Lassalle, « Plastique ad hoc, plastique pas toc », in Les Années plastiques, pp. 100 et 102).
Alors, est-ce l'échec ? Mais on oublierait que les artificiels ne cessent eux-mêmes d'évoluer et de perdre leurs défauts les plus criants, par exemple leurs couleurs trop vives, une sécheresse au tact, le jaunissement rapide, etc. On ne peut pas se dispenser d'eux, qu'il s'agisse d'écrire, de coller, de voyager. Impossible de revenir à la vieille tôle qui rouille et qui alourdit la voiture ! La littérature mène un combat, perdu d'avance. Notre critique – qui d'ailleurs ne participe pas à la croisade ni au flot des lamentations – note encore en vue d'une éventuelle réfutation : « L'acier, c'était grandiose. Un combat avec le feu. C'était noble, spectaculaire, imposant : les usines, les machines, les trains, les avions, les navires, les grues, les ponts, les gratte-ciel. » Mais n'oublions pas qu'à l'époque il en allait tout autrement. Les esthètes s'en plaignaient. Ils protestaient. Ils s'opposaient au machinisme. Ils allaient en appeler aux lignes florales, aux volutes, aux ondoiements, aux feuilles et aux animaux, à la biomorphie (l'Art nouveau à la fin du xixe siècle) – le style nouille et « l'école du coup de fouet », des ensembles aussi charmants que surannés.
Saine réplique : « Les créateurs inventent à nouveau des bijoux clinquants, voyants, cocasses ou ironiquement superbes, énormes et pourtant légers qui affichent avec ostentation le brillant de leur matière moulée. Les designers – Totem, Nemo – jouent sur l'asymétrique, le porte-à-faux, le spiralé, le torsadé. Ils combinent les surfaces zébrées, pointillées, mouchetées, mosaïquées, lisses et luisantes du plastique. Fi donc du bon goût, du bon chic-bon genre et bon aloi des matières naturelles ! [...]. Le Plastique permet toutes les audaces, toutes les provocations » (H. Lasalle, loc. cit., p. 103).
On ne peut pas se désintéresser de l'acceptation (ou du refus culturel) des matériaux. Le poète, l'artiste, doit nous familiariser avec eux ; le philosophe doit aussi fêter cette démiurgie. L'homme s'émancipe de ce qui le limitait (les ressources, leurs gîtes) et crée à volonté son univers, ce qui l'entoure. Le monde est devenu « notre fabrication ».
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- François DAGOGNET : professeur à l'université de Paris-I.
Classification
Autres références
-
MATIÈRE ET MATÉRIAUX. DE QUOI EST FAIT LE MONDE ? (dir. É. Guyon)
- Écrit par Bernard PIRE
- 914 mots
À partir du moment où la matière est destinée à une utilisation précise, on parle de matériaux. Mais comment raconter cette matière qui sous des aspects si divers accompagne le quotidien de chacun d'entre nous, pour s'alimenter, se loger ou s'habiller, mais aussi aller à la rencontre des autres...
-
ACIER - Technologie
- Écrit par Louis COLOMBIER , Gérard FESSIER , Guy HENRY et Joëlle PONTET
- 14 178 mots
- 10 médias
L'acier est un alliage de fer et de carbone renfermant au maximum 2 p. 100 de ce dernier élément. Il peut contenir de petites quantités d'autres éléments incorporés, volontairement ou non, au cours de son élaboration. On peut également y ajouter des quantités plus importantes d'éléments d'alliage...
-
ALLIAGES
- Écrit par Jean-Claude GACHON
- 7 363 mots
- 5 médias
Les alliages représentent une illustration matérielle du vieux dicton « l'union fait la force ». L'homme a toujours cherché des matériaux plus performants à l'utilisation, plus faciles à fabriquer ou à mettre en œuvre et plus économiques. Les alliages métalliques sont particulièrement...
-
AMIANTE ou ASBESTE
- Écrit par Encyclopædia Universalis , Laurence FOLLÉA et Henri PÉZERAT
- 3 490 mots
Aprèstransformation industrielle, l'amiante revêt de remarquables propriétés physiques et chimiques : résistance à la chaleur (plus de 1 000 0C, selon les variétés), à la traction et aux produits chimiques, notamment corrosifs. Près de trois mille produits contenant de l'amiante sont... -
AVIATION - Avions civils et militaires
- Écrit par Yves BROCARD
- 9 442 mots
- 21 médias
- Afficher les 45 références
Voir aussi