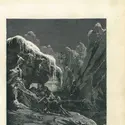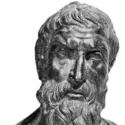- 1. L'hétérogène et l'homogène ou l'abstraction de la matière
- 2. La question des limites
- 3. Substance et apparence ; la transsubstantiation
- 4. Inertie et attraction ; les aventures de la quantification
- 5. Formes et forces ; la géométrie de l'invisible
- 6. L'idéalisation de l'espace cristallin ; un détour heuristique vers les structures moléculaires
- 7. De l'observation des molécules à la description de l'insaisissable ultime
- 8. Bibliographie
MATIÈRE
Article modifié le
L'idéalisation de l'espace cristallin ; un détour heuristique vers les structures moléculaires
De longue date, la distinction et l'identification des minéraux se faisait d'après leurs attributs organoleptiques ; le repérage de formes caractéristiques n'était que l'un des arguments d'une diagnose mal assurée dans la hiérarchie des critères. Cependant, à la fin du xviiie siècle, sur la voie de la reconnaissance d'espèces minérales (et non plus seulement de « sortes »), l'identification de formes cristallines bien prononcées fut, tout ensemble, l'occasion de retenir des repères de spéciation et de développer des théories cristallographiques cohérentes. L'idée décisive appartient à René Just Haüy, qui sut établir le passage entre régularités macroscopiques externes et arrangements internes. Plus précisément, il a développé l'hypothèse, peu auparavant esquissée par Romé de l'Isle, de l'existence d'une « forme primitive » propre à chaque espèce cristalline. En 1793, il propage la dénomination de « molécule intégrante » pour désigner le terme de la « division en petits solides, [...] passé lequel on arriveroit à des particules si petites, qu'on ne pourroit plus les diviser, sans les analyser, c'est-à-dire sans détruire la nature de la substance... ». Mais cette individualité minérale, si elle est morphologiquement fixée, peut ne pas être l'image exacte du cristal macroscopique ; elle n'en est que l'élément « moléculaire » dont la contiguïté ordonnée compose des aspects variables, mais déterminés. Les cristaux empiriquement observables d'une certaine composition chimique s'offrent à la vue sous diverses apparences qui résultent, le plus souvent, de troncatures sur les sommets et les arêtes de la forme complète et parfaite, dans laquelle cristallise l'espèce chimique examinée. C'est, précisément, en observant que l'apparente variété des aspects se range selon une distribution stoechiométrique en supposant que les contours perceptibles résultent de l'agrégation de modules, selon la loi dite des indices rationnels (analogue de la loi des combinaisons chimiques de Dalton), que Haüy se crut fondé à exactement modéliser les molécules intégrantes. Dans ses vues, les empilements successifs, éventuellement sujets aux restrictions locales des « décroissements », engendrent les formes possibles des cristaux d'espèces chimiques tant simples que composées. On atteint, en la circonstance, à un triomphe de l'art géométrique : dans l'imperceptible étoffe de la matière, il trace rationnellement la forme (non la dimension) de ses motifs constitutifs élémentaires.
Or cette analyse portait sur l'espace cristallin plus que sur la substance ; elle visitait des propriétés figurales, mécaniques, optiques ; elle demeurait assez indifférente aux énoncés de la chimie analytique. La belle assurance des cristallographes donna de l'humeur à des chimistes curieux de discuter des rapports de la forme à la matière. La molécule de Haüy apparut vite, et à juste titre, comme une détermination formelle de l'espèce chimique, à l'état pur, c'est-à-dire dans l'état limite visé par les moyens, toujours contestables, des purifications. La molécule intégrante humilia les fatigues du chimiste, en ce qu'elle se donnait comme critère dont la perfection est toute de raison et quasi nulle de fonction.
Pis, sa valeur heuristique en vint à être affaiblie par la mise en évidence de phénomènes irréfutables de di-, voire de polymorphisme : ainsi par exemple, selon les moyens de cristallisation, la chaux carbonatée apparaît en calcite ou bien en aragonite, sous des formes géométriques dont les symétries disparates appartiennent à des systèmes cristallins distincts. Le primat accordé à la forme cristalline, comme critère de spéciation, était ainsi déconfit par les résultats réitérés des analyses chimiques. Berzelius, qui avait élaboré en 1819 une ambitieuse synthèse de son interprétation électrochimique de la théorie atomique de Dalton avec la typologie cristallographique de Haüy, s'en éloignera peu après, impressionné par les vues de Mitscherlich sur l'isomorphisme et le polymorphisme des cristaux qui dénient mainte corrélation plausible entre composition chimique et forme cristalline. En un sens, le système de Haüy se trouvait défait par l'accumulation des données analytiques qui instruisaient progressivement sur les proportions selon lesquelles se combinent les corps simples de la chimie, dans la réalisation des composés définis. Il est à peine besoin de rappeler que l'un des résultats les plus marquants de l'immense enquête menée tout au long du xixe siècle par la collectivité des chimistes fut d'augmenter la collection des espèces distinctes, identiques par leur composition, prise au sens des proportions relatives de leurs constituants élémentaires.
Avant même que l'hypothèse « atomique » ne soit universellement reçue – elle est encore contestée à la fin du siècle –, les idées d'arrangements discriminateurs s'imposent aux chimistes. En 1843, dans sa Théorie des radicaux dérivés, A. Laurent proclame sans ciller que, « dans les corps inorganisés [...], la forme, le nombre et l'ordre sont plus essentiels que la matière » ; il est de ceux pour qui l'atome n'est pas une entité définie ; il a bien vu qu'« un même corps simple possède plusieurs équivalents », c'est-à-dire plusieurs possibilités de combinaisons, qu'on peut le doter de divers « nombres proportionnels » qui ont des rapports avec les notions modernes de « masse atomique » et de « valence » ; et, contre une partie de ses collègues, il soutient, à l'occasion, que « les atomes des chimistes ne sont pas des unités indivisibles, mais des groupes d'éléments plus petits disposés dans un certain ordre ». Son propos, sur lequel il n'y a pas lieu de s'étendre ici, serait recevable, selon les vues actuelles, si l'on substitue le terme de molécule à celui d'atome – puisque, aussi bien, savons-nous désormais que plus d'un élément, à l'état libre, est formé d'agrégats moléculaires plus ou moins condensés. Cependant, au cours du siècle, l'isolement et la différenciation de corps organiques isomères, de composition identique et de propriétés distinctes, engagèrent inévitablement à spéculer sur la forme des distributions corpusculaires invisibles, bref à inférer de propriétés macroscopiques, des propriétés structurales moléculaires.
Les « formules développées » de nombreux composés se sont révélées particulièrement fécondes en explicitant des caractéristiques topologiques qui eurent fréquemment une grande valeur explicative dans la description, voire la prévision de la réactivité des molécules. Une fois encore, par une pratique disciplinée de l'inférence, le travail scientifique a su structurer l'invisible de la matière. À cet égard, les synthèses organiques procurent un mode de validation incomparable ; toutefois, ces succès, qui parfois semblent naître d'un aménagement intuitif de représentations figurales des molécules, s'appuient, de fait, sur une intrication diachronique d'observations et d'expérimentations aux thèmes hétérogènes ; c'est de la corrélation de propriétés très distinctes, optiques et magnétiques, par exemple, que se nourrissent les énoncés valides de la science expérimentale portant sur la structure des molécules.
De même, c'est en raison d'une hybridation raisonnée de thèmes que le « paradigme » de la théorie de Haüy s'est trouvé aménagé, en quelque manière validé, après avoir essuyé les plus vives critiques. Si les chimistes ont pu déconsidérer la critériologie des « molécules intégrantes », ces dernières se sont trouvées réhabilitées du fait de l'affinement des descriptions de l'espace cristallin, lorsque leur empilement a été vu, c'est-à-dire conçu, comme le patron de « mailles » cristallines, dans une étendue réticulée, aux nœuds de laquelle étaient assujettis les éléments corpusculaires de la matière, distribués selon des modalités de symétrie en nombre fini. En fait, le système de Haüy souffrait de quelques contradictions qui relevaient, entre autres, de l'indécision où était son auteur sur les rapports entre le contenu des « molécules intégrantes » et leurs modes de répétition. Les progrès ultérieurs résultèrent, en 1850, de la théorie purement géométrique d'Auguste Bravais. De la cristallographie, celui-ci ne retient que la loi des indices rationnels qui caractérise, en particulier, les troncatures, et son travail consiste à définir toutes les opérations de symétrie compatibles avec cette loi. Du cristal immatérialisé il ne conserve ainsi que l'axiome d'homogénéité et le postulat d'une structure discontinue périodique qui résulte de la répétition d'un motif élémentaire. Autrement dit, Bravais se trouve amené à construire des « réseaux » tridimensionnels caractéristiques. Aux molécules de Haüy il substitue des essaims de points auxquels sont associés trois vecteurs représentatifs des distances entre points homologues. Les assemblages possibles se réduisent à quatorze modes réticulaires relevant de sept types de symétrie qui forment la base de l'univers cristallographique. En outre, considérant l'insertion d'un « motif » cristallin polyédrique, Bravais montra que sa symétrie est nécessairement égale ou inférieure à celle du réseau ; il en déduit des morphologies cristallines de symétries restreintes, conformes à l'observation empirique des mériédries. Par extension, son système aboutit à définir trente-deux classes de symétrie qui englobent, de fait, la totalité des figures de cristaux concrets. En 1891, indépendamment, Schoenflies et Fedorow perfectionnent ce cadre de référence en inscrivant dans les mailles les opérations limitées par Bravais au seul réseau ; ils en déduisirent deux cent trente groupes d'opérations possibles de symétrie. On arrivait ainsi, en cette époque, à déterminer la géométrie de toutes les transformations concevables de l'espace cristallographique. Mais, dans son aboutissement extrême, cette analyse demeurait tout abstraite ; elle n'informait aucunement sur la dimension des mailles et sur la disposition des corpuscules, atomes ou ions, qui les garnissent.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Jacques GUILLERME : chargé de recherche au C.N.R.S.
- Hélène VÉRIN : docteur ès lettres, chargée de recherche au C.N.R.S.
Classification
Média
Autres références
-
MATIÈRE/ESPRIT (notions de base)
- Écrit par Philippe GRANAROLO
- 3 374 mots
Alors que les sagesses orientales étaient toutes « monistes » (du grec monos, « unique »), autrement dit convaincues que le réel se réduisait à une unique dimension, les premières philosophies grecques ont choisi la voie du dualisme, opposant chacune à leur manière la matière à l’esprit,...
-
ÂGE DE LA TERRE
- Écrit par Pascal RICHET
- 5 145 mots
- 5 médias
Indépendamment du fait qu’elles divergeaient sur l’éternité du monde, sa création temporelle, ses formations et destructions périodiques,toutes les écoles grecques postulaient que la matière était éternelle. Très précocement, Parménide d’Élée (~vie-ve s. av. J.-C.) avait ainsi... -
ALCHIMIE
- Écrit par René ALLEAU et Encyclopædia Universalis
- 13 647 mots
- 2 médias
Or tout art est inconcevable sans unematière, et c'est pourquoi la notion d'alchimie « spirituelle » ou purement « psychologique » est aberrante, car elle méconnaît la fonction principale de l'alchimie : délivrer l'esprit par la matière en délivrant la matière elle-même... -
ARISTOTE (env. 385-322 av. J.-C.)
- Écrit par Pierre AUBENQUE
- 23 793 mots
- 2 médias
...l'illettré mourrait en devenant lettré, l'enfant en devenant adulte : thèse qui était celle de certains sophistes) : ce troisième principe est le substrat, ou matière, qui est ce qui subsiste sous le changement ; ainsi, l'argile n'en demeure pas moins argile en cessant d'être informe pour recevoir la forme... -
ATOMISME
- Écrit par Jean GREISCH
- 1 366 mots
- 4 médias
...l'atomisme de Démocrite, c'est aussi parce que cette hypothèse « immunise » le monde contre les incursions des dieux. L'atomisme implique l'existence d'une matière infinie, constituée par les atomes de taille, de forme et de poids différents, disséminés dans un espace infini, tout aussi éternel que ceux-ci.... - Afficher les 25 références
Voir aussi
- TRANSSUBSTANTIATION
- QUANTITÉ & QUALITÉ
- ATTRACTION UNIVERSELLE
- CRISTALLOGRAPHIE
- DIFFRACTION PAR LES CRISTAUX
- CRISTALLIN ÉTAT
- RÉSEAU, cristallographie
- ÉTENDUE, philosophie
- BENTLEY RICHARD (1662-1742)
- MODÈLE, physique
- QUALITÉS SENSIBLES
- ACTE & PUISSANCE, philosophie
- CHIMIE HISTOIRE DE LA
- IMMATÉRIALISME
- BRAVAIS AUGUSTE (1811-1863)
- MÉDIÉVALE PENSÉE
- GILLES DE ROME (1247 env.-1316)
- NICOLAS D'AUTRECOURT (1300 env.-env. 1350)
- LIARD LOUIS (1846-1917)