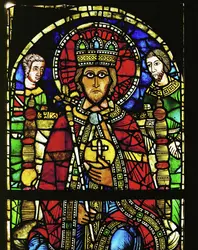MESSIANISME
Article modifié le
Typologie du messianisme
Les matériaux concernant les faits messianiques non chrétiens et chrétiens se présentent aujourd'hui encore en ordre dispersé et avec des contenus hétérogènes. Cependant cette sociographie descriptive suggère une certaine typologie du phénomène messianique qui pourrait se construire selon trois lignes essentielles.
Les personnages
Le personnage historiquement présent
Le personnage du Messie peut être soit prétendant, soit prétendu. Le prétendant à la messianité se réclame généralement d'un lien natif avec la puissance divine suprême, maîtresse de l'histoire universelle. Il est son père, sa mère, son fils, son épouse, etc. Ou encore, il apparaît, sous la forme d'un être redivivus, comme le dieu lui-même ou l'ancêtre divin. Dans tous les cas, la prétention personnelle à la messianité s'accompagne d'une certaine autodéification. Cette prétention peut être explosive (à la suite d'un songe, d'une révélation) ; elle est le plus souvent progressive : on est d'abord messager, envoyé, prophète de Dieu, et c'est peu à peu que la conscience de la mission se métamorphose en conscience de la messianité. Cette prétention, enfin, peut être exclusive (messianité d'un individu) ou partagée (messianité d'une lignée, d'une ethnie ou d'une ecclesiola).
Le Messie prétendu ne revendique pas lui-même son titre de Messie, qui lui est attribué soit par le cercle, soit par la postérité de ses disciples. À la limite, ce cercle ou cette postérité non seulement lui donnent le titre de Messie, mais encore lui confèrent ou lui inventent son historiographie ou son historialisation. Le plus souvent, cependant, cette attribution subséquente se greffe sur un personnage historiquement présent mais dont la conscience n'était encore que celle d'un être chargé d'une mission divine, sans prétendre lui-même à la conscience proprement messianique. La conscience collective précède ainsi et catalyse la prétention de la conscience individuelle à la messianité. L'individu est d'abord Messie prétendu avant d'être prétendant.
Le personnage historiquement absent
Il existe des cas où le phénomène messianique repose soit sur une historicisation subséquente, soit sur une sublimation perspective ou rétroactive. Souvent alors, le personnage messianique ne se laisse définir et désigner que par la présence de l'antipersonnage ou Antimessie (Antichrist) ou même par l'imminence et la surabondance des événements qui constituent un antitype du royaume messianique (thème du « débordement de la coupe »). Mais on trouve également d'autres « formules » relativement fréquentes selon les types de messages messianiques. Elles représentent, pour ainsi dire, un calcul des degrés de l'absence et peuvent prendre, par exemple, les expressions suivantes : le personnage est venu mais personne ne le connaît ; à la limite, il ne se connaît pas lui-même. Il est venu mais il demeure caché, seuls quelques-uns le connaissent. Il n'est pas encore venu mais il est imminent (attente et supputations concernant la mère). Il est venu mais il est reparti et il attend pour reparaître. Il est là, il attend, mais ceux pour qui il est venu ne veulent pas le reconnaître. Il est définitivement ailleurs mais sa place doit demeurer libre et personne ne saurait l'occuper, etc.
Les vicaires du personnage
Entre la présence ou l'absence radicalement différenciées, il y a place pour bien des solutions intermédiaires. Elles peuvent se regrouper autour de la conception d'une présence vicariale, antécédente, concomitante ou subséquente. Les types de personnages les plus fréquemment rencontrés sous cette rubrique sont les suivants : le prédicateur-ascète itinérant qui se hissera ou sera hissé jusqu'à la conscience messianique sous la pression de la conscience et de l'effervescence collectives ; le prophète ou simplement la prophétie ; le précurseur ; l'allié consentant (généralement un lieutenant habilité à être le bras séculier de la démarche messianique) ; l'allié malgré lui (le fléau de Dieu) ; enfin le pontife théocrate.
Les règnes ou les royaumes messianiques
Même si ces nouveaux règnes impliquent toujours un lien entre des facteurs religieux et des facteurs sociaux également nouveaux, ils peuvent être caractérisés par la prédominance de tel ou tel niveau d'intérêt.
Le messianisme peut être dominé par un projet de réforme religieuse, ecclésiologique ou culturelle ; mais ce projet s'accompagne d'une abstention ou d'une « grève » socio-religieuse plus ou moins radicale à l'égard du monde existant, au moins vis-à-vis des « cultes » dominants. On en vient même parfois à la vente de tous les biens et au refus du travail, comme dans l'expectation adventiste primitive ; le plus souvent, on se retranche dans une vie « hors du monde » en fondant des conventicules.
Le règne peut prendre un aspect principalement politique. L'établissement de dynasties, l'achèvement de régimes ou même l'éclosion des nationalités s'accompagnent fréquemment de spéculations et de dimensions messianiques ou paramessianiques, qui s'observent, par exemple, dans l'histoire de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Pologne ou de la Russie. Ce phénomène rejoint et prépare l'attribution de droits divins à l'autorité politique, ainsi qu'on le voit par l'histoire des religions.
Dans d'autres cas, on rencontre un messianisme économico-social. En effet, l'histoire des révoltes sociales, comme celle des nationalités, manifeste souvent une affabulation messianique. On a même prétendu que la révolution soviétique elle-même aurait reposé sur un phénomène de ce genre ; cette corrélation est particulièrement claire lorsque la révolte sociale se conjugue avec la lutte pour l'indépendance nationale. Ainsi en est-il des messianismes contemporains dans les pays sous-développés d'Océanie ou d'Afrique.
Le nouveau règne est souvent conçu, selon une perspective sexuelle et familiale, comme étant celui où il n'y aura plus « ni homme ni femme ». Cette conception donne à son tour naissance à des variantes dans les régimes proposés : ascétisme monastique ou néo-manichéen, affinitarisme libertaire ou combinaisons mixtes avec des prescriptions variables portant sur l'endogamie, l'exogamie, la polygamie (mormons) ou le mariage plural (onéidistes) ; à la limite, affabulations sur l'androgynie.
L'ambition du nouveau règne peut aller jusqu'à des visées naturistes et vouloir affecter des régimes encore plus fondamentaux ; régimes de la consommation alimentaire (tabous ou antitabous de tels ou tels aliments) ou vestimentaires (adamites, doukhobors, naked cults) ; régime de reproduction (fréquence du thème des vierges mères) ; ou même régime de la mort et de l'immortalité (métempsycose, résurrections successives, autorité du personnage ou de l'antipersonnage redivivus).
Le nouveau règne peut enfin prendre une signification cosmique et s'étendre au monde végétal, animal et astral, en rejoignant les prédictions poétiques, profanes ou sacrées de l'Âge d'or : économie d'abondance, paix universelle, modification des climats, redressement de l'axe terrestre, nouveaux rapports des vivants et des morts, etc. À ce stade, la sociologie du messianisme rejoint la sociologie de l'utopie.
Cette diversité de niveaux est cependant traversée par un trait à peu près constant : celui du retour ou de la répétition. Le nouveau règne messianique est une réédition en avant d'un régime plus ou moins identique expérimenté en arrière. Cette référence peut concerner une fondation antérieure : celle, par exemple, du christianisme dit primitif, celle d'une période économico-sociale d'avant les catastrophes déplorées, celle d'un monde originel (paradis perdu) ou celle du monde, submergé par la colonisation ou les guerres, des ancêtres vertueux et indépendants. Il est rare que, dans sa nouveauté même, le règne messianique n'en appelle pas du présent à un passé lointain, inconnu, oublié ou inconscient pour fonder son projet d'avenir. Il n'évoque un point oméga qu'en invoquant un point alpha.
Les supputations
Les deux typologies précédentes se retrouvent et se redistribuent dans quelques classifications communes aux « personnages » et aux « royaumes ».
Messianismes et millénarismes
La conscience messianique surgit souvent dans le milieu historique et social avant de se cristalliser sur un personnage et, a fortiori, avant d'être entérinée ou revendiquée par celui-ci ; et il y a tant de manières d'être un personnage divin (envoyé de Dieu, homme de Dieu, descendant ou ascendant de Dieu) que, souvent aussi, par une connivence ambiguë, un même titre peut recouvrir des significations totalement différentes aux yeux de l'initiateur ou de ses adeptes. Mais, d'une part, le contexte millénariste peut demeurer en deçà du messianisme : tantôt le personnage ne surgit pas, tantôt, s'il surgit, il fait lui-même obstruction à la qualification messianique, ou bien il en obtient le transfert à une entité suprahistorique, se cantonnant personnellement dans la fonction de précurseur. D'autre part, le surgissement du personnage peut précéder la nostalgie milléniale, voire la provoquer, et ainsi ce dernier trouvera ou non audience, risquant encore, s'il y réussit, d'achopper sur une distorsion entre l'émission et la réception des messages. Les relations entre le personnage et le royaume n'obéissent pas à une logique unilatérale : elles sont complexes, variables et la plupart du temps réciproques.
Prémillénarisme et postmillénarisme
La distinction entre prémillénarisme et postmillénarisme alimenta des controverses copieuses. Elle connote approximativement deux caractéristiques concernant respectivement un processus social d'intervention et une conception théologique de la grâce.
Dans le prémillénarisme, le royaume de Dieu intervient ex abrupto par un processus révolutionnaire, rompant la chaîne des causalités naturelles et historiques, visitant le monde par une véritable effraction pour le désintégrer en le réintégrant ou non à un niveau plus ou moins proche de l'ici-bas ou de l'au-delà. D'autre part, cette intervention est le fait d'une initiative caractérisée par une other worldness (miséricorde ou colère) ; sans elle, l'action de l'homme ne peut rien pour le royaume millénial ; elle vient avant (pré), lui, et seule elle le rend possible.
Dans le postmillénarisme, le royaume de Dieu s'instaure progressivement par un processus évolutif qui s'intègre dans l'enchaînement des faits historiques (sociaux et ecclésiastiques) et oriente le monde, selon la logique interne de son évolution sociale et religieuse, vers un point de maturité où il portera le royaume millénial ou messianique ainsi qu'un arbre porte un fruit. En second lieu, l'action de l'homme, religieusement animée et contrôlée, non seulement ne s'oppose pas à cet avènement ultime mais elle est de nature à en accélérer le rythme : en tout cas, le millenium vient après (post) cet effort humain collectif, qui est une de ses conditions préalables.
On pourrait également ajouter : ce que le prémillénarisme attend d'une descente de haut en bas dans l'espace, le postmillénarisme l'escompte d'une progression de bas en haut dans le temps. Pour l'un et pour l'autre, cependant, l'Âge d'or est en avant.
C'est sans doute en pensant à leur dimension commune – le millenium comme Eden en avant de l'histoire humaine – qu'Ernest Lee Tuveson s'est efforcé d'y discerner une source théologique – avant l'acculturation – des philosophies ou des théosophies du progrès. Encore conviendrait-il de distinguer entre les deux filières de l'acculturation et de se demander : si les théories optimistes et linéaires du progrès continu trouvent, en effet, leur arrière-plan (background), comme le propose Tuveson, dans des postmillénarismes peu à peu sécularisés, les prémillénarismes ne seraient-ils pas, eux aussi, de nature à fournir, moyennant leur propre sécularisation, un arrière-plan à certaines pratiques pessimistes et tranchées d'une révolution discontinue ?
Micromillénarisme et macromillénarisme
Le projet de renouvellement – « cieux nouveaux et terres nouvelles » – spécifique du règne messianique peut affecter de deux manières le régime socio-religieux établi : ou bien, il agit au maximum sur l'ensemble, et éventuellement de l'intérieur de ce régime, de façon à le transformer en royaume de Dieu, les armes de ce macromillénarisme pouvant d'ailleurs, selon les cas, être non violentes ou violentes ; ou bien, au contraire, en se distinguant le plus possible du régime, il forme à l'extérieur de celui-ci une micro-société qui, pour être exiguë, n'en prétend pas moins à être globale. Si l'on prend comme exemples le macromillénarisme de la théologie münzérienne et le micromillénarisme des sociétés shakers, on voit que dans les deux cas il s'agit bien d'un « royaume de Dieu » dans la catégorie de l'immanence, mais, dans le premier, il s'agit de la société elle-même à transformer en théocratie et dans le second, d'une société théocratique en marge d'une société jugée comme rédhibitoirement non transformable. Cette opposition fut peut-être celle qui différencia messianisme essénien et messianisme zélote, messianisme chrétien paulinien et messianisme juif de Bar Kokhba, ou, ultérieurement ce qu'il y a de millénarisme dans le manichéisme et ce qu'il y a de manichéen dans le messianisme mazdakite.
Violence et non-violence
Il est assez rare de ne pas déceler, même dans les micromillénarismes, une intention d'absorber finalement, par la logique même de la non-coopération, la société dans les marges de laquelle le mouvement s'inscrit. Réciproquement, on trouve assez souvent dans un macromillénarisme la constitution d'un corps minoritaire sélectionné, soumis à une discipline propre et destiné à actionner ou contrôler la transformation projetée : Joseph Smith, apôtre de ce macromillénarisme qu'est le mouvement des mormons ou Église des saints du Dernier Jour, avait, par exemple, un corps apostolique, une garde et même une police secrète. Thomas Münzer avait également constitué une ligue de ce genre. Aussi bien, le principe de la « minorité agissante » se retrouvant ici ou là, une distinction supplémentaire peut être relevée dans la nature des moyens, violents ou non violents, mis en œuvre par telle ou telle minorité.
La tradition millénariste des moyens violents peut se réclamer d'une longue tradition. Sans remonter jusqu'à Bar Kokhba ou aux divers messies militaires des guerres juives, le chiliasme médiéval fournirait un bon échantillonnage de messies ou pseudo-messies prêchant l'inauguration du royaume dans un bain de sang « jusqu'au poitrail des chevaux » ; il est vrai que l'antichiliasme représenté par l'appareil inquisitorial ne se signalait pas non plus par une particulière douceur. Norman Cohn a exhumé le projet indubitablement millénariste d'une Fraternité de la croix jaune qui donne, avec des analogies stupéfiantes, un avant-goût de sa postérité, le parti de la Croix gammée. Plus tard, la Ve monarchie (Fifth Monarchy Men) se signala comme organisatrice d'émeutes et de conspirations. Et cet authentique chiliaste que fut W. Weitling ne rêvait-il pas d'ouvrir les prisons et de convier les criminels libérés à l'extermination du désordre existant ?
La tradition non violente est pour le moins aussi ancienne et aussi continue. Son arme est la non-coopération, forme quasi ontologique d'une grève gestionnaire qui peut entamer plus ou moins profondément les dispositifs biologiques, moraux, cultuels ou culturels de l'environnement. Le refus de la manipulation de la monnaie en est une des formes les plus régulières (y compris la forme du frater bursarius chez les fraticelles). Mais il en est d'autres qui caractérisent cette tradition : refus de la nourriture carnée, de la reproduction, du mariage, du commerce, de la médecine, de la production industrielle ou du voisinage des villes, refus du culte ecclésiastique et d'un clergé ministériel, des tribunaux et du serment, du service militaire, de l'impôt, de l'électorat et de l'éligibilité, de l'alcool et du tabac, etc. Il n'est pas un de ces refus qui ne soit l'envers négatif dont une structure ou un régime positifs entendent constituer l'endroit par la découverte ou la redécouverte d'un mode de vie jugé édénique ou chrétien primitif.
De ces quelques codifications grossières suggérées par la population messianiste ou messianisante, il convient de souligner encore les limites et la relativité. En effet, malgré l'intensité des explorations et des compilations, une inconnue subsiste toujours, qui peut être une infraction à la règle cartésienne des dénombrements entiers. On n'est jamais certain d'un tel dénombrement, non seulement en raison de la multitude ou de la difficulté des sources, mais aussi parce que les faits messianiques sont de ceux qui sont le plus facilement transformés par la mémoire collective : en effet, s'ils peuvent être créés ou promus par cette mémoire collective, ils peuvent être aussi refoulés ou éliminés par elle. Ainsi, devant une aire culturelle ou une phase historique apparemment sans faits messianiques, comme d'ailleurs devant le fait d'une « combinaison messianique » sans réalité correspondante offerte à l'observation, se demandera-t-on toujours si ce « sans » est le fait d'une réalité initialement nulle ou bien d'une réalité finalement annulée.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Henri DESROCHE : directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales
- Roland GOETSCHEL : professeur des Universités, directeur du département d'études hébraïques et juives de l'université de Strasbourg-II, professeur associé à l'Université libre de Bruxelles
Classification
Média
Autres références
-
AMÉRIQUE LATINE - Les religions afro-américaines
- Écrit par Roger BASTIDE
- 3 176 mots
- 1 média
...culte protestant, de traits culturels africains antérieurs. On ajoutera que, partout où les Noirs ont réagi à leur frustration sociale en inventant des messianismes, ils ont – exactement comme pour les messianismes, les prophétismes ou les millénarismes qui se sont multipliés en Afrique en réponse à la... -
CONGO RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU
- Écrit par Encyclopædia Universalis , Jules GÉRARD-LIBOIS , Henri NICOLAÏ , Patrick QUANTIN , Benoît VERHAEGEN et Crawford YOUNG
- 24 923 mots
- 13 médias
...résistance et la frustration s'exprimèrent par le biais des mouvements religieux et des cultes syncrétiques, qui fleurirent à profusion à travers tout le Congo. Les deux mouvements les plus connus furent l'Église kimbanguiste et le Kitawala. Le kimbanguisme naquit dans le Bas-Congo en 1921, lorsque le prophète... -
CRESPY GEORGES (1920-1976)
- Écrit par André DUMAS
- 1 093 mots
Méridional, malin certes, mais avec cette réserve enjouée, souvent plus attentive que bavarde, qui fait du Languedocien un homme chaleureux et toutefois difficile à circonscrire, le pasteur Georges Crespy a vécu toute sa vie à Montpellier. Extrêmement doué pour la parole, il a consacré une portion...
-
DERRIDA JACQUES (1930-2004)
- Écrit par Catherine MALABOU
- 3 353 mots
- 1 média
- Afficher les 27 références
Voir aussi