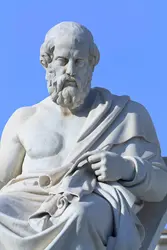MÉTAPHYSIQUE
Article modifié le
Actualité de la métaphysique
Hamelin, Husserl et Heidegger
Mais, de même qu'elle a résisté à la critique qu'en présentait Kant, la métaphysique survit à ses négations, marxistes ou positivistes. Il est de fait que la philosophie contemporaine est tout entière métaphysique, ou pénétrée de métaphysique. L'idéalisme d'Octave Hamelin est bien une métaphysique. On le trouve à la source de ce qu'en France on a appelé la « philosophie de l'esprit ». Hamelin, écrit René Le Senne, « enseigne expressément que rien ne peut s'introduire du dehors dans l'esprit, qui est tout et plus que tout ». Louis Lavelle réfléchit sur l'expérience de l'être qu'on peut trouver à l'origine de toute pensée. Gabriel Marcel essaie de cerner ce qu'il appelle le « mystère ontologique », et écrit un Journal métaphysique.
Les études de Husserl sur la « conscience donatrice originaire » et l'« intentionnalité » sont également métaphysiques. Et l'on sait quelle influence la phénoménologie de Husserl a exercée tant sur l'existentialisme allemand que sur l'existentialisme français : L'Être et le Néantde Sartre, la Phénoménologie de la perceptionde Merleau-Ponty sont bien des ouvrages de métaphysique.
Heidegger, il est vrai, s'efforce d'effectuer une remontée régressive vers les fondements de la métaphysique, fondements qu'il dit, de ce fait, non métaphysiques. Mais chercher les fondements de la métaphysique, explorer ce sol où plongent les racines de la métaphysique, ou, plus exactement, cette racine de tout savoir qu'est la métaphysique, c'est bien encore faire de la métaphysique. Soucieux du problème de l'être, Heidegger reproche sans doute à la métaphysique occidentale de l'avoir négligé. Cela revient à dire qu'il lui reproche de n'avoir pas été assez métaphysique, d'avoir hérité des préjugés d'une science réduisant le réel à un ensemble d'objets mesurables. Ce en quoi l'on peut penser que Heidegger méconnaît injustement le sens de l'être qu'avaient ses prédécesseurs. Mais on ne saurait nier que la pensée heideggérienne ne réponde au souci essentiel de la métaphysique.
Si donc, malgré les critiques dont elle est l'objet, malgré les attaques qu'elle subit de toutes parts, la métaphysique demeure vivante, il y a lieu de se demander ce qui lui assure cette vitalité. S'agit-il seulement de la permanence d'un besoin humain, de l'anxiété devant le mystère de la mort ou de la destinée ? Ou faut-il reconnaître à la métaphysique une valeur spécifique, telle que sa suppression ou son oubli entraîneraient une mutilation de l'homme ? La métaphysique se contente-t-elle de poser des problèmes ? Ou pouvons-nous découvrir une vérité en ses affirmations ?
Métaphysique et systèmes
Il faut d'abord en convenir : dans la mesure où elle prétend à la totalité, ou au savoir absolu, l'exigence métaphysique est en échec. Elle aboutit alors à la constitution de systèmes, et nul système n'a réussi à s'imposer. Ceux du xviie siècle ont engendré, chez les penseurs du siècle suivant, le scepticisme. Celui de Hegel a provoqué à la fois les protestations de Kierkegaard et les critiques de Marx. L'exigence métaphysique est exigence d'un savoir rigoureux, totalement démontré, et pouvant ainsi s'imposer à l'esprit de tous les hommes. Comment prétendre qu'un système puisse constituer un tel savoir, si les systèmes s'opposent entre eux, et si, au cours de l'histoire de la philosophie, les systèmes n'ont cessé de succéder aux systèmes ?
Mais il n'en faudrait pas conclure que l'échec des systèmes soit nécessairement l'échec de toute métaphysique. La croyance, fort répandue, selon laquelle il en est ainsi vient de ce que l'on a d'abord identifié esprit métaphysique et esprit systématique, ce que rien n'autorise à faire. On a même pu remarquer que, plus encore que métaphysiques, les systèmes sont cosmologiques, ou, avec Hegel, historiques : ce sont des systèmes de l'objet, et il ne peut y avoir, en effet, de systèmes que de l'objet. On tiendra donc les systèmes pour ce qu'ils sont : les fruits de l'ambition, inhérente à l'esprit humain, de connaître et de penser la totalité de l'univers. L'esprit construit alors des ensembles coordonnés d'hypothèses, ensembles dont on peut admirer l'architecture et la cohérence interne, mais qui demeurent inadéquats à la vérité.
Tout système propose un monde. L'exigence métaphysique est celle d'un au-delà du monde : c'est bien ainsi qu'elle est apparue chez Platon s'élevant aux Idées, chez Descartes prouvant Dieu, chez Kant remontant de la connaissance aux conditions a priori de la connaissance. Mais, si cette exigence ne trouve à se satisfaire dans aucun système, où donc découvrira-t-elle cet être vers lequel elle tend ? Celui-ci lui sera-t-il livré en une expérience privilégiée, en une expérience métaphysique ?
Métaphysique et expérience
On a rencontré, en effet, à côté des métaphysiques du système, des métaphysiques de l'expérience, telle celle de Bergson : ici l'intuition, abolissant toute distance entre le sujet et l'objet, prétend donner à l'homme le moyen de se placer au cœur même des choses. Et l'on pourrait soutenir aussi que ce que Spinoza appelle connaissance du troisième genre comporte une expérience immédiate de l'être.
On peut douter, cependant, de la réalité et, même, de la possibilité de telles expériences. Elles constitueraient, en tout cas, des sortes d'états exceptionnels et incommunicables, et, comme tels, étrangers à la philosophie. Comment saurais-je, en effet, en dehors des secours de la raison, que je suis en présence de l'Être ? Tout ce qui peut se présenter à moi comme expérience métaphysique est indiscernable de ce que serait pour moi l'illusion d'une telle expérience. En vertu de leur essence même, l'absolu et l'au-delà ne sauraient être expérimentés. Expérimenté, l'absolu deviendrait relatif ; expérimenté, l'au-delà ne serait plus que naturelle présence.
Mais on dira peut-être que, chez Descartes, la saisie du « je pense » ou la découverte de Dieu constituent des expériences métaphysiques. Il n'en est rien cependant. Chez Descartes, l'expérience saisit toujours un attribut, ou une idée, lesquels renvoient à l'être ou permettent de l'atteindre par voie de démonstration, sans qu'il y ait jamais coïncidence totale de la pensée et de l'être. Même au moment privilégié du cogito, la pensée que j'expérimente me renvoie à l'être de la chose pensante, à la substance dont elle est l'attribut. Quant à Dieu, il se manifeste en nous par son idée, à partir de laquelle il doit encore être prouvé. En sorte que si l'on peut parler, chez les grands rationalistes du xviie siècle, d'une sorte d'expérience métaphysique, il faut ajouter aussitôt que cette expérience constitue une sorte de limite, dont on peut se demander à bon droit si elle n'est pas celle où l'expérience proprement dite laisse la place à la position intellectuelle du concept qui rendra intelligible l'expérience elle-même. Il est, en ce sens, nécessaire de remarquer que toute expérience appelle un au-delà, par lequel elle se qualifie. Mais, de cet au-delà lui-même, on ne saurait avoir d'expérience. Et l'Être, s'il est le fond et l'horizon sur lequel se profile toute expérience, demeure, en sa substantialité, toujours transcendant.
Sur ce point, il faut donc s'en tenir aux sévères leçons du kantisme. Chez Kant, en effet, l'expérience ne saurait se définir qu'au niveau de la construction, par l'esprit, d'un donné sensible. Toute expérience est donc expérience du relatif, le sujet pur et l'objet pur, le sujet construisant et la chose non construite, demeurant par essence inaccessibles. La possibilité même d'une expérience métaphysique semble donc devoir être niée.
Métaphysique et démarche philosophique
Faut-il alors s'en tenir à l'idée que l'exigence métaphysique, si elle est fondamentale chez l'homme, ne saurait, d'aucune façon, être satisfaite ? C'est l'avis de tous ceux qui tiennent la philosophie pour la plus vaine des études, et estiment, avec Pascal, qu'elle ne vaut pas une heure de peine. Mais cette opinion désolante vient de ce que l'on se refuse toujours à comprendre ce qu'est la métaphysique, et quel genre particulier de savoir elle peut atteindre. En vain les philosophes répètent-ils, depuis Socrate, que leur savoir est un non-savoir. Nul ne se donne la peine de réfléchir à ce qu'ils veulent dire.
Pour essayer de le comprendre, il faut remarquer tout d'abord que, s'ils ne peuvent communiquer leur expérience la plus intime, et s'ils diffèrent par leurs systèmes, les philosophes manifestent, par la démarche qu'ils accomplissent, un remarquable accord. Ainsi Platon, décrivant le mouvement du prisonnier de la caverne qui se « retourne » et regarde en arrière pour apercevoir les Idées, Descartes, nous conseillant de mettre en doute le monde qui, d'abord, nous semblait évident pour nous « retourner » vers nous-mêmes, Kant, nous demandant de « retourner » de l'objet au sujet qui le constitue, Husserl, opérant la réduction phénoménologique en mettant le monde entre parenthèses, accomplissent bien un même mouvement. Et ce mouvement, qui est celui même de la métaphysique, consiste en une réflexion grâce à laquelle l'esprit, cessant d'être le prisonnier du monde objectif qui lui semblait d'abord la mesure de l'être, s'élève aux conditions a priori de ce monde lui-même.
Ce retour à l'origine et à la condition, ce retour à l'être constitue-t-il un savoir ? On peut l'appeler ainsi, mais il faut alors ajouter que ce savoir n'est métaphysique qu'autant qu'il ne dégénère pas à son tour en un savoir de type scientifique, ce qui précisément lui advient lorsque le philosophe présente un système. Car, il faut le répéter, un système ne peut être que cosmologique, et les philosophes du système ne nous arrachent à ce monde que pour nous en présenter un autre, composé, comme lui, d'objets. La leçon dernière et éternelle de la métaphysique, c'est que, si ce monde ne prend de réalité et de sens que par rapport à autre chose, cette autre chose n'est pas elle-même un monde. L'objet ne saurait être métaphysiquement expliqué à partir d'un autre objet, ni le monde à partir d'un autre monde. Sinon, la démarche métaphysique devrait être recommencée, pour que soit à son tour fondé et expliqué ce monde nouveau. Cela n'aurait point de fin.
Exprimant la réaction totale de la conscience humaine devant toute situation donnée, devant tout monde objectif, la métaphysique ne saurait nous conduire au repos. Son savoir est donc non-savoir, il est savoir de rien. Mais ce savoir, en apparence négatif, permet de juger tout autre savoir, de situer tout savoir constitué par rapport à l'Être, dont l'idée habite notre conscience. Aussi la vie philosophique recommence-t-elle toujours. La métaphysique n'est pas une science parmi les autres. En nous délivrant de tout dogmatisme, de tout fanatisme, de toute aliénation intellectuelle, elle nous enseigne que nulle doctrine constituée n'est à la mesure de l'être, que nulle science objective n'est, à proprement parler, ontologique, et que nulle connaissance ne contient elle-même son propre fondement.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Ferdinand ALQUIÉ : professeur honoraire à l'université de Paris-Sorbonne, membre de l'Institut (Académie des sciences morales et politiques)
Classification
Média
Autres références
-
AGNOSTICISME
- Écrit par Henry DUMÉRY
- 226 mots
Terme créé en 1869 par un disciple de Darwin, T. H. Huxley (1825-1895). Il devrait signifier le contraire de gnosticisme, c'est-à-dire le refus d'une connaissance de type supérieur (procédés d'explication suprarationnels). En fait, « agnosticisme » a eu à l'origine un sens précis :...
-
ALAIN DE LILLE (1128-1203)
- Écrit par Jean-Pierre BORDIER
- 1 036 mots
Né à Lille, élève de Bernard Silvestre à Chartres, Alain étudie dans la mouvance de Gilbert de la Porrée ; il devient maître ès arts, puis maître en théologie à Paris, avant d'enseigner à Montpellier ; parvenu au sommet de la gloire, il suit l'exemple de son ami Thierry...
-
ANALOGIE
- Écrit par Pierre DELATTRE , Encyclopædia Universalis et Alain de LIBERA
- 10 429 mots
Connue par les Latins avant l'œuvre d'Aristote, la théorie métaphysique d'Avicenne a introduit la problématique de la pluralité des sens de l'être sous une forme qui définissait d'avance les conditions d'intelligibilité de la métaphysique aristotélicienne en fondant la possibilité de toute métaphysique... -
ANGOISSE EXISTENTIELLE
- Écrit par Jean BRUN
- 2 552 mots
- 1 média
Expériencepsychométaphysique, l'angoisse naît donc d'une remontée au primordial ne permettant pas de redescendre le long de coordonnées chronologiques au centre desquelles nous nous retrouverions. Elle peut devenir un piège si nous la cultivons dans ces dolorismes ontologiques qui hypostasient... - Afficher les 114 références
Voir aussi