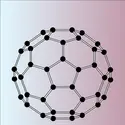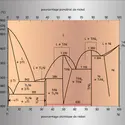MÉTAUX Métallogénie
Article modifié le
Dans une première approche et de façon résumée, on peut dire que la métallogénie est la science des gisements (ou gîtes) métallifères et de leur genèse. Le terme a été créé, au début du xxe siècle, par le géologue français Louis de Launay (1860-1938), pour qui : « La métallogénie étudie les gisements minéraux des éléments chimiques, leurs groupements et, spécialement, les concentrations anormales qui nous les présentent sous une forme industriellement supérieure à la moyenne et, par conséquent, utilisable [et] se propose de rechercher l'origine première de ces éléments et les phases successives de l'évolution qui les a amenés dans leurs gisements actuels, afin de déterminer les lois suivant lesquelles ces gisements doivent apparaître de préférence dans telle ou telle zone géologique, présenter telle ou telle disposition, telles ou telles modifications en profondeur, etc. » Cette science se propose donc de rechercher les lois qui ont présidé à la répartition, à l'association ou à la séparation des éléments chimiques dans les parties accessibles de l'écorce terrestre.
Cette première définition, qui fait bien ressortir les liens très étroits qui unissent la métallogénie et la géochimie, n'en est pas moins très générale ; aussi convient-on d'ordinaire de limiter le domaine de la métallogénie à l'étude des processus qui ont donné naissance aux concentrations anormales de substances chimiques minérales – donc aux gisements métallifères – à l'exclusion des cas où ces substances se rencontrent dans leurs proportions habituelles, c'est-à-dire celles qui correspondent aux teneurs moyennes desdits éléments chimiques dans l'écorce terrestre. Cette limitation, cependant, ne doit pas confiner la métallogénie à la seule étude des processus physico-chimiques de minéralisation ; il serait tout aussi vain de croire que la connaissance des seules associations paragénétiques et des successions subordonnées, qui caractérisent tels ou tels minerais donnés, est suffisante pour reconstituer les conditions de formation des gîtes correspondants.
À cet égard, les tendances des diverses écoles contemporaines coïncident en ceci qu'elles reconnaissent que les processus de minéralisation aboutissant à l'apparition de gîtes : « a) ne représentent que l'un des aspects d'un grand et unique processus, complexe, d'évolution de l'écorce terrestre ; b) sont, au cours de leur histoire géologique, étroitement liés aux autres aspects de ce grand processus, c'est-à-dire à la sédimentation, aux mouvements tectoniques (développement des structures), à l'activité magmatique et au métamorphisme ; c) ne peuvent et ne doivent être étudiés que dans leur cadre historique et en liaison étroite avec tous les autres aspects de cette évolution ». Cette dernière et impérative nécessité explique et justifie une classification « naturelle » non plus des phénomènes générateurs de gîtes, mais bien des « types » de gisements eux-mêmes dans leur cadre géologique.
L'une des branches, autonome, de la science des gîtes métallifères est la métallogénie régionale. Le principe en est de distinguer et de définir les zones, régions et grandes régions pouvant être minéralisées, et celles ne le pouvant pas, c'est-à-dire de rechercher, dans les premières, les indices caractérisant les secteurs les mieux minéralisés et découvrir les différents critères qui « règlent », qui contrôlent l'apparition et les conditions de mise en place des gîtes. Le mode de représentation le mieux adapté est la carte métallogénique. Y apparaissent notamment les divers contrôles des différentes minéralisations étudiées : ils serviront de « guides » le jour où l'on recherchera les types de gisements correspondants dans de nouvelles régions, plus ou moins éloignées des régions bien connues (dites de référence).
Ainsi, la métallogénie révèle la liaison existant entre la tectonique profonde (linéaments, blocs rhomboïdaux...), le magmatisme et les minéralisations (au moins géométriquement associées). Des exemples en sont connus dans le Massif armoricain, dans le sud et l'ouest de la Meseta ibérique, dans le Massif bohémien, aux États-Unis (linéaments du 38e parallèle, du Texas...), en Mongolie, etc. Dans ces conditions, le métallogéniste doit être un géologue « généraliste », géologue de terrain et cartographe de formation, qui doit faire continuellement appel aux autres sciences de la Terre et à des disciplines voisines. Dans des situations particulières, il peut être amené à faire œuvre de géologue minier ou à établir les différents programmes d'une prospection et à en lancer les actions correspondantes.
La publication, en 1957, des Principes généraux d'analyse métallogénique régionale et méthode d'établissement des cartes métallogéniques des régions plissées de P. M. Tatarinov et al. révolutionna, à l'époque, la connaissance et, en particulier, l'approche méthodologique.
Étapes, stades et générations de minéralisation
Les étapes de minéralisation sont des périodes de formation de minéraux qui sont séparées les unes des autres par un laps de temps relativement grand, et qui sont caractérisées par des conditions physico-chimiques essentiellement différentes de celles ayant présidé à la formation des masses minérales rocheuses. On parle ainsi, dans les processus endogènes de formation des minerais, d'étape magmatique, d'étape hydrothermale, etc. Les stades de minéralisation sont des intervalles de temps, relativement courts, à l'intérieur des étapes de minéralisation dont, d'une part, chacun est caractérisé par des conditions physico-chimiques de formation (c'est-à-dire par une composition et un état des solutions minéralisantes) bien précises, spécifiques, et dont, d'autre part, la distinction, à l'échelle d'un district ou d'un champ filonien par exemple, est fondée sur la chronologie relative des différents filons et filonnets le constituant. Ainsi, dans tel district, les diverses minéralisations formées dans l'étape hydrothermale correspondent respectivement à des filons à cassitérite, wolframite, arsénopyrite d'un premier stade, qui sont recoupés par des filons à galène, sphalérite d'un deuxième stade, eux-mêmes recoupés par des filons à stibine, pyrite d'un troisième et dernier stade. Les générations de minéralisation sont des intervalles de temps relativement très courts, à l'intérieur d'un même stade de minéralisation ; ils intéressent tous le même minéral et chacun d'eux est caractérisé par un dépôt particulier dudit minéral. Fréquemment, on emploie aussi en synonymie le terme : venue minéralisatrice. Parmi les meilleurs exemples de minéraux se présentant souvent en plusieurs générations, citons : le quartz, la pyrite, etc. Ainsi, le filon-maître « Mirador » (El Centenillo), dans le sud de la Meseta ibérique, présente trois générations de galène : la première à grande cristallisation, la seconde aciérée, la troisième de nouveau à grande cristallisation ; tandis que le filon-maître « Alberto » (El Horcajo), également en sierra Morena (Espagne), présente quatre générations de quartz, trois de galène, deux de pyrite, deux de chalcosite, etc.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Guy TAMAIN : docteur ès sciences, chargé de recherche au C.N.R.S.
Classification
Autres références
-
ACIDES & BASES
- Écrit par Yves GAUTIER et Pierre SOUCHAY
- 12 367 mots
- 7 médias
Les métaux sont de même attaqués par les sels d'ammonium avec dégagement d'hydrogène :
-
AGRÉGATS, physico-chimie
- Écrit par Jean FARGES et Rémi JULLIEN
- 1 616 mots
- 7 médias
Dans un agrégat métallique suffisamment petit, les électrons de conduction ne peuvent plus sauter d'un état quantique à l'autre car la différence d'énergie entre deux états successifs (qui varie comme 1/N) devient plus grande que l'énergie thermique. Par conséquent, lorsque la valence du métal considéré... -
ALLIAGES
- Écrit par Jean-Claude GACHON
- 7 363 mots
- 5 médias
Les alliages représentent une illustration matérielle du vieux dicton « l'union fait la force ». L'homme a toujours cherché des matériaux plus performants à l'utilisation, plus faciles à fabriquer ou à mettre en œuvre et plus économiques. Les alliages métalliques sont particulièrement...
-
ALUMINIUM
- Écrit par Robert GADEAU et Robert GUILLOT
- 9 639 mots
- 19 médias
Bien qu'il ne soit passé dans le domaine industriel qu'à la fin du xixe siècle, après la découverte par Paul Louis Toussaint Héroult et Charles Martin Hall du procédé de fabrication par électrolyse, l'aluminium est devenu le premier des métaux non ferreux. Sa légèreté, son inaltérabilité...
- Afficher les 94 références
Voir aussi
- GÉOLOGIE APPLIQUÉE
- GISEMENTS MÉTALLIFÈRES
- MINES & CARRIÈRES
- ANTÉCAMBRIEN ou PRÉCAMBRIEN
- ÉLÉMENTS CHIMIQUES
- MINÉRAUX
- PROSPECTION
- COMPÉTENCE & INCOMPÉTENCE, mécanique des roches
- PETRASCHECK WALTER EMIL (1906-1991)
- MÉTALLOGÉNIE
- MINÉRALISÉ CORPS
- MÉTALLOTECTES
- MÉTALLOGÉNIQUES PROVINCES
- MÉTALLOGÉNIQUES CARTES
- CONTRÔLES & GUIDES, métallogénie
- MINÉRALISATION, métallogénie
- MÉTALLOGÉNIQUES ÉPOQUES
- INTRUSION, géologie
- LAUNAY LOUIS DE (1860-1938)