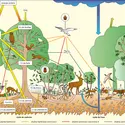MILIEU, écologie
Article modifié le
Modalités de l'action des facteurs mésologiques et des réactions des organismes
Toutes les composantes du milieu, biotiques et abiotiques, doivent être placées par l'écologiste dans une perspective temporelle, tenant compte d'abord de la durée de leur action sur l'organisme et permettant ensuite d'apprécier leur influence sur l'espèce dont il fait partie, sans oublier les éventuelles variations subies par les facteurs mésologiques dans le passé.
On a déjà souligné qu'un facteur du milieu agit d'une manière continue, spécifique et nécessaire sur l'organisme qui vit dans ce milieu.
Un phénomène ne devrait pas être considéré comme faisant partie du milieu s'il n'évoque chez l'organisme aucune réponse. Pour illustrer la notion de nécessité, remarquons par exemple que la lumière de la lune est probablement un facteur d'orientation pour certains invertébrés, mais ne paraît jouer aucun rôle pour bien des oiseaux migrateurs ; elle ferait donc partie du milieu des premiers, mais non de celui des seconds.
La notion de spécificité fait intervenir celle du seuil de sensibilité, car un phénomène peut ne jouer aucun rôle dans le milieu où vit un organisme dès lors qu'il reste à des valeurs subliminaires pour cet organisme. Cela vaut pour des facteurs tant physiques que chimiques. Certaines longueurs d'onde de la lumière échappent à l'homme mais sont recueillies par des insectes. Bien des organismes euryhalins sont insensibles à des variations de salinité de l'ordre de un pour mille ; mais certaines crevettes réagissent à ces petites variations par d'importantes modifications de leur comportement. Il en est de même pour divers facteurs biotiques : la présence de certaines espèces peut passer « inaperçue » par d'autres tant que leur abondance n'atteint pas des valeurs importantes. En outre, le même facteur peut provoquer des réactions très différentes suivant les espèces, les individus, l'âge ou le sexe. L'eau ambiante est indispensable à la vie d'une grande quantité de larves d'insectes ; mais les adultes, à métabolisme aérien, se noient s'ils tombent dans l'eau. La rosée estivale du matin active les mollusques terrestres mais inactive beaucoup d'insectes bons voiliers ; la pluie réveille la faune du sol, mais bloque les mouvements de plusieurs animaux de surface ; elle empêche l'épanouissement de beaucoup de fleurs mais provoque la prolifération des Cyanophycées terrestres ; la tombée de la nuit bloque l'activité des organismes diurnes et déclenche celle des nocturnes.
Quant à la continuité de l'action – puisqu'un événement exceptionnel ne peut être considéré comme faisant vraiment partie du milieu d'un organisme –, elle n'implique nullement la constance du facteur considéré. Au contraire, les variations d'intensité du facteur et des réponses relatives de l'organisme, surtout si elles présentent un type cyclique, sont plutôt la règle dans la biosphère. Seuls certains organismes, qui vivent en conditions écologiques bien particulières, ne présentent pas de rythmes d'activité fondés sur les cycles des facteurs physiques environnants : c'est notamment le cas des endoparasites, qui, s'ils ont des rythmes biologiques, les modèlent directement sur ceux de leur hôte ; des animaux qui habitent des milieux très constants, tels que les grottes et les eaux profondes. Pour la plupart des organismes, au contraire, une variation saisonnière et nycthémérale de l'environnement représente une condition plus favorable au développement et à la reproduction qu'une constance artificielle de cet environnement telle qu'il est possible de l'obtenir au laboratoire. La plupart de ces rythmes fonctionnels reposent sur la situation astronomique de la Terre. Le rythme d'illumination solaire – auquel le rythme de photosynthèse est strictement lié, ainsi qu'un grand nombre de rythmes physiologiques, chez les plantes, les animaux, et même l'homme –, le rythme hygrothermique des milieux continentaux, celui des brises de mer et de terre, sont parmi les plus généraux ; en mer, les rythmes de marée revêtent une importance particulière. On peut énumérer d'ailleurs dans cette catégorie tous les rythmes fonctionnels liés à l'alternance des saisons. Une partie de ces cycles d'activité est directement imposée par l'environnement, telle l'activité des organismes hygrophiles, liée surtout à un taux élevé d'humidité atmosphérique (rythmes exogènes). La plupart des rythmes ont toutefois au moins une composante connaturée aux organismes (rythmes endogènes), mais l'action de l'environnement n'est pas moins importante dans ces cas, car le milieu joue le rôle de synchroniseur de l'activité des organismes.
Les plantes et les animaux peuvent pourtant faire front à des variations arythmiques de l'environnement, inattendues en elles-mêmes, ou exceptionnelles quant à leur intensité. C'est par exemple le cas d'animaux que des causes extraordinaires, climatiques ou autres (incendies, invasions de concurrents, développement excessif de prédateurs, épidémies), obligent à sortir de leur milieu originel pour en conquérir un autre. Dans ce cas, si les nouvelles conditions écologiques ne s'écartent pas trop des possibilités adaptatives de l'organisme, celui-ci peut survivre et même se reproduire. Ces possibilités sont évidemment une fonction de la valence écologique de l'organisme considéré. Si en effet celui-ci est euryèce, les seuils maximal et minimal de tolérance sont relativement très éloignés de la zone d'optimalité physiologique, et l'organisme lui-même n'est pas lié qu'à un milieu strictement défini. Le stimulus exceptionnel peut d'ailleurs conduire à l'acquisition de nouvelles normes de réaction, qui pourront par la suite entrer dans la valence écologique de l'organisme étudié, si le facteur qui les a mises en évidence devient de son côté partie intégrante du nouveau milieu. C'est ainsi qu'il y a acclimatement à des températures, pressions, taux d'humidité et d'oxygénation, conditions d'éclairement, succession des saisons, etc., chez des plantes et des animaux transportés par exemple de la montagne à la plaine, ou vice versa ; d'une latitude ou d'un continent à l'autre ; de la pénombre au plein soleil, etc. Cet acclimatement n'intéresse souvent que l'individu ; celui-ci survit dans le nouveau milieu sans pourtant pouvoir s'y reproduire. En d'autres cas, une acclimatation complète est possible, au niveau des générations qui se succèdent dans le nouveau milieu. Ainsi, parmi les poissons accomplissant des migrations régulières de la mer aux eaux internes, les muges (Mugil), s'ils ne peuvent revenir à la mer, croissent assez régulièrement, mais ne peuvent se reproduire en eau douce ; les aloses au contraire (Alosa fallax) sont capables de donner des populations se reproduisant dans des lacs d'eau douce. Ces problèmes d'adaptation intéressent aussi bien l'écologie que la science de l'hérédité et de l'évolution.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Cesare F. SACCHI : professeur d'écologie à l'université de Paris-VI, directeur de l'Institut d'écologie et d'éthologie de Pavie
Classification
Média
Autres références
-
ADAPTATION - Adaptation biologique
- Écrit par Armand de RICQLÈS
- 1 376 mots
Selon une première interprétation, l'adaptation recouvre un ensemble de constatations structuro-fonctionnelles propres aux êtres vivants etrendant compte de leur survie dans un environnement donné. Cette acception statique de l'adaptation correspond à la notion développée par Georges Cuvier (1769-1832)... -
ANTHROPOLOGIE
- Écrit par Élisabeth COPET-ROUGIER et Christian GHASARIAN
- 16 161 mots
- 1 média
...s'inspirèrent des travaux de J. H. Steward préconisant l'analyse méticuleuse des bases matérielles des sociétés humaines en relation avec leur adaptation au milieu. La société passe ainsi au rang d'un sous-système au sein d'un ensemble plus vaste qui inclut la nature animale et végétale, l'écosystème. Avant... -
AZONAUX BIOMES
- Écrit par Didier LAVERGNE
- 160 mots
En opposition avec la zonation en latitude des grandes unités biogéographiques terrestres, et avec l'étagement altitudinal qui en est la réplique au niveau des grands accidents du relief continental, un biome est qualifié d'azonal lorsqu'il échappe dans sa localisation géographique au déterminisme...
-
BIOCÉNOSES
- Écrit par Paul DUVIGNEAUD , Maxime LAMOTTE , Didier LAVERGNE et Jean-Marie PÉRÈS
- 9 777 mots
- 8 médias
Le terme de « biocénose » a été introduit dans le langage scientifique en 1877 par le biologiste allemand Möbius, à propos de l'étude des bancs d'huîtres, auxquels de nombreux organismes se trouvent associés.
Selon cet auteur, une biocénose est « un groupement d'êtres vivants...
- Afficher les 46 références
Voir aussi
- BIOGÈNES ÉLÉMENTS
- IONS
- SÉCHERESSE
- STÉNOTHERMIE
- EURYTHERMIE
- MÉSOTHERMIE
- PHOTOPHILIE
- SCIAPHILIE
- PHOTOSENSIBILITÉ, biologie
- STÉNOHALINITÉ
- HYPOHALINITÉ
- ESTIVATION
- ACCLIMATATION
- CLIMATIQUES FACTEURS
- POÏKILOTHERMIE ou PŒCILOTHERMIE
- SYNCHRONISEUR, chronobiologie
- EAU, écophysiologie
- PESANTEUR
- DROMADAIRE
- TRANSPIRATION ANIMALE ou SUDATION ANIMALE
- ANIONS
- CATIONS
- MÉSOLOGIE
- SALINITÉ
- NYCTHÉMÉRAL RYTHME
- TEMPÉRATURE
- pH
- PHOSPHATES
- HÉTÉROTHERMIE
- ACCLIMATEMENT
- AZOTE CYCLE DE L'
- HOMÉOTHERMIE
- ADAPTATION BIOLOGIQUE
- RESPIRATION
- PHOSPHORE CYCLE DU
- ÉCOPHYSIOLOGIE
- NITRATES
- ANTHROPISATION
- AQUATIQUE VIE
- MORPHOLOGIE, biologie
- AÉRIENNE VIE
- BIOTIQUES FACTEURS
- ABIOTIQUES FACTEURS
- EURYÈCE ESPÈCE
- VALENCE ÉCOLOGIQUE
- EURYHALINITÉ
- ÉDAPHOLOGIE
- GRAVITÉ
- PRESSION HYDROSTATIQUE
- FACTEUR LIMITANT, écologie
- TAILLE CORPORELLE
- PEUPLEMENT, écologie
- CARBONIQUE GAZ ou DIOXYDE DE CARBONE
- HUMIDITÉ RELATIVE