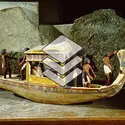MIRACLE
Article modifié le
L'histoire sacrée et les « œuvres de Dieu »
Un troisième pas est franchi lorsque le prodigieux, signe de grâce, n'est plus perçu en situation « naturelle », mais en situation historique, lorsqu'un groupe religieux particulièrement inventif (Israël) récuse l'animisme, condamne l'idolâtrie, expulse ou retouche les mythes de représentation, leur préfère un mythe d'action, et décide de « signifier » Dieu par une exigence morale, par une intention de perfection dont le rôle pourra rester indéfiniment moteur. (Un tel idéal s'actualise dans l'effort, dans la suppression effective et progressive de ce qui retarde ou compromet l'harmonie universelle, la réconciliation de l'homme avec l'homme et avec la nature, mais il ne devient jamais réalité, réalité totale et définitive : son actualisation même rouvre l'avenir, engendre une nouvelle attente, une nouvelle espérance, car chaque réalisation accroît l'exigence et contient la promesse d'une réalisation meilleure.)
L'avantage de cette position est double. Elle fonde l'histoire comme création de fins, comme devenir orienté, comme modification, de l'homme et du monde. Simultanément, elle obtient un dieu sans visage et sans image, puisque le dieu moral, seigneur de l'histoire, n'est plus objet de représentation, mais source d'action, source d'un dynamisme qui révèle ce que Dieu veut, ce qu'il fait, non ce qu'il est : connu pratiquement, historiquement, par des actes, il ne l'est ni spéculativement, par des notions, ni imaginativement par des représentations. On doit même dire qu'il n'est convenablement désigné que comme dieu caché, en vertu de l'iconoclasme propre à la religion « historique », le trait distinctif de cette religion étant d'en appeler de ce qui est à ce qui doit être, de ne jamais se figer, de se « désétablir » au fur et à mesure qu'elle s'établit (l'acquis n'est conservé que comme tremplin vers d'autres découvertes).
Dans ce contexte, pour employer une formule qui n'est pas une définition, mais une indication, Dieu est ce qu'on fait parce qu'il le fait faire ; il est plus encore ce qui reste à faire, parce qu'il exige qu'on dépasse ce qu'on a fait (ou qu'on le défasse, si on l'a mal fait) pour continuer à faire.
Dans ce contexte aussi, la nature n'est plus une symbolique divine adhérente aux choses, y adhérant sans l'intermédiaire de l'homme, sans l'entremise de l'action historique qui n'est pas nature, mais culture, qui n'est pas simple donné, mais créativité, liberté. Il en résulte que, pour la première fois, les choses se mettent à signifier de façon anthropologique, mais non anthropomorphique. Car elles signifient ce que l'homme peut en faire (moralement, religieusement), non ce qu'elles miment de l'homme lorsqu'on les pourvoit d'intentions volontaires, de significations intentionnelles, analogues à celles des consciences.
On devine que, dans ce cadre, qui est celui d'une nature prise en charge par l'histoire, d'une nature comme lieu et instrument de l'histoire, le prodigieux, même « naturel » (surgissant dans la nature, affectant la nature), aura une portée tout autre que pour le fétichisme ou le paganisme. Il sera lui-même « historique », rendu signifiant, pourvu de valeur, par l'idéal choisi comme fin de l'histoire. Il ne sera plus un signe naturel, mais positif, au sens où la positivité, en religion comme en histoire, n'est pas un fait matériel, mais un fait humain. Par là sera dénouée l'équivoque de l'animisme, qui ensemence les âmes dans les choses, les intentions dans les objets ; seront surmontés sa prodigalité, son foisonnement de symboles. Dans un univers où les correspondances surabondent, où tout renvoie à tout, où tout peut signifier tout le reste (cas des symboliques naturistes), on devrait dire que rien de particulier n'a à faire signe, puisque déjà tout est signe. Au contraire, pour le judaïsme, il n'y a de signes et significations que ceux d'une histoire qui œuvre dans la nature, qui la transforme et qui finalement ne la voit qu'à travers son propre travail.
Bref, les choses, les réalités du monde, ne risquent plus de confisquer l'attention qu'on leur prête, d'arrêter l'intention qui les prend pour support. Les idoles sont abattues. Ne demeure qu'un vecteur d'action, comme clef de toutes les significations.
En ce point est la trouvaille spécifique du mosaïsme, celle qui renouvelle le symbolisme religieux, celle qui le change de niveau, même dans le réemploi des vieux matériaux. C'est l'histoire, non la nature, qui est sainte (ou la nature ne le devient que par l'histoire). C'est l'action, non ses conditionnements naturels, qui véhicule la révélation. Plus précisément, c'est une alliance, un contrat, une consécration délibérée, qui engage une communauté d'hommes à n'agir que pour Dieu, ce « pour Dieu » impliquant un « par Dieu », un « avec Dieu », sans lesquels il ne serait ni concevable, ni réalisable. Car le Dieu de la Bible, « Dieu de sainteté », n'est pas un dieu local, ni même un dieu spatial occupant tous les espaces – on le localise de façon nomade, on l'intronise de façon transportable, sous la tente, dans l'arche ; et le temple lui-même, en son unicité, a pour but d'empêcher qu'on ne l'attache à des lieux culturels qui seraient des foyers de tellurisme religieux (à la mode cananéenne) ou des centres de dévotion régionaliste, particulariste. C'est un dieu, non de l'espace, mais du temps, du temps de l'action. Autant dire un dieu moral. À ce titre, il n'est nulle part, si ce n'est dans les volontés qui se confient à lui. Mais alors il y est pleinement, il y est en personne : elles sont sa volonté, puisqu'elles la font. Quand cette coïncidence des vouloirs va jusqu'à l'identité, quand l'agir de Dieu et l'agir pour Dieu se confondent, l'histoire temporelle dévoile l'éternel, non parce qu'elle le représente, mais parce qu'elle l'accomplit.
C'est pourquoi on peut parler de desseins de Dieu, de gestes de Dieu, chaque fois que le « peuple de Dieu », le peuple qui prend pour vocation et pour destin de se vouer à Dieu, interprète les événements selon son projet religieux. Ce projet est indivisiblement son intention et celle de Dieu, son action et celle de Dieu. Le dieu-volonté fait réellement ce qu'il fait faire, parce que les sujets volontaires, les agents historiques, ne reconnaissent pour fait et bien fait que ce qui est conforme à sa dignité, à sa justice, à l'idée qu'ils en ont. Dès lors, la transcendance est aussi l'immanence ; et même, elle n'est que l'immanence, à condition de stipuler que cette immanence est celle d'un agir historique, d'un agir qui se pense lui-même comme advenir de Dieu, sans trêve ni repos.
Or, il est symptomatique que les témoins de cette foi, ses hérauts ou ses écrivains, appellent « miracles de Dieu » tous les faits du passé ou du présent, qu'ils soient embellis par la légende ou qu'ils aient l'urgence de l'actualité, qu'ils commémorent des victoires ou qu'ils remémorent des épreuves, tous les faits dont le sens religieux est de célébrer, de resserrer ou de relancer l'alliance initiale. Les miracles, actes du « dieu vivant », actes du dieu vécu, ne sont que les temps forts du devenir de l'alliance, les tournants principaux de l'histoire du salut. Il y a miracle quand un événement acquiert valeur salutaire, quand d'événement de rencontre il se change en avènement de grâce. L'explication matérielle, ou profane, n'est pas plus rejetée qu'elle n'est recherchée ; elle est négligée, inaperçue ou mal aperçue, parfois esquissée, plus souvent enjambée (selon l'âge des rédactions ou des révisions), car elle n'a pas d'intérêt pour la foi. Aux faits eux-mêmes se substituent des faits-valeurs ; à la lecture des événements comme événements se superposent une autre lecture, un autre regard, qui sont ceux de la foi comme pôle de l'histoire, comme instauration religieuse de l'histoire.
De ce point de vue, le langage du miracle n'a que les apparences d'une thaumaturgie qui bouleverse l'ordre du monde, qui suspend ou perturbe sa régularité. Le thaumaturgique est bien dans le mode d'expression (lequel préexistait, d'ailleurs, dans le fonds naturaliste que les élites mosaïques eurent à transposer en positivité historique) ; il figure même dans les parties les plus affinées de la Bible. Mais cet archaïsme profite d'une recharge de sens, qui équivaut à une redéfinition et qui provient de l'entrée en lice du dieu-histoire (ou de Dieu comme volonté immanente à l'histoire). Insistons sur ce remaniement, sur ces inflexions.
Chez les prophètes, ou dans les textes relus, voire récrits, à la lumière de leur enseignement, les miracles sont ce que Dieu fait et fait faire (sans distinction d'une cause première et de causes secondes). Ils sont les « œuvres de Dieu » (Isaïe), les « merveilles de Dieu » (Livre de Job), les « hauts faits » ou les « exploits » de Dieu (Psaumes), ses prodiges (Michée), son secours de dernière heure (Jérémie), sa main qui libère et qui guide (Exode). Pas de différence fondamentale entre ces expressions, ou leurs innombrables variantes (on pourrait multiplier les citations). Elles signifient toutes que le monde et l'histoire, la nature et l'homme sont « dans la main » de Dieu, disons plus, qu'ils sont sa main, la « main puissante de l'Éternel » dans le double déploiement du geste créateur et du geste sauveur (qui, pour l'homme biblique, ne font qu'un, car la création est pour la recréation, le monde pour l'histoire, la nature pour la grâce).
Dans ces conditions, tout est miracle, du moins tout ce qui mène au salut, tout ce qui y contribue ; tout est miracle, parce que, selon l'optique judaïque, il n'y a pas, d'un côté, une nature humaine, de l'autre, une nature divine, et pas davantage, d'un côté, une nature extérieure, de l'autre, une attitude intérieure : il n'y a qu'un faire divin qui investit et qui transit le faire humain, qui opère en lui et par lui, qui garantit son triomphe sur les éléments réfractaires. Tout est pensé en termes d'action morale, d'action régénératrice, d'action solidaire : le monde, l'homme et Dieu. Il n'existe ni monde séparé, ni humanité séparée, ni divinité séparée. Ce qui existe, c'est un processus indivis, dans lequel le monde est histoire de l'homme et l'histoire révélation de Dieu, réalisation de Dieu. Dans ce sens, Dieu fait tout ; en même temps, il ne fait rien qu'il ne fasse faire, qu'il ne rende efficace et manifeste dans le médiateur humain, aux prises avec la médiation du monde. Là est le perpétuel miracle, mais aussi le seul miracle à considérer : celui d'une action de Dieu dans l'homme et dans le monde de l'homme. Le miracle est cette action même, et rien d'autre. En langage biblique, il est le salut, à moins qu'on ne retienne la formule inverse : le salut est miracle, c'est-à-dire œuvre de Dieu.
Comment expliquer néanmoins que ce miracle-salut, ce miracle tout entier réduit à la grâce, se greffe si aisément sur les miracles de type ancien, sur ceux dont la particularité est d'ébranler un monde ordonné, de bousculer l'ordre en tant qu'ordre ? La réponse est dans l' Exode, dans l'Exode qui commente hardiment l'image de la Main puissante et accentue le thème du bon vouloir de Dieu, le thème de sa libre disposition, le thème de son arbitraire, dans l'Exode qui ne traite pas cette image en métaphore, mais en principe de vision et de valorisation. Le miracle, c'est l'arbitraire divin, c'est son intervention soudaine, imprévisible, en coup de force. Mais cet arbitraire divin, qui a tant effrayé la sagesse stoïcienne, n'a rien d'une déraison qui taille en pièces la nécessité ; il n'est qu'un autre nom du dieu-histoire, du dieu-action, du dieu-volonté, lequel ne trouve pas en face de lui un monde statiquement constitué et un homme qui subit, un homme passif. L'Exode offre, au contraire, le prototype d'une nature domptée par l'histoire et d'une histoire conduite par l'action de Dieu dans l'action des hommes. L'arbitraire divin, le miracle qui l'exprime, n'a pas à troubler, à disloquer un ordre des choses. En l'occurrence, il n'y a pas d'ordre des choses, d'ordre immuable, d'ordre inhérent aux choses comme telles (le monde juif n'est pas le monde grec). Il n'y a qu'une histoire dont le propre est de changer la face de la terre, sous l'inspiration d'un finalisme militant, d'un finalisme éthique et religieux. L'arbitraire de Dieu n'a pour contingence que celle de l'histoire ; il n'a pour motivations que celles d'une volonté qui moralise ou sanctifie les entreprises des agents historiques. De cette manière, la contingence elle-même ne reflète ni l'accident, ni le soubresaut, ni l'incartade ; ce qu'elle traduit, ce qu'elle effectue parce qu'elle l'incarne, c'est la grâce. On peut même avancer qu'une contingence par saccades, une contingence de caprice, se trouve exclue de la durée biblique : celle-ci est, dans l'homme, le temps de l'Éternel, de sorte que ce qui arrive, quoi qu'il arrive, c'est toujours Dieu. Si l'on préfère, rien n'arrive ou il n'arrive rien, sauf le « dieu qui vient ». Il est l'unique événement. Et quand on le reconnaît tel, on saisit ce qu'est un miracle : non un fait à part, non un fait retranché des autres faits, non un fait dont la trame naturelle cesserait d'être naturelle, mais le fait du salut s'annonçant dans le fait de l'alliance, puis dans les faits qui la prolongent ou la réitèrent.
Que ces faits, pour mieux dévoiler le fait, soient triés, magnifiés, stylisés, c'est indéniable (et le récit des faits remplit le même office que les faits, sinon mieux, car il ne s'empêtre plus dans la péripétie). Contés ou contemplés, sélectionnés et interprétés, les faits s'exhaussent d'eux-mêmes : ils reçoivent l'aura du prodigieux. Mais ce qu'ils ont de miraculeux, ce n'est pas ce prodigieux (malgré l'orchestration épique ou lyrique) : c'est leur insertion dans une histoire qui est celle du salut. Est miracle l'événement « sauveur », l'événement « révélateur », et non pas l'anomalie physique ou cosmique qui, hors histoire, hors foi, hors perspective religieuse ne serait qu'une bizarrerie.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Henry DUMÉRY : professeur de philosophie à l'université de Paris-X-Nanterre
Classification
Autres références
-
BULTMANN RUDOLF (1884-1976)
- Écrit par André MALET
- 2 317 mots
Pour le théologien Bultmann, il importe de s'entendre sur le sens dumiracle. L'athéisme nie le miracle pour la raison très simple qu'il n'y a pas de Dieu. Bultmann, lui, non seulement croit en Dieu, mais professe que Jésus de Nazareth est l'unique révélation de Dieu. Seulement... -
EAUX SYMBOLISME DES
- Écrit par Gilbert DURAND
- 4 082 mots
- 1 média
...animale, « le premier aliment de tous les êtres ». Ce que retrouve le poète, ce sont les vertus de l'« eau vive » et des fontaines de jouvence qu'attestent les multiples sources miraculeuses qui existent encore en France, de Sainte-Anne-d'Auray à Lourdes. Leur modèle mythique est bien, pour les pays... -
GERSONIDE LÉVI BEN GERSHOM dit (1288-1344)
- Écrit par Charles TOUATI
- 2 394 mots
...situation donnée, individuelle ou collective, et annonce le bien ou le mal qui doit atteindre une personne, un groupe ou le peuple tout entier. Il prévoit le miracle, violation des lois naturelles qui n'est pas inscrite depuis la Création dans le déterminisme, comme le pensait Maïmonide, mais qui se produit... -
HAGIOGRAPHIE
- Écrit par Michel de CERTEAU
- 5 798 mots
...manifestent. On peut expliquer par là qu'il y ait eu éclatement de la vertu – dunamis, et que les « vertus » se soient spécialisées en se distinguant des « miracles ». Les unes et les autres se réfèrent à la « puissance », mais comme norme sociale dans le cas des premières, comme exception dans le cas des... - Afficher les 13 références
Voir aussi