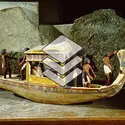MIRACLE
Article modifié le
Les théologiens, l'explication naturelle et la foi chrétienne
Un quatrième pas est accompli, un quatrième pas qui est un écart. Lorsque la curiosité dévie et recherche le sensationnel, lorsque l'anxiété l'emporte sur la foi et qu'elle réclame des preuves tangibles, contraignantes ; surtout, lorsqu'un rationalisme naissant (et mal compris) s'emploie à discriminer ce que la nature peut ou ne peut pas produire d'elle-même, l'idée de miracle sombre dans l'équivoque ; pis, elle tombe hors de son champ. On quête le prodigieux, l'extraordinaire, l'exceptionnel pour des motifs de satisfaction, de vanité ou d'insécurité égocentriques, et on se met à l'apprécier selon des critères qui n'ont rien de religieux.
On s'efforce, par exemple, de mesurer en quoi l'événement, dans sa facture empirique, ne peut être dit naturel ou humain. On se livre à une analyse dont on n'a guère les moyens, à une analyse de puissance et d'efficience, pour conclure, selon les cas, qu'une cause banale suffit ou qu'il y faut une cause hors du cercle des causes.
Mais ce raisonnement lâche la topique religieuse ; il s'égare sur un terrain de science, de fausse science ; car personne, ni savant, ni philosophe, ni mystique, personne ne peut dire de quoi la nature est capable (le médecin, qui assure que Dieu seul peut faire mieux que lui, a une moins haute idée de Dieu que de lui-même).
En outre, même le prodigieux s'inscrit dans la nature et doit, pour s'y inscrire, utiliser des processus naturels. (Qu'un physicien, ou un biologiste, ne puisse les maîtriser, les déclencher, les reproduire à volonté, c'est une autre affaire.)
Enfin quoi d'étonnant, quoi de prodigieux, qu'une force jugée toute-puissante fasse des prodiges ? Thomas d'Aquin note avec finesse et avec flegme que, pour l'omnipotence, rien n'est miracle, rien n'est prodige. La mesure du prodigieux est donc toute relative, relative à nous, relative à un état des connaissances qui varie sans cesse et qui, dans sa mobilité, déracine tous les jalons, tous les repères.
Les théologiens ont vu l'objection ; ils répondent que le croyant ne se mêle pas de science et que, pour détecter le miraculeux, il se borne à relever ce qui échappe au « cours habituel » des choses. Mais cette référence, manipulée par des modernes, devient rapidement suspecte. En effet, même si le cours habituel des choses n'est qu'une expression commode (simple catégorie populaire, ou simple rémanence des enfances de l'esprit dans les psychologies adultes), il reste qu'on a souci d'apposer la signature divine là, et là seulement, où l'on aura tranché que le fait n'est plus ordinaire. Ce jugement abrupt et péremptoire devenant de plus en plus délicat, au fur et à mesure que, dans notre culture, le sens commun se laisse éduquer par la science, les miracles se raréfient ; ils tendent à disparaître. Que pourraient-ils signifier au juste, même pour ceux qui croient ? Lorsqu'on loge une providence spéciale dans les ratés de l'explication naturelle, dans les défaillances de l'étiologie rationnelle, on ne s'occupe plus de religion ; on se préoccupe de prendre la science en défaut, tout en accusant le contrecoup de ses succès. D'après les apologistes, le miracle, au xxe siècle, est un défi à la science. En réalité, c'est la science qui avance et c'est le miracle, leur notion de miracle, qui recule. Ils cherchent, sans le trouver, un concordisme entre science et religion. Au lieu de prétendre que le miracle défie la science, ils feraient mieux d'avouer que la science les impressionne plus encore que le miracle, puisqu'ils n'aboutissent à celui-ci que par une méthode des résidus : Dieu est invoqué quand on se trouve à court de raisons, quand il n'y a plus d'autre principe d'explication. Par où s'insinue ce paralogisme : l'ignorance des causes démontre que la cause est transcendante ; et s'impose ce paradoxe : un miraculeux issu des déficits de la science ne reçoit en partage aucun titre mystique ; ce n'est qu'un bâtard de religion et de scientisme.
Ces prétentions et ces confusions sont d'autant plus choquantes qu'elles se propagent dans des milieux chrétiens, c'est-à-dire au sein d'une tradition qui a retourné la notion du divin (la Croix comme abaissement de Dieu, comme échec absolu, comme renoncement à tout avoir, à tout pouvoir) et qui n'a plus besoin d'appuyer la grâce sur la puissance et la gloire, ni de la vérifier sur des coups d'éclat, sur des signes dont la mise en demeure n'aurait d'autre crédit, d'autre autorité que ceux de la mise en scène.
Il est vrai que, touchant la notion de miracle, les Écritures chrétiennes ne sont pas unifiées. Elles conservent une couche thaumaturgique, qu'il serait déshonnête d'effacer, et qui, de surcroît, n'est pas homogène (par chassé-croisé d'influences, par apports successifs, par infiltration syncrétique, on ne sait). Les miracles-guérisons peuvent renvoyer soit à un genre littéraire qui a ses lois, son économie (celles de l'hagiographie antique), soit à des phénomènes paranormaux que la psychologie des religions ne regarde plus ni comme aberrants, ni comme exorbitants. Quant aux « faits dogmatiques », leur caractère synthétique et feuilleté, leur manière d'élaborer un donné, de le « doctriner », leur fonction de paradigme attestent suffisamment que leur positivité est d'autre espèce qu'une positivité empirique ou psycho-empirique, même quand celle-ci lui est adjointe ; en particulier, la Résurrection est un schème eschatologique, non un concept d'anatomie ou de physiologie trans-terrestre. Mais le Nouveau Testament, qui intègre la thaumaturgie, intègre aussi son contrepoids, son thème compensateur, voire ses règles d'usage. C'est le cas de l'Évangile de Jean (xx, 29), dont le « croire sans voir » agit comme réducteur de toute adhésion sur preuves, de toute foi sur constats. C'est aussi le cas de Matthieu (vii, 22 et xii, 39), de Marc(viii, 12), de Luc (xi, 29 et xvi, 31), de la Première Épître aux Corinthiens, (i, 22), de tous les passages qui minimisent la portée des signes, des prodiges, et qui dénoncent les évidences trop sensibles.
Cette autocorrection de la foi apostolique incline certains exégètes à estimer qu'à la différence des judaïsmes charnels (infidèles au prophétisme) et des paganismes méditerranéens (assoiffés de merveilleux), le christianisme a de quoi redresser les modes de représentation archaïques dont il hérite : de soi, selon sa visée la plus radicale, il ne serait ni oraculaire, ni « miraculaire ».
Il est peu probable néanmoins (et il n'est pas souhaitable) qu'on parvienne jamais à harmoniser tous ces textes ; ils ont sédimenté des tendances diverses, inégales, dont quelques-unes demeurent franchement antithétiques. Ce qu'on accordera, c'est que le refus du primat de la puissance pour l'expression du divin, le renversement de la notion de royaume ou de règne (par le service et le sacrifice, non par le triomphe) introduisent une coupure idéologique dans la sémantique du miracle, dans l'histoire des religions, plus particulièrement dans l'histoire du judaïsme et du christianisme (car dans l'un et dans l'autre, c'est une même strate, la strate prophétique, qui rend compte du métamorphisme le plus actif, des transformations les plus profondes et les plus décisives). De cette coupure idéologique, de ces points d'émergence et de rupture, la pensée occidentale a eu quelque conscience. Il serait excessif d'affirmer qu'elle en a tiré toutes les conséquences.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Henry DUMÉRY : professeur de philosophie à l'université de Paris-X-Nanterre
Classification
Autres références
-
BULTMANN RUDOLF (1884-1976)
- Écrit par André MALET
- 2 317 mots
Pour le théologien Bultmann, il importe de s'entendre sur le sens dumiracle. L'athéisme nie le miracle pour la raison très simple qu'il n'y a pas de Dieu. Bultmann, lui, non seulement croit en Dieu, mais professe que Jésus de Nazareth est l'unique révélation de Dieu. Seulement... -
EAUX SYMBOLISME DES
- Écrit par Gilbert DURAND
- 4 082 mots
- 1 média
...animale, « le premier aliment de tous les êtres ». Ce que retrouve le poète, ce sont les vertus de l'« eau vive » et des fontaines de jouvence qu'attestent les multiples sources miraculeuses qui existent encore en France, de Sainte-Anne-d'Auray à Lourdes. Leur modèle mythique est bien, pour les pays... -
GERSONIDE LÉVI BEN GERSHOM dit (1288-1344)
- Écrit par Charles TOUATI
- 2 394 mots
...situation donnée, individuelle ou collective, et annonce le bien ou le mal qui doit atteindre une personne, un groupe ou le peuple tout entier. Il prévoit le miracle, violation des lois naturelles qui n'est pas inscrite depuis la Création dans le déterminisme, comme le pensait Maïmonide, mais qui se produit... -
HAGIOGRAPHIE
- Écrit par Michel de CERTEAU
- 5 798 mots
...manifestent. On peut expliquer par là qu'il y ait eu éclatement de la vertu – dunamis, et que les « vertus » se soient spécialisées en se distinguant des « miracles ». Les unes et les autres se réfèrent à la « puissance », mais comme norme sociale dans le cas des premières, comme exception dans le cas des... - Afficher les 13 références
Voir aussi