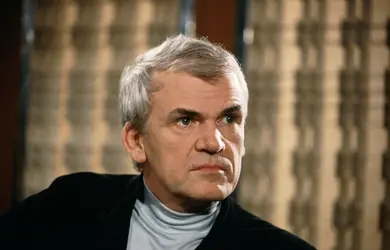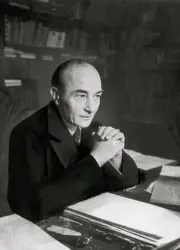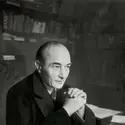MITTELEUROPA
Article modifié le
Une modernité sceptique
La réunion au sein de la monarchie habsbourgeoise d'une grande variété de cultures placées, pour certaines d'entre elles, depuis le dernier tiers du xixe siècle, sur un pied d'égalité avec la culture allemande en matière de politique éducative, universitaire et artistique, a suscité une école d'anthropologie d'une exceptionnelle richesse. L'encyclopédie géographique et ethnographique Die österreichisch-ungarische Monarchie im Wort und Bild réunit une documentation très précise sur tous les peuples et sur toutes les provinces de la monarchie. L'espace rédactionnel, équitablement réparti entre tous les « paysages » de l'empire, symbolise l'orientation authentiquement pluraliste de cette encyclopédie.
L'affirmation des nationalités
Seule une vision optimiste et, en l'occurrence, déformante peut interpréter le voisinage des langues, les littératures et des cultures en Europe centrale comme un gage de fécondité du dialogue interculturel. Ce type de « métissage culturel » existe dans quelques cas heureux. Mais l'autre processus, hélas ! tout aussi fréquent, a été analysé par Ludwig Gumplowicz, qui nous présente le monde habsbourgeois comme le théâtre d'une guerre entre groupes sociaux et ethniques. Les théories de ce professeur de l'université de Graz, dominées par un pessimisme digne de Hobbes, n'étaient que le durcissement et l'exagération d'une interprétation sans illusion de la réalité politique. Né à Cracovie en 1838, fils de la bourgeoisie juive de Galicie, Gumplowicz avait rêvé dans sa jeunesse d'une assimilation parfaite à la culture polonaise. Son œuvre Race et État (1883 ; deuxième édition intitulée La Guerre des races, 1909) est explicitement présentée comme l'aboutissement d'une série de déceptions : elle analyse le potentiel dangereux d'une Europe centrale transformée en champ clos des chauvinismes nationaux, des antagonismes ethniques et sociaux, et finalement des racismes en tous genres et de l'antisémitisme.
Le paradoxe de la Mitteleuropa habsbourgeoise tient à la manière dont le système autrichien, en Cisleithanie, a conçu l'autonomie culturelle des nationalités à l'époque des compromis constitutionnels qui, dans chaque territoire, devaient codifier l'équilibre entre majorité et minorités. Il s'agissait de pacifier les régions de peuplement mélangé en séparant les groupes ethnico-linguistiques. En Moravie, par exemple, on ne pouvait pas être tchèque et allemand en même temps. Il fallait être l'un ou l'autre. En majorité, les Juifs (qui, aux yeux de l'administration, n'avaient pas de langue propre, puisque ni l'hébreu ni le yiddish n'avaient le statut de langue nationale) optaient pour l'identité linguistique allemande.
Le pluralisme multiculturel de la société habsbourgeoise avait ainsi abouti à la fragmentation de la « citoyenneté culturelle », au cloisonnement de la société, dans chaque territoire, en communautés « nationales » définies au premier chef par la langue. En Cisleithanie, cette cohabitation sans cohésion ne conduisait pas à la « supranationalité », mais à un curieux alliage de citoyenneté habsbourgeoise et de « nationalité privée » tchèque, polonaise, serbe, croate, slovène, italienne, roumaine, ruthène ou allemande. Les Juifs de la monarchie habsbourgeois furent-ils aussi « supranationaux » que le suggère Joseph Roth ? En réalité, les Juifs d'Autriche-Hongrie furent entraînés comme les autres par le mouvement d'affirmation des nationalités.
Modernité, en Mitteleuropa, jusqu'à 1938, rime avec pluralité : multiethnicité, multiculturalité. Cette interculturalité génératrice de conflits est aussi la principale explication de la singulière créativité de l'Europe centrale habsbourgeoise autour de 1900 : l'Europe occidentale et l'Europe orientale s'y rencontrent, les cultures allemande, slave et hongroise s'y mélangent. Mais la notion de pluralité n'appelle pas nécessairement celle de pluralisme, si l'on entend par pluralisme l'organisation politique d'une coexistence harmonieuse de différents groupes sociaux et culturels. La pluralité, dans la monarchie habsbourgeoise, était souvent comparée à une marqueterie des langues et des cultures, un fait historique que chaque nationalité refusait pour son propre compte. En réalité, l'aspiration à un tout homogène gagnait du terrain au fur et à mesure du déclin du « mythe habsbourgeois ».
La pluralité explique sans doute l'épanouissement de la modernité centre-européenne, mais – à l'opposé des promesses de Herder – elle n'a pas fait le bonheur des nations que l'histoire avait mêlées. Comment penser l'ordre de l'Europe centrale par-delà le chaos des nationalités ? C'est la question qui tourmente tous les intellectuels et tous les artistes de cette région. L'émancipation par la dissonance pouvait être, chez Arnold Schönberg, un beau programme de régénération de la composition musicale. En politique, c'est plutôt l'élimination de la différence qui a dominé les idéologies et les programmes depuis le tournant du siècle. Cette pluralité qui l'avait rendue possible fut aussi la cause de la destruction de la Mitteleuropa. La Vienne début de siècle, métropole culturelle de la Mitteleuropa, ne fut-elle pas, au même moment, la Vienne d'Hitler ?
Au début des années 1990, l'effondrement de l'empire soviétique a bouleversé la carte de l'Europe centrale et provoqué le retour des nationalismes. Les États multinationaux créés par les traités de 1919 sur les ruines de l'ancienne monarchie habsbourgeoise (Tchécoslovaquie et Yougoslavie) sont apparus comme des « Cacanies » en miniature, pour reprendre le nom du pays où Musil situe l'Homme sans qualités. Le retour des conflits nationaux a confirmé les pressentiments de ceux qui estimaient que, depuis le début du siècle, aucun ordre stable n'avait été trouvé pour cet espace où se touchent la Mitteleuropa, l'Europe balkanique et la Russie. Comme à l'époque de Freud, de Musil, de Kraus et de Wittgenstein, les temps modernes, dans cette région d'Europe, révèlent leur fatale contradiction : alors que les vieux États-nations apparaissent comme des cloisonnements périmés dans une civilisation « globalisée », des conflits ethniques et nationaux se déchaînent aux frontières de l'Union européenne.
Cette incompréhension et cette révolte que nous inspirent les conflits nationaux de la fin du xxe siècle, les intellectuels du tournant du siècle les éprouvaient déjà face au déchaînement des nationalismes et à la montée des racismes en tous genres qui annonçaient Les Derniers Jours de l'humanitépour reprendre le titre du grand drame historique que consacre Karl Kraus à la Première Guerre mondiale.
La modernité, une pensée du chaos ?
La modernité, dans l'ordre esthétique et théorique, peut être interprétée comme la représentation et l'interprétation de la crise culturelle provoquée par la modernisation. Si la modernité viennoise et la modernité des métropoles centre-européennes restent une de nos références intellectuelles les plus importantes, c'est parce qu'elles ont pensé la modernité sur fond de prémonition de la fin d'un monde. La modernité, pour beaucoup d'intellectuels viennois, relève d'une théorie du chaos. Ludwig Boltzmann a consacré une bonne part de ses recherches aux notions de désordre et d'entropie, soulignant que les états désorganisés, d'un gaz dans un récipient, par exemple, sont les plus fréquents, et que l'entropie d'un corps gazeux tend à s'accroître, non à se réduire. Boltzmann en déduisait une loi générale de la dégradation des systèmes ordonnés en états de désordre et de désorganisation, en somme de chaos. Dans l'Homme sans qualités de Robert Musil, le « paradigme de la nébulosité » permet de se représenter les « systèmes instables à évolution indéterminée » et la Cacanie est un système culturel dont l'entropie conduit au désordre éthique de « l'autre état » (dans la sphère individuelle) et au chaos de la guerre mondiale.
Même s'il paraît aventureux de passer trop rapidement de l'histoire culturelle à l'histoire des savoirs scientifiques, les analogies entre la crise socio-politique viennoise et certains modèles théoriques sont frappantes. À propos d'Ernst Mach, par exemple, on peut mettre en évidence une interaction entre la déconstruction de l'identité subjective du Je dans L'Analyse des sensations (1885) et la crise culturelle. Si les intellectuels et les artistes viennois ont vu dans la théorie psychologique d'Ernst Mach le manifeste de leur « crise d'identité » (avec sa Lettre de Lord Chandos [1902] Hofmannsthal reformule, dans l'espace de la fiction, certains problèmes soulevés par Ernst Mach), on peut supposer, à l'inverse, que la théorie scientifique de Mach elle-même participait de l'esprit de son temps.
Dans Sexe et caractère (1903), Otto Weininger, le génie maudit de la modernité viennoise qui se donna la mort à vingt-trois ans, peu après la publication de son ouvrage, partait du constat de Mach pour constater la ruine des notions classiques de l'identité, et pour appeler à la reconstruction du Masculin et du Féminin dans une perspective passionnément antiféministe, mais aussi à la distinction du Juif et du non-Juif (l'Aryen), poussant l'antisémitisme et la haine de soi jusqu'au paroxysme autodestructeur. L'Homme sans qualitésde Robert Musil présente des hommes et des femmes « sans identité », partis à la dérive dans un système culturel qui ne croit plus à ses valeurs et ne donne plus aucun sens à l'existence individuelle : la subjectivité se transforme en système autopoïétique instable.
Cette interprétation est encore plus plausible si l'on considère la critique du langage et l'attention portée aux faits de langue, qui sont des thèmes récurrents des systèmes théoriques de la Mitteleuropa et dont l'œuvre de Ludwig Wittgenstein constituent l'aboutissement. Le cas de Fritz Mauthner permet de comprendre comment la pluralité culturelle et l'entropie de l'ordre social traditionnel pouvaient conduire à cette forme singulière de la crise d'identité personnelle qui s'exprime dans le scepticisme linguistique et dans la recherche mystique. Dans ses Mémoires, Mauthner a décrit le sentiment de « chaos linguistique » que pouvait éprouver un juif de Bohême à la fin du xixe siècle : l'allemand et le tchèque s'imposaient comme les deux langues nationales indispensables, mais on utilisait l'hébreu dans le milieu juif religieux et le yiddish dans le milieu juif populaire.
Ce plurilinguisme n'avait aucune conséquence positive pour l'entente entre les peuples. L'interculturalité vécue au quotidien n'empêchait pas les clivages ethnico-linguistiques de s'approfondir, on parlait toutes les langues, mais on n'arrivait pas à se comprendre. Vanité cruelle des langues : même parfaitement maîtrisées, elles ne permettaient pas le dialogue. Marqué par la critique du langage exprimée par Nietzsche, Mauthner avait suivi à l'université de Prague les cours d'Ernst Mach. Cette conviction que le langage divise et isole au lieu de réunir les hommes, que les mots trompent l'individu sur la réalité, créent les malentendus et les conflits et qu'aucune vérité n'est accessible par leur biais, conduit Mauthner à un repli sur la subjectivité monologique, dont on ne peut sortir que dans les instants silencieux d'union mystique. Wittgenstein évoquera Mauthner dans son Tractatus logico-philosophicus, pour expliquer que, pour sa part, il ne cède pas au « scepticisme linguistique », mais cherche à faire coïncider l'ordre logique et l'ordre linguistique. Dans la deuxième phase de sa pensée, il analysera les jeux de langage pour mieux dissoudre les faux problèmes métaphysiques. La critique du langage aura été le thème principal de Karl Kraus, l'auteur de La Torche, la revue écrite presque par lui seul. Ce virtuose de la langue allemande se méfiait des beaux-parleurs comme de la peste : il démasquait le mensonge caché dans les discours (de la presse, de la politique, des soi-disant intellectuels, etc.), interprétant le relâchement de la langue comme le symptôme de la corruption morale de toute société. Ramener l'humanité au bon usage des mots lui paraissait le préalable au rétablissement d'une culture digne de ce nom. Chez Schnitzler, le monologue intérieur n'est pas, comme le monologue de la tragédie classique, la mise en scène d'une personnalité héroïque, mais au contraire la mise à nu des contradictions, des faiblesses et des incohérences de la subjectivité travaillée par l'impensé et gouvernée par l'inconscient.
Sigmund Freud, en neutralisant la politique pour la réduire à des catégories psychologiques, a exprimé d'une autre manière l'interaction entre l'individu et un système culturel et politique bloqué et menacé par le chaos. L'individu se sent condamné à assumer solitairement le désordre du monde et à réinventer ex nihilo le sens de son destin personnel. La construction de l'identité d'un « moi refuge » devrait lui permettre de se protéger contre la société et contre l'histoire en se repliant sur lui-même. Mais dès lors que ce « moi refuge » est assailli par les conflits familiaux ou sociaux qu'il avait intériorisés, son identité se réduit à un édifice instable d'identifications.
La modernité postcommuniste des années 1990 a retrouvé ce ton désabusé : contre les illusions des Lumières et de la rationalité « globalisante », après avoir vécu la dégradation des idées de la Révolution française en Terreur, après avoir vu la dictature des grands marchés succéder au totalitarisme de la culture d'État, les intellectuels de la Mitteleuropa sont beaucoup mieux que d'autres en mesure d'analyser la dynamique non intentionnelle de la société occidentale. À mesure que l'Europe, alors que s'achevait le xxe siècle, s'est rapprochée de son centre historique, elle a fait l'épreuve et le constat de la déliquescence des grands récits – l'Histoire, la Raison, le Progrès – qui la guidaient depuis l'âge des Lumières.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Jacques LE RIDER : directeur d'études à l'École pratique des hautes études
Classification
Médias
Autres références
-
CANETTI ELIAS (1905-1994)
- Écrit par Jacques LE RIDER
- 2 424 mots
- 1 média
Ayant connu dans son enfance la Belle Époque à l'est de l'Europe, en Bulgarie, puis à l'ouest, en Angleterre, avant de vivre en Autriche et en Allemagne les années convulsives de l'entre-deux-guerres, Elias Canetti est, selon les mots de Claudio Magris, « une des voix de cette... -
LA CONSCIENCE DE ZENO, Italo Svevo - Fiche de lecture
- Écrit par Gilbert BOSETTI
- 988 mots
- 1 média
Après l'insuccès de ses deux premiers romans, Une vie (1892) et Sénilité (1897), ignorés par la critique italienne alors que leur auteur n'est encore à Trieste qu'un sujet de l'Empire austro-hongrois, Italo Svevo (1861-1928) a renoncé à toute ambition littéraire. Toutefois, bien qu'absorbé...
-
HARMONIA CÆLESTIS (P. Esterházy)
- Écrit par Jacques LE RIDER
- 936 mots
- 1 média
Dans la magnifique floraison de la littérature hongroise d'aujourd'hui, se détache l'œuvre puissante et originale de Péter Esterházy. Depuis Trois anges me surveillent (1989), Le Livre de Hrabal (1990), Une femme (1998) et L'Œillade de la comtesse Hahn-Hahn - en descendant le Danube...
-
L'HOMME SANS QUALITÉS, Robert Musil - Fiche de lecture
- Écrit par Jacques LE RIDER
- 1 078 mots
- 1 média
Dans la deuxième partie se développe « l'Action parallèle » : un comité d'intellectuels et de hauts responsables politiques, économiques et militaires viennois s'efforce de programmer un événement autrichien qui serait capable de faire écho et contrepoint aux cérémonies de l'anniversaire de l'avènement... - Afficher les 14 références
Voir aussi
- EUROPE, histoire
- HISTOIRE LITTÉRAIRE
- AUTRICHE-HONGRIE ou AUSTRO-HONGROIS EMPIRE
- LITTÉRATURE THÉORIES DE LA
- WEININGER OTTO (1880-1903)
- MAUTHNER FRITZ (1849-1923)
- POLOGNE, histoire, de 1764 à 1914
- POLOGNE, histoire, de 1914 à 1945
- ALLEMANDE LANGUE
- AUTRICHIENNE LITTÉRATURE
- ALLEMANDES LITTÉRATURES
- JUIVE LITTÉRATURE
- JUIF HISTOIRE DU PEUPLE
- ALLEMAGNE, histoire, de 1806 à 1945
- RUSSIE, histoire, de 1801 à 1917
- LANGAGE & SOCIÉTÉ