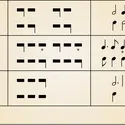MOTET
Article modifié le
Le motet classique
Sous l'influence du stile rappresentativo, né à Florence à la fin du xvie siècle, la musique religieuse change totalement de caractère. C'est le début de l'époque baroque. Claudio Monteverdi est l'un des premiers à appliquer à la musique d'église les principes de la monodie accompagnée et de la basse continue. Les motets de Monteverdi sont à une ou à deux voix avec accompagnement instrumental plus ou moins concertant. Carissimi, puis Legrenzi développent le procédé au point d'organiser le motet en une suite de récits, d'airs, de duos, de trios et de chœurs avec basse continue ou symphonie.
C'est aussi en Italie que naquit l' oratorio, ou drame sacré, dont le premier exemple est la Rappresentazione di anima e di corpo d'Emilio de' Cavalieri, datant de 1600. Ces vastes fresques ne manquèrent point d'avoir une influence sur l'évolution du motet, si bien qu'il est difficile de distinguer du point de vue du style, sinon du point de vue des dimensions, les grands motets de l'époque baroque des cantates et des oratorios. Les mêmes principes y sont appliqués.
En France, la Chapelle royale devient le creuset d'où sortira le grand motet de style versaillais, qui reste au xviiie siècle la forme presque unique de la musique religieuse.
Les précurseurs sont Nicolas Formé, Jean Veillot et Thomas Gobert. L'écriture harmonique remplace progressivement l'écriture contrapuntique ; les modes majeur et mineur modernes prennent le pas sur les vieux modes ecclésiastiques ; l'accompagnement instrumental se développe ; l'orchestre pénètre au sanctuaire. Lorsque Henry Du Mont et Pierre Robert accèdent ensemble à la direction de la Chapelle du roi, en 1663, la voie est ouverte pour l'éclosion des chefs-d'œuvre de l'école française. Pendant le règne de Louis XIV, on chante pour le roi trois motets aux offices quotidiens, et pour les offices solennels ces motets se doivent d'avoir plus d'éclat et d'ampleur. Il s'agit pour les musiciens de satisfaire leur souverain. Ils s'y emploient tant et si bien que les offices de la Chapelle royale deviennent une des manifestations les plus prestigieuses de la cour de Versailles.
De 1670 à 1683, Du Mont et Robert fournissent la majeure partie des motets chantés à la chapelle de Versailles : ce sont, pour la plupart, des motets à double chœur (petit chœur de solistes alternant avec le grand chœur) avec orchestre à cordes et basse continue (orgue).
Si Lully donne au théâtre le meilleur de lui-même, il écrit aussi des motets pour la Chapelle de Sa Majesté, dont certains tels le Miserere, le Quare fremuerunt gentes ou le Te Deum, sont des chefs-d'œuvre. Outre les cordes, les instruments à vent, et notamment les trompettes, renforcent l'éclat de ces grands motets de circonstance.
Parallèlement à la Chapelle royale, des églises, des cathédrales ou des couvents donnent à d'autres musiciens l'occasion d'enrichir le répertoire. Au couvent des Théatins, à Paris, l'Italien Paolo Lorenzani, protégé de Mme de Montespan, avant de devenir maître de chapelle au Vatican, fait connaître ses motets à une, deux, trois, quatre ou cinq parties avec symphonie et basse continue, qui, imprimés en 1693 et dédiés au roi, contribuent à accentuer l'influence italienne sur la musique française. Marc Antoine Charpentier, maître de musique des Jésuites, qui avait été l'élève à Rome de Carissimi, compose plus de cent motets, dont l'écriture dense, rehaussée des combinaisons instrumentales les plus variées, ne laisse pas de séduire un auditoire avide de retrouver à l'église tout le faste du théâtre lyrique. « Ainsi, remarque Claude Crussard, l'opéra, avec son style, sa pompe, ses interprètes, pénètre la musique religieuse et confère aux grandes fresques sonores d'un Lully, d'un Bernier, d'un Charpentier, d'un Delalande ou d'un Campra un caractère qui nous semble profane à côté des effusions mystiques d'un Schütz et de la méditation d'un Frescobaldi. »
Successeur de Lully dans la faveur de Louis XIV, nommé maître de la Chapelle en 1683, surintendant de la musique en 1689, Michel Richard Delalande (1657-1726) apparaît comme le chef d'école du motet classique français. S'il ne modifie pas la forme qui allait être celle de la cantate d'église chez Bach et Haendel, il en vivifie le contenu par la richesse de son imagination mélodique, la plénitude de son harmonie et la variété de l'instrumentation. Ses chefs-d'œuvre (De profundis, Beati omnes, Quare fremuerunt) marquent l'apogée du motet français.
Dans le même temps, André Campra (1660-1744), natif d'Aix-en-Provence, est successivement maître de chapelle à Aix, à Arles, à Saint-Étienne de Toulouse et à Notre-Dame de Paris ; puis, après une longue activité à l'Opéra, il est nommé à la tête de la Chapelle royale aux côtés de Delalande, de Bernier et de Gervais. Il produit plusieurs livres de motets à grand chœur et symphonie, où se mêlent les styles français et italien.
D'un caractère plus intime apparaissent les motets de François Couperin (1668-1733), mais tout aussi imprégnés d'italianisme.
Sous le règne de Louis XV, le Concert spirituel, fondé en 1725 par Philidor l'Aîné, allait devenir le haut lieu de la musique sacrée. On y entendit tout au long du règne les grands motets de Delalande, base du répertoire, mais aussi ceux de Bernier, d'Esprit Blanchard, de Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville, de Giroust et de Rameau qui perpétuent la tradition versaillaise.
En Italie, au xviiie siècle, les musiciens continuent dans la ligne tracée par leurs devanciers en donnant plus d'accent encore au caractère mondain, voire théâtral, de leurs œuvres : le motet semble plus destiné au concert qu'au sanctuaire. Citons, entre autres, Francesco Durante, Leonardo Leo, Niccolò Jommelli, tous napolitains.
Même évolution chez les Viennois depuis Johann Joseph Fux (1660-1741), maître de chapelle de la cour impériale, dont les motets et psaumes s'appuient encore sur l'écriture contrapuntique et les modes ecclésiastiques, jusqu'à Haydn et Mozart dont les œuvres religieuses sont italianisantes (par exemple, le célèbre Exsultate, jubilate).
Chez les Allemands, l'influence protestante donne plus d'austérité à la musique d'église, et le mysticisme l'emporte sur la mondanité. De Schütz à Bach en passant par Buxtehude et Pachelbel, la cantate et l'oratorio priment sur tout autre genre de musique sacrée.
Au xixe siècle, on trouve encore des motets sous la plume de Cherubini, de Schubert, de Mendelssohn, de Liszt, de Brahms, de Gounod, de Saint-Saëns... Il s'agit tantôt de morceaux pour chœurs et orchestre, tantôt de mélodies pour voix seule et orgue, ou encore de chœurs polyphoniques (Brahms). Le mot « motet » s'applique finalement à tout genre de composition religieuse autre que la messe ou l'oratorio. Il faut attendre la fin du siècle avec la fondation de la Schola cantorum (1896) pour que l'action de Charles Bordes et de Vincent d'Indy provoque un regain d'intérêt pour la musique ancienne et la tradition polyphonique. Le développement international de la musicologie agira dans le même sens.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Roger BLANCHARD : musicologue
Classification
Autres références
-
ALLEGRI GREGORIO (1582-1652)
- Écrit par Philippe BEAUSSANT
- 165 mots
Le nom d'Allegri est attaché au fameux Miserere à deux chœurs qui faisait partie du répertoire secret de la chapelle Sixtine, et que Mozart transcrivit de mémoire à treize ans, après une seule audition, à la stupéfaction de son entourage. Mais ce Miserere célèbre, et d'ailleurs fort...
-
ANTHEM, musique
- Écrit par Edith WEBER
- 586 mots
Du vieil anglais anteifn, du grec et du latin antifona, de l'espagnol et de l'italien antifona, l'anthem, forme de musique religieuse anglicane, est une paraphrase libre (et non une traduction littérale anglaise) de textes bibliques (psaumes de David, en particulier), chantée pendant...
-
ARS ANTIQUA
- Écrit par Edith WEBER
- 1 877 mots
- 2 médias
...triplum, quadruplum) en tant que solemnisation de l'office (Léonin, Pérotin). Elle tombe en désuétude vers la fin du xiiie siècle, au profit du motet religieux, profane ou amoureux. Des paroles (motetus, motulus) sont placées sous la voix organale ; le motet comprend une teneur (vox prius facta... -
ARS NOVA
- Écrit par Roger BLANCHARD
- 6 360 mots
- 2 médias
Nous avons défini ci-dessus la technique du motet isorythmique ; il nous faut revenir sur la forme motet et en retracer l'évolution. - Afficher les 41 références
Voir aussi
- DÉCHANT
- CANTUS FIRMUS
- RENAISSANCE MUSIQUE DE LA
- MÉDIÉVALE MUSIQUE
- LORENZANI PAOLO (1640-1713)
- MÉLISME, musique
- VERSAILLAIS STYLE MUSICAL
- TENEUR, musique
- DIAPHONIE, chant
- ORGANUM
- ISORYTHMIE, musique
- MUSIQUE OCCIDENTALE, de l'Antiquité au XVIe siècle
- MUSIQUE OCCIDENTALE, XVIIe siècle
- MUSIQUE OCCIDENTALE, XVIIIe siècle