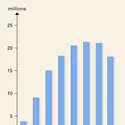OUVRIER MOUVEMENT
Article modifié le
Le mouvement ouvrier est devenu une des données fondamentales du monde contemporain. Ne serait-ce d'abord qu'au point de vue quantitatif. On peut à l'heure présente évaluer à environ deux cents millions les effectifs des ouvriers qui adhèrent aux principales centrales syndicales internationales. Ces chiffres sont au total impressionnants quand on songe que ces centrales sont relativement récentes. Néanmoins, ils ne correspondent qu'à une minorité de la classe ouvrière, le taux de syndicalisation variant beaucoup suivant les pays, les professions et même la conjoncture. Il conviendrait d'ajouter à ces chiffres ceux des adhérents aux coopératives ouvrières ou aux partis politiques se réclamant de la classe ouvrière.
Le fait même qu'il s'agit d'une « minorité organisée » démontre que l'histoire du mouvement ouvrier ne se confond ni avec une histoire du travail, ni même avec une histoire des travailleurs. Par contre, on doit rattacher au mouvement ouvrier des individus qui n'appartiennent pas à sa classe ouvrière mais qui s'affirment, par adhésion à un parti politique ouvrier, solidaires de la classe ouvrière.
Essayant précisement de différencier l'histoire du mouvement ouvrier de l'histoire des travailleurs, Marcel David, dans son ouvrage Les Travailleurs et le sens de leur histoire (1967), parvient à la définition suivante : « Par mouvement ouvrier, on entend [...] la série d'institutions où se retrouvent les travailleurs et tous ceux qui choisissent de militer à leurs côtés, conscients les uns et les autres de leur solidarité et de l'utilité pour eux de s'organiser en vue de préciser leurs objectifs communs et d'en poursuivre la réalisation. »
De cette définition, se dégagent quatre composantes essentielles, que l'on peut sans doute distinguer mais qui sont, à vrai dire, devenues inséparables dans le mouvement réel de l'histoire. Pour qu'il y ait mouvement ouvrier, il faut, premièrement, qu'il y ait des « institutions », c'est-à-dire des organisations (syndicales, coopératives et politiques) ; deuxièmement, que les travailleurs qui y participent soient parvenus à une conscience (plus ou moins complète et plus ou moins durable) de la solidarité de fait qui les unit. Il convient troisièmement que des objectifs aient été définis. Ces objectifs peuvent être à court terme (simplement défensifs ou revendicatifs) ou à long terme (visant à une profonde mutation des bases mêmes de la société capitaliste, voire à son renversement et à son remplacement par un autre type de société). Ce qui implique une réflexion sur le sens de l'histoire, c'est-à-dire une idéologie. On ne peut sans doute pas appliquer à toutes les étapes du mouvement ouvrier la formule de Lénine « Sans théorie révolutionnaire, pas de mouvement révolutionnaire » (Que faire ? 1902). Mais on peut dire qu'il n'y a pas mouvement ouvrier s'il n'y a pas, au moins, des éléments de méditation théorique, que ces éléments surgissent spontanément au cours de la « pratique » ouvrière ou qu'ils soient apportés de l'extérieur.
C'est pour cette raison qu'il n'est pas possible d'opposer artificiellement le « syndical » au « politique » et que, si le mouvement ouvrier, au sens strict du terme, a pour objectif essentiel l'amélioration du niveau de vie et des conditions de travail, il ne peut être, dans la réalité historique, séparé du socialisme qui est avant tout un mouvement politique et une théorie. Même si le syndicat, dans certains pays, se trouve totalement indépendant du parti politique, l'action syndicale dans le monde contemporain où le rôle de l'État a considérablement grandi ne peut pas ne pas avoir des implications politiques. Quand on est amené à évoquer les objectifs du mouvement ouvrier, on doit constater qu'ils ont inévitablement une nature politique. Quatrièmement, enfin, il n'y a pas de mouvement ouvrier s'il n'y a pas de lutte, c'est-à-dire combat collectif pour la réalisation des objectifs que le mouvement ouvrier a fixés.
Voilà déjà qui explique que toute histoire du mouvement ouvrier doit, pour être totale, mettre en avant des considérations en apparence diverses. C'est une problématique qui touche à l'histoire des organisations et à leur typologie (comment apparaissent-elles ? comment se différencient-elles ? quel est leur impact réel ?), à l'analyse des mutations de la conscience de la solidarité ouvrière (quels sont ses degrés ? comment s'exprime-t-elle au niveau de l'individu ?), à la recherche des buts poursuivis (comment se définissent-ils ? et sous quelles influences ?) et à l'étude des formes de lutte (ont-elles évolué au cours de l'histoire ?).
Pour toutes ces raisons, l'histoire du mouvement ouvrier ainsi défini doit faire appel à plusieurs disciplines voisines. Elle est liée à la sociologie, dans la mesure où on peut faire état d'enquêtes sociologiques réalisées dans le passé et dans la mesure où les méthodes propres à la sociologie peuvent permettre une interprétation plus pertinente des documents anciens. Il convient de prendre appui sur l'histoire économique, car les pulsations à court terme et à long terme de l'économie ont une influence directe sur les salaires, sur le plein emploi, et, par voie de conséquence, sur les luttes ouvrières. De plus en plus, les organisations syndicales tiennent compte de la conjoncture pour mener à bien les luttes dont elles assument la responsabilité. La démographie historique permet une meilleure exploitation de certaines statistiques et éclaire l'historien du mouvement ouvrier sur les migrations ouvrières, leurs importances, leurs motivations et leurs conséquences. L'histoire des techniques contribue à l'explication des changements qui s'opèrent dans la composition de la classe ouvrière. La science du droit comporte un secteur spécial consacré à ce qu'il est convenu d'appeler la législation sociale. Il est nécessaire aussi de s'initier aux travaux touchant l'histoire des mentalités, car ils peuvent aider à comprendre la naissance et l'évolution de la conscience de classe parmi les ouvriers. En outre, le socialisme étant inséparable du mouvement ouvrier, l'histoire des idées est un instrument de travail indispensable. Il y a enfin l'environnement politique ; il influe sur les conditions de l'essor du mouvement ouvrier, le freinant ou le favorisant selon les circonstances. D'autre part, à mesure que s'affirme le mouvement ouvrier, il agit à son tour et de façon de plus en plus radicale sur cet environnement politique. Comment, par exemple, comprendre les modes politiques de notre temps sans référence au mouvement syndical et aux partis socialistes et communistes ? En dernière analyse, le mouvement ouvrier est lié par un phénomène d'interaction à la formation économico-sociale dans laquelle il se développe – même quand il en conteste les principes d'organisation.
Cependant, quels que soient les apports des sciences parallèles, l'histoire du mouvement ouvrier a son domaine propre et par conséquent ses méthodes propres. De grands progrès ont été accomplis ces dernières années. Le temps s'éloigne où l'historien se satisfaisait d'une histoire institutionnelle (celle des organisations, de leur congrès, de leurs résolutions) ou d'une histoire-bataille (le récit des grèves) ou d'une histoire-idéologique (l'analyse des diverses écoles socialistes) ou encore d'une histoire-biographie (le destin des militants les plus influents). On est maintenant à la recherche d'une histoire totale qui, partant de l'infrastructure (état réel de la classe ouvrière), cherche à saisir, à décrire et finalement à expliquer le mouvement ouvrier sous tous ses aspects.
On ne saurait donc dans les limites d'un article esquisser une histoire d'un mouvement ouvrier qui est devenu mondial. Après avoir traité de la problématique de cette histoire, on évoquera ce qu'on peut appeler la « préhistoire » des mouvements ouvriers. On analysera les obstacles que ce mouvement a rencontrés sur sa route pour conclure sur une proposition de périodisation.
Définitions et problématiques
Prolétariat et mouvement ouvrier
Le mouvement ouvrier proprement dit n'apparaît qu'avec la révolution industrielle dont une des conséquences est la concentration de la main-d'œuvre dans des fabriques, propriétés d'hommes qui disposent de capitaux de plus en plus importants et utilisent des machines mues par des sources d'énergie nouvelles. Cette révolution industrielle transforme la condition du « travailleur », même si ses effets ne se font sentir que progressivement ou le plus souvent au travers de crises économiques. Le travailleur entièrement dépossédé de la propriété des moyens de production devient un « prolétaire ». Il cesse d'être relativement isolé et indépendant pour s'insérer dans une collectivité. Il est soumis à une discipline stricte. Peu à peu, il se dépersonnalise dans l'acte même du travail, condamné à n'être qu'un rouage dans le processus d'une production dont la forme est de plus en plus sociale. Il est un travailleur dont la tâche est parcellaire. Il subit le chômage, les baisses de salaire, les à-coups de la conjoncture. Sa femme et ses enfants sont eux aussi entraînés dans l'enfer de la fabrique et la famille entière est exploitée en tant que force de travail collective.
On aboutit ainsi à une définition du prolétaire qui semble faire l'unanimité des historiens : « le prolétaire peut être défini comme un travailleur vivant exclusivement de la force de ses bras, subsistant au jour le jour d'un salaire, comme un « déraciné », mais aussi comme un « dépendant » tenu par un lien très fort de subordination. » (Pierre Léon). Cette définition admise, il devient possible de mettre en lumière les caractéristiques du mouvement ouvrier telles qu'elles se dégagent d'une réflexion sur son histoire. En d'autres termes, c'est avec l'essor de la grande industrie capitaliste que la lutte des travailleurs prend une extension telle et revêt des formes spécifiques telles qu'on peut désormais parler de mouvement ouvrier.
Toutefois, on ne saurait considérer comme identiques les deux termes de « prolétariat » et de « mouvement ouvrier ». L'existence du prolétariat comme « classe en soi » ne suffit pas pour qu'il y ait mouvement ouvrier. Il faut qu'on puisse observer une certaine généralisation des luttes ouvrières, un effort sensible d'organisation, la définition de buts (au moins à court terme) et les premières manifestations de la conscience de classe.
« Classe en soi » et « classe pour soi »
Le mouvement ouvrier ne se développe pas de façon linéaire ; il y a dans son histoire un décalage entre « la classe en soi » et « la classe pour soi ». La conscience de classe n'apparaît ni immédiatement ni spontanément. Spontanément, en effet, la classe ouvrière est écartelée entre des tendances centrifuges ; car, en tant que vendeurs de leur force de travail, les ouvriers sont dans une situation de concurrence. C'est une donnée que Karl Marx avait éclairée dès 1847 dans des notes qu'il avait prises pour une conférence sur Travail salarié et capital. Il esquissait alors une typologie des concurrences entre ouvriers : la concurrence des « inoccupés », celle des ouvriers habitués à des salaires inférieurs (exemple : les Irlandais), celle des ouvriers célibataires dont les besoins sont moins élevés que ceux des ouvriers mariés et chargés de famille, celle des travailleurs venus directement de la campagne. Dans les Manuscrits de 1844, Karl Marx observait déjà que cette concurrence tend à s'aiguiser : « Du fait que le nombre des capitalistes a diminué, écrivait-il, leur concurrence dans la recherche des ouvriers n'existe plus, et, du fait que le nombre des ouvriers a augmenté, leur concurrence entre eux est devenue d'autant plus grande, plus contraire à la nature et plus violente. » Ces tendances centrifuges peuvent revêtir des formes modernes dans des revendications de type corporatif ou sectoriel opposant telle catégorie d'ouvriers à telle autre.
La conscience de classe en tant que conscience d'une solidarité face aux « donneurs de travail », apparaît et se développe par la pratique, à travers les luttes ouvrières. Ces luttes ont en effet deux conséquences. D'un côté, par leur succès mais aussi par leurs échecs, elles démontrent aux ouvriers que, quelles que soient les conditions particulières dans lesquelles chacun doit offrir sa force de travail, il y a entre tous communauté d'intérêts. D'un autre côté, les ouvriers ont l'impression d'appartenir à une classe déterminée dans la mesure où ils sont conduits à s'opposer à une autre classe, le patronat, soutenue par l'État. Dans le même temps, le rassemblement à l'intérieur d'une même fabrique facilite, par l'identité des conditions de travail et de discipline, la prise de conscience d'une certaine solidarité, d'autant plus que, fréquemment, ces ouvriers se retrouvent entassés dans les mêmes quartiers. Ce n'est peut-être pas encore la conscience de classe, mais c'est au moins « un sentiment de classe » (Jürgen Kuczinski).
Cette conscience, bien que conscience collective, apparaît évidemment dans l'individu-ouvrier. C'est en lui, en dernière analyse, qu'il convient de la saisir et souvent au travers de formes d'expression diverses. D'où l'intérêt pour la quête des médiations et des relais, toujours complexes, des biographies de militants ou des mémoires que d'aucuns ont pu laisser à la postérité. Les témoignages directs sont dans l'ensemble assez rares. Le militant ouvrier, surtout l'ouvrier du rang, s'exprime peu, au moins littérairement. Plus qu'un homme d'écrit, il est un homme de discours. La connaissance que l'on peut prendre de la mentalité ouvrière à travers l'histoire est donc le plus souvent indirecte et nécessite un effort plus grand d'interprétation. Toutefois, avec les progrès de l'organisation, on dispose des discussions de congrès, de la presse, voire des procès ou des archives policières – à utiliser malgré tout avec précaution.
Les niveaux de la conscience de classe
Une histoire du mouvement ouvrier ainsi envisagée conduit à dégager des niveaux dans la conscience de classe : formes inférieures et formes supérieures de la conscience de classe, et leurs intermédiaires. La forme supérieure, c'est la conscience révolutionnaire, c'est-à-dire la conscience d'appartenir à une classe dont la lutte s'insère dans le mouvement réel de l'histoire. Elle ne dépend pas seulement de la pratique (luttes ouvrières), mais aussi de la pénétration d'une conception scientifique du développement social. Dans un certain contexte historique, cette forme supérieure de la conscience est apportée de l'extérieur. Elle naît de l'assimilation par une élite militante – dont l'influence sur la masse ouvrière croît – de doctrines élaborées par des intellectuels : ainsi du marxisme tel qu'il a été formulé du vivant de Marx et d'Engels. C'est la thèse développée en 1902 par Lénine dans Que faire ? À une époque plus récente, les partis peuvent jouer ce rôle, d'où l'expression de A. Gramsci qui les qualifie d'« intellectuels collectifs ». Le développement de la conscience de classe est donc un processus complexe. Il peut être plus ou moins rapide, plus ou moins complet, selon les pays, selon les secteurs professionnels, et aussi selon la conjoncture. À une certaine étape du mouvement ouvrier (l'exemple français est tout particulièrement signifiant), ce sont les artisans qui, plus instruits, davantage enracinés dans des traditions politiques, ont élevé le niveau de la conscience de classe dans un prolétariat sans doute concentré, mais récemment arraché à la campagne, où dominaient les mentalités individualistes. Cependant, très tôt, alors même qu'ils n'ont subi aucune influence doctrinale importée de l'extérieur, les travailleurs d'usine ont le sentiment qu'ils constituent un monde à part. « Le prolétaire a conscience de sa situation » lit-on dans un texte allemand en 1844 ; « en cela, le prolétaire se distingue essentiellement du pauvre qui accepte son destin comme un effet de la providence divine et ne demande rien d'autre qu'aumônes et fainéantise. Ensuite, le prolétaire a compris qu'il se trouve dans un état intolérable et injuste ; il réfléchit et se sent un désir ardent de propriété ; il veut avoir sa part aux joies de l'existence ; il met en doute le fait qu'il doive passer sa vie dans la misère parce qu'il y est né ; à cela s'ajoute la conscience de sa force : il s'est rendu compte que le monde a tremblé devant lui et ce souvenir le rend audacieux ; il en arrive à ne plus reconnaître les lois et le droit. Jusque-là, la propriété a été considérée comme un droit, il en fait un vol » (Anonyme, Über den vierten Stand und die sozialen Fragen, cité par Kuczinski dans Les Origines de la classe ouvrière).
Diversité des formes et des doctrines
À mesure que le mouvement ouvrier se renforce, il se développe sur plusieurs fronts : un front économique (la défense des revendications), un front politique (le problème des rapports avec le pouvoir : faire pression sur lui tel qu'il est ou s'en emparer pour en changer la nature), un front doctrinal (la mise en cause du principe du régime capitaliste et la contestation des idéologies qui tentent de le justifier). Ce qui entraîne d'ailleurs une très grande diversité d'organisations et de doctrines. L'organisation syndicale est, avec les partis politiques, une des composantes essentielles du mouvement ouvrier. Les partis ouvriers apparaissent plus tardivement, car ils ne peuvent être que le résultat d'une maturation politique. À quoi il convient d'ajouter les coopératives – de production et de consommation – les associations de jeunes et de femmes. Les relations entre ces différents types d'organisations varient en fonction des traditions historiques et de l'impact de certaines conceptions doctrinales. En Angleterre, par exemple, le Parti travailliste (Labour Party) est né d'une initiative des syndicats et il y a une liaison organique entre les deux organisations. En Belgique, la fusion est totale entre les trois formes d'organisation ouvrière : le parti, les syndicats et les coopératives. En France au contraire, la tendance dominante, tout au moins jusqu'au début du xxe siècle, est celle de la séparation du syndicat et du parti. Selon les théories, la primauté est donnée tantôt au parti (conception marxiste-léniniste), tantôt au syndicat (conception anarcho-syndicaliste héritée, pour une part, de Proudhon). Entre ces deux extrêmes, l'histoire révèle bien des positions intermédiaires. Le mouvement ouvrier peut ne se préoccuper que de la satisfaction des intérêts immédiats de la classe ouvrière ; dans ce cas – et c'est l'orientation actuelle du mouvement syndical américain –, il ne met pas en question la structure du régime capitaliste et se constitue en groupe de pression parmi d'autres. Le mouvement ouvrier peut être qualifié de réformiste quand, tout en poursuivant l'instauration d'une société socialiste, il pense y parvenir par une série de réformes. Sans nier l'intérêt des réformes, le mouvement ouvrier à tendance révolutionnaire considère la réforme comme un simple relais et vise à la transformation complète de la société – cette transformation impliquant selon les circonstances l'intervention de la violence ou une action pacifique des masses (les deux voies peuvent d'ailleurs être combinées).
Si, dans l'ensemble, et depuis la fin du xixe siècle, le marxisme tend à l'emporter sur les autres théories socialistes qui inspirent le mouvement ouvrier, il existe à côté de lui – ou en face de lui – des courants de pensée divergents. Aujourd'hui comme hier, il faut faire place à une certaine influence religieuse (il y a un mouvement ouvrier chrétien, marqué par l'encyclique Rerum novarum en 1891), aux séquelles ou aux résurgences du blanquisme et du proudhonisme, et surtout à l'anarchisme.
Variantes nationales
Mouvement propre à une classe qui se définit d'abord en s'opposant, le mouvement ouvrier s'inscrit dans un contexte social plus général. La tendance à l'internationalisation ne doit pas dissimuler que c'est, malgré tout, dans un cadre national que se développent les luttes ouvrières et que ce cadre national a, en dernière analyse, une influence décisive. C'est ainsi que l'Angleterre est d'abord remarquable par l'antériorité de ses organisations ouvrières (surtout syndicales) et par la prédominance du courant réformiste (le trade-unionisme). Le cas de la France est bien différent. La Révolution de 1789 a marqué profondément le mouvement ouvrier français, dont les préoccupations politiques sont demeurées un trait caractéristique ; son histoire est jalonnée par des explosions révolutionnaires dans lesquelles le rôle des ouvriers est de plus en plus déterminant : 1830, 1831-1834, 1848, 1871. D'autres mouvements ouvriers – en Allemagne et en Italie, par exemple – sont nés dans des pays qui n'avaient pas réalisé encore leur unité politique, d'où un mélange d'objectifs nationaux et sociaux parfois contradictoires. Toutes proportions gardées et compte tenu de l'héritage colonial, on retrouverait les mêmes caractéristiques dans les pays en voie de développement.
Le mouvement ouvrier américain a longtemps supporté le poids de ses origines. Au départ, la terre inoccupée ne manquait pas ; l'ouvrier avait l'illusion qu'il n'était pas éternellement rivé à sa condition de prolétaire et qu'il pouvait personnellement s'en arracher sans bouleversement révolutionnaire : il lui suffisait de partir comme défricheur vers l'Ouest ; ce n'était pas la fortune à coup sûr, mais c'était en tout cas l'évasion et une chance. Aussi, a-t-on vu fréquemment s'épanouir aux États-Unis le socialisme agraire et l'utopisme. Si le socialisme utopique est né dans l'Europe industrialisée (Angleterre, France, Allemagne rhénane), c'est aux États-Unis qu'on a tenté de le réaliser, précisement parce que par-delà l'Atlantique, dans ces immenses réserves de terres vierges, tout semblait possible. Les richesses naturelles y étaient d'une telle abondance et les habitants si peu nombreux que chacun pouvait légitimement espérer en avoir sa part. La classe capitaliste apparaissait comme une classe ouverte à laquelle, pourvu qu'il fût habile et sans scrupule, un ouvrier pouvait accéder. Dès lors, à quoi bon la révolution, puisque chacun pouvait réaliser son destin individuel dans le cadre du régime capitaliste ? L'immigration, la présence des Noirs formant un sous-prolétariat, accentuaient la concurrence et contribuaient à diviser la classe ouvrière américaine. « Une importance immense appartient à l'émigration, qui divise les ouvriers en deux groupes, les indigènes et les étrangers, et ceux-ci primo en Irlandais, secundo en Allemands, tertio en toute une série de groupes dont les membres ne peuvent communiquer qu'entre eux, savoir : Tchèques, Polonais, Italiens, Scandinaves, etc. Et par-dessus le compte, il y a les Noirs. Il faut des conditions très favorables pour constituer un parti unique avec ces éléments. Parfois il se produit soudain un puissant élan, mais il suffit à la bourgeoisie de lui résister passivement pour que les éléments disparates des masses ouvrières se désagrègent de nouveau » (lettre d'Engels à Sorge, 2 déc. 1893). Ces temps sont révolus, mais ils ont donné au mouvement ouvrier américain une base de départ originale.
Depuis 1917, enfin, tout un secteur géographique du mouvement ouvrier est intégré dans un monde qui construit le socialisme. Les problèmes qui se posent à lui sont nouveaux, puisque le parti marxiste joue le rôle de parti dirigeant. Les syndicats peuvent gérer des services qui concernent les travailleurs, telle la sécurité sociale. Ils sont directement intéressés au développement de la production et invités à participer à l'élaboration, à la réalisation et au contrôle des plans. Marcel David observe que, « loin de réaliser une mise hors circuit de la tendance émancipatrice, le passage au socialisme correspond au franchissement par celle-ci d'un seuil au-delà duquel les conditions de son devenir sont qualitativement transformées parce que débarrassées des entraves qui en régime capitaliste bornent irrémédiablement leur horizon » (Les Travailleurs et le sens de leur histoire). Toutefois, l'expérience historique des pays socialistes, le surgissement de certaines crises graves démontrent que les syndicats ne doivent pas renoncer à leur mission revendicative. Faute de quoi, des décisions risquent d'être prises qui, concernant les normes de travail, les prix des denrées de première nécessité, les salaires, les conditions de vie, peuvent aller à l'encontre des intérêts ouvriers.
Les obstacles
Obstacles internes
Il existe d'abord des obstacles internes au développement du mouvement ouvrier, qui tiennent aux conditions mêmes d'existence et de développement des classes ouvrières. Malgré les progrès de la conscience de classe, la concurrence entre les ouvriers ne disparaît jamais complètement. Elle se manifeste sous des formes diverses : opposition l'une à l'autre des catégories professionnelles, influence des idéologies de la classe dominante qui préconisent l'intégration du prolétariat au système capitaliste, existence dans certains pays et à certains moments d'une aristocratie ouvrière dont le niveau de vie est nettement supérieur à celui de la masse ouvrière, survivance du nationalisme, voire d'une sorte d'esprit de supériorité virant à la xénophobie ou au racisme quand les employeurs font appel à une main-d'œuvre étrangère – et cela en dépit des campagnes des partis ouvriers et des syndicats.
L'ignorance a été pendant longtemps un autre obstacle au développement du mouvement ouvrier. L'instruction élémentaire a fini par se généraliser, ne serait-ce que parce qu'elle devient économiquement indispensable, en raison de la complexité croissante du processus industriel. Mais la ségrégation culturelle demeure néanmoins une des caractéristiques des sociétés capitalistes. Le mouvement ouvrier a réagi en organisant lui-même la formation de ses militants et en développant une politique de diffusion de la culture. Une des motivations de la lutte pour la diminution de la journée de travail a été la conquête du droit au repos, mais aussi celle du droit au loisir (« huit heures de travail, huit heures de repos, huit heures de loisirs »). Les ouvriers ont été pendant longtemps écartés par le système électoral de toute participation à la vie politique. En France, il a fallu attendre 1848 pour que le suffrage universel soi définitivement établi – et encore a-t-il été fréquemment « tourné ». En Angleterre, c'est seulement en 1867 et en 1884 que le droit de vote est accordé à la majorité des travailleurs urbains.
Obstacles externes
Le mouvement ouvrier doit en outre surmonter des obstacles externes. On doit entendre par là tout appareil répressif mis en place contre les ouvriers.
La France fournit un excellent exemple de l'ancienneté et de la continuité de la politique répressive. En août 1539, les ordonnances de Villers-Cotterets font « défense à tous les compagnons et ouvriers de s'assembler en corps sous prétexte de confréries ou autrement, de cabaler entre eux pour se placer les uns les autres chez les maistres ou pour en sortir, ni d'empêcher de quelque manière que ce soit lesdits maistres de choisir eux-mêmes leurs ouvriers soit français soit étrangers ». Cette interdiction est renouvelée plus de deux siècles après par les lettres patentes du 2 janvier 1749. La loi Le Chapelier de juin 1791 aboutit aux mêmes conclusions – mais, cette fois, au nom de « l'intérêt particulier de chaque individu ». Les articles 414, 415 et 416 du Code pénal de 1810 prévoient en cas de coalition des peines plus dures pour les ouvriers que pour les employeurs. Le contrat de louage de services, tel qu'il est réglementé par le Code civil de 1804, établit un statut d'inégalité entre le maître et l'ouvrier : « le maître est cru sur son affirmation pour l'année échue et pour les comptes donnés pour l'année courante » ; c'est ce qu'on appelait en Angleterre la loi Master and servant (Maître et serviteur). La loi du 1er décembre 1803 pourvoit chaque salarié d'un livret qui le met dans la dépendance stricte d'un employeur. Un des objectifs du mouvement ouvrier fut d'obliger la bourgeoisie à desserrer le carcan. Cela ne s'est pas fait sans lutte, d'autant que certaines conquêtes sont fréquemment remises en cause quand la conjoncture apparaît favorable à la bourgeoisie. Le mouvement de libération du prolétariat ne progresse pas sans à-coups. Ainsi, avec l'apparition du fascisme dans les pays où il a exercé sa domination, les organisations ouvrières ont été dissoutes. En dehors des objectifs à long terme qu'il cherche à atteindre, le mouvement ouvrier a donc dû mener un combat quotidien pour s'assurer les libertés nécessaires à son essor.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Jean BRUHAT : maître assistant à la faculté des lettres et sciences humaines de Paris
- Bernard PUDAL : professeur émérite de science politique
Classification
Médias
Autres références
-
ABSTENTIONNISME
- Écrit par Daniel GAXIE
- 6 314 mots
- 3 médias
L'affaiblissement desmouvements ouvrier et catholique a joué un rôle important dans la progression de l'abstention des milieux populaires. Du fait de la désindustrialisation, des délocalisations, du chômage, du démantèlement des communautés ouvrières et de l'effondrement du communisme, les multiples... -
ADLER MAX (1873-1937)
- Écrit par Raoul VANEIGEM
- 648 mots
Longtemps occulté par la prépondérance de l'idéologie bolchevique, le rôle de Max Adler, l'un des principaux représentants de l'austro-marxisme, s'éclaire d'une importance accrue à mesure qu'on redécouvre les tendances anti-autoritaires apparues dans l'évolution de la doctrine marxiste....
-
AFL-CIO (American Federation of Labor-Congress of Industrial Organizations)
- Écrit par Claude JULIEN et Marie-France TOINET
- 6 914 mots
- 2 médias
...ancienne. Avant même la Déclaration d'indépendance (1776), les artisans se regroupent en sociétés d'entraide pour parer à la maladie ou au décès des adhérents. Très rapidement, à la fin du xviiie siècle, des organisations de défense se constituent, par métier (charpentiers, imprimeurs ou cordonniers) dans les... -
AMIENS CHARTE D' (1906)
- Écrit par Paul CLAUDEL
- 865 mots
Motion votée au IXe congrès confédéral de la C.G.T., tenu du 8 au 16 octobre 1906, la Charte d'Amiens est considérée comme le texte fondamental du syndicalisme révolutionnaire.
La C.G.T. avait été créée au congrès de Limoges en 1895 par la Fédération des Bourses du travail...
- Afficher les 88 références
Voir aussi
- INTERNATIONALE PREMIÈRE (1864-1876)
- RÉVOLUTIONS DE 1848
- SOCIALISME UTOPIQUE
- TRADE UNIONS
- OUVRIÈRE CLASSE
- COMPAGNONNAGE
- MAÎTRISE
- LUDDISME
- INTERNATIONALE DEUXIÈME (1889-1914)
- BRISEURS DE MACHINES
- TRAVAILLEURS ÉTRANGERS
- RÉPRESSION
- LUTTE DE CLASSES
- HISTOIRE SOCIALE
- IMMIGRATION
- CES (Confédération européenne des syndicats)