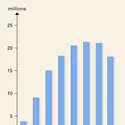OUVRIER MOUVEMENT
Article modifié le
Un lointain héritage
Pauvres contre riches
On ne peut séparer l'histoire du mouvement ouvrier des luttes ouvrières qui ont précédé sa formation. Il n'y a pas de solution de continuité. Certaines formes de lutte et certains types d'organisation se sont maintenus longtemps après qu'aient disparu les conditions qui les avaient fait naître. Des mentalités anciennes survivent qui peuvent contribuer à la formation de la conscience de classe.
À travers les âges, le monde du travail, quelle que soit sa forme d'organisation, s'est trouvé en opposition avec ceux qui profitaient du labeur ouvrier.
Il n'est pas besoin d'évoquer les temps lointains de la XVIIIe dynastie égyptienne qui, selon la chronique, virent « les nobles en deuil » et « les plébéiens exulter », ou la révolte de Spartacus dont le nom a souvent servi de symbole au prolétariat révolutionnaire. Le Moyen Âge à l'aube des temps modernes est suffisamment évocateur ; à cette époque, les ouvriers proprement dits se distinguent mal du « commun » et du « menu peuple ». Henri Pirenne tombe dans l'anachronisme lorsqu'il écrit qu'il n'est « pas exagéré de dire qu'aux bords de l'Arno comme aux bords de l'Escaut les révolutionnaires ont voulu imposer à leurs adversaires la dictature du prolétariat » (Histoire de la Belgique). Toutefois, le vocabulaire médiéval est très significatif de la nature de ces affrontements sociaux. D'un côté, les « petits », les « maigres », les « mécaniques », la « gent vile et de petit estat », les « ongles bleus », les « mains calleuses », le « popolo minuto », les « ciompi », les « populari », les « vilains », les « Jacques », les « croquants », le « fol peuple », etc. De l'autre côté, les « grands », les « gros », les « gras », les « mains blanches », les « bonshommes », les « hommes véritables », etc. Autant de mots qui, s'agissant du petit peuple, distinguent mal les urbains des ruraux, mais témoignent clairement de l'opposition entre les pauvres et les riches.
Premières luttes
Ces siècles sont jalonnés d'« effrois » et de « commotions », avec des années particulièrement dures : la décennie 1375-1385 marquée par la révolte de Gand (1379), celle des ciompi florentins (1378), celle de Wat Thyler en Angleterre (1381).
Au sein des métiers, des grèves sont signalées aux xive et xve siècles. Si l'idée que l'arrêt du travail est l'arme efficace entre les mains de ceux qui travaillent est fort ancienne, le mot grève apparaît tardivement. La définition qu'en donne le Littré en 1865 demeure toujours valable : « Coalition d'ouvriers qui refusent de travailler tant qu'on ne leur aura pas accordé certaines conditions qu'ils réclament ». Antérieurement, les mots varient suivant les régions et les époques. On parle de taquehan,de coquehan, de tric, de cabale, de cloque, d'herelle, de monopole, etc. À la fin du xiie siècle, on trouve dans les Coutumes du Beauvaisis de Beaumanoir une définition du takehan qui ne laisse aucun doute sur cette forme de lutte : « Alliance faite contre le commun profit quand aucunes manières de gens s'accordent qu'ils ne travailleront plus à si bas prix comme avant, mais croissent le prix, de leur autorité, et s'accordent qu'ils ne travailleront pas pour moins et mettent entre eux peines ou menaces contre les compagnons qui ne tiendront pas leur alliance ». En Angleterre, le mot strike avec le sens d'« arrêt du travail » n'apparaît guère qu'au début du xixe siècle. Mais l'expression to strike work (arrêter le travail) est utilisée au xviiie siècle.
Dans les temps modernes, à mesure que se développe l'industrie, les affrontements sociaux dans les villes prennent de plus en plus le caractère de luttes ouvrières, telle la grève des imprimeurs lyonnais qui commence en 1539 et qu'étudia Henri Hauser (Ouvriers du temps passé, XVe et XVIe siècles, Paris, 1927). Ces ouvriers formulent une série de revendications concrètes : amélioration de la partie du salaire versée en nourriture « (pain, vin et pitance »), réorganisation des heures de travail et limitation du nombre des apprentis. Cette grève était remarquablement organisée : création d'une « bourse commune », formation de compagnies ouvrières chargées de la chasse aux compagnons non grévistes. Le conflit ne se termina qu'en 1572.
Premières organisations
Dès le xvie siècle, les compagnons ne trouvent plus de protection dans le cadre de la corporation. D'une part, le système corporatif est loin de concerner l'ensemble du travail industriel ; bien des professions, bien des localités lui échappent. D'autre part et surtout, la corporation se transforme. Son évolution est sensible en Angleterre comme en France. Désormais la maîtrise est une caste fermée. Les obligations faites au compagnon pour devenir maître sont alors tellement onéreuses qu'on est compagnon à vie et qu'en fait les maîtres se recrutent dans un cercle familial de plus en plus étroit. On est maître de père en fils ou de beau-père à gendre.
Dès lors les compagnons cherchent à s'associer en dehors de leurs employeurs. D'où le surgissement ou la renaissance d'associations plus strictement ouvrières et d'une très grande diversité. En Angleterre se constituent des clubs de compagnons (comme la « chapelle » des ouvriers imprimeurs de Londres créée dès le xviie s.) et des « sociétés amicales » (sociétés de secours mutuel). Au siècle suivant, des clubs locaux se réunissent dans des tavernes. Ils sont essentiellement formés par l'aristocratie des ouvriers qualifiés non touchés encore par la révolution industrielle : typographes, tonneliers, ébénistes, ouvriers des chantiers de construction navale, papetiers, etc.
En France, ce rôle est avant tout joué par les confréries et les compagnonnages. Au départ, les confréries, dont les origines sont très anciennes, étaient de nature religieuse et, d'ailleurs, il y avait d'autres confréries que les confréries professionnelles. En tout cas, elles groupaient maîtres et compagnons. Mais au xvie siècle, avec l'évolution de la corporation, des scissions se produisent et on voit apparaître des confréries de maîtres et des confréries de compagnons. Ces dernières organisent fréquemment la solidarité. Elles font figure de sociétés de secours mutuel et peuvent parfois prendre l'initiative des grèves. C'est pour cette raison qu'elles se heurtent aux autorités. Toutefois, elles perdent progressivement de leur efficacité et leur activité est très réduite à la veille de la Révolution. Par contre, les compagnons, dont les origines se perdent dans la nuit des temps, jouent un rôle beaucoup plus caractéristique. Il est possible qu'ils soient nés au Moyen Âge à l'occasion de ces rassemblements ouvriers qui se formaient sur les chantiers des cathédrales. Nous savons, par exemple, que les ouvriers qui taillèrent dans le grès rose la cathédrale de Strasbourg avaient constitué des sociétés secrètes. En tout cas, en même temps que la corporation devient une caste de plus en plus fermée, les compagnonnages se transforment en organisations de solidarité et de lutte. Non seulement ils contribuent, par le tour de France – qui permettait aux compagnons de s'initier aux techniques de plusieurs maîtres – et par la publication d'ouvrages spécialisés à la formation professionnelle de leurs membres, mais on les trouve à l'origine de nombreuses grèves au xviie et au xviiie siècle. Sans doute sont-ils divisés en rites divers et souvent opposés. Mais il n'en reste pas moins que le compagnonnage a marqué d'une empreinte profonde le mouvement ouvrier français, tout particulièrement certaines branches professionnelles comme le bâtiment. Si on étudie le vocabulaire encore en usage parmi les travailleurs du bâtiment au début du xxe siècle, les survivances sont fréquentes : comme au temps du compagnonnage, le patron on est qualifié de « singe », l'atelier de « boîte », le groupe d'ouvriers de « coterie » et les non-affiliés de « renards », etc.
À coup sûr, avant la révolution industrielle on est en présence de groupes de travailleurs très hétérogènes : le compagnon qui conserve encore l'espoir de devenir maître, le compagnon qui se sait condamné à ne plus être qu'un compagnon dépendant, le petit artisan travaillant en chambre (le « chambrelan »), l'ouvrier agricole – domestique, valet ou errant –, le mineur paysan, le tisserand campagnard, petit propriétaire terrien mais subordonné au marchand-fabricant qui lui fournit la matière première (et, quelquefois le métier) et lui achète à prix de façon le produit terminé, les ouvriers des premières manufactures soumis à des règlements stricts, etc. Cette diversité, liée aux structures de l'activité industrielle de ce temps, fait obstacle à tout mouvement d'ensemble. Il n'y a aucun programme dans les luttes menées alors par les travailleurs, qui sont souvent opposés les uns aux autres. Et cependant il y a dans ce passé un héritage qui est une des données du mouvement ouvrier lui-même. Le poids de l'histoire demeure considérable. Les séquelles de jadis subsistent longtemps. Le mouvement ouvrier français en apporte de nombreuses preuves dans la première moitié du xixe siècle. Après la Révolution et l'Empire, on assiste à un réveil certain de l'activité « compagnonnale », voire à des tentatives de réformes visant à l'adapter à des exigences nouvelles. En 1832, à Paris, des compagnons sont sur les barricades du cloître Saint-Merri. En 1845, ils dirigent la grève des ouvriers charpentiers parisiens et organisent encore, le 10 mars 1848, une grande manifestation dans la capitale. Malgré tout, le compagnonnage est dépassé comme forme d'organisation ouvrière. Il ne joue qu'un rôle très effacé dans les secteurs les plus récents, les plus dynamiques de la production industrielle. Ce n'est pas seulement le chemin de fer qui tue le tour de France, mais la transformation de l'apprentissage.
Le luddisme
Si le mouvement ouvrier ne commence vraiment qu'avec la révolution industrielle, il hérite incontestablement d'organisations et de formes de lutte antérieures.
Même si, dans les luttes ouvrières les plus contemporaines, il peut arriver qu'il y ait des destructions de machines et de matériel, on peut considérer qu'il s'agit d'un type de défense qui appartient au passé. Le luddisme est d'un autre temps, d'un temps où les ouvriers ne voient pas au-delà de la machine. « Il faut du temps et de l'expérience avant que les ouvriers, ayant appris à distinguer entre la machine et son emploi capitaliste, dirigent leurs attaques non contre la matériel de production mais contre son mode social d'exploitation » (Karl Marx, Le Capital, liv. I, t. II). À la différence des outils utilisés dans les métiers traditionnels (artisanat), la machine est trop coûteuse pour qu'un seul homme puisse en être l'acquéreur et le propriétaire. Elle ne se meut que servie par un nombre croissant d'ouvriers. Son emploi se généralisant, la machine provoque la ruine des artisans et le chômage des ouvriers. D'où la haine des machines dont la destruction est une des premières formes de la lutte ouvrière. Le luddisme doit son nom à un mythique Ned Ludd, parfois appelé, dans la tradition de Robin des Bois, « le roi Ludd de la forêt de Sherwood ». Opérant dans le Leicestershire à la tête de plusieurs bandes, il aurait en 1779 brisé des machines à fabriquer des bas. Ce mouvement entraîne à la fois des artisans menacés de disparition et des ouvriers que la machine risque de jeter hors de la production. Sauf aux États-Unis où la main-d'œuvre est rare, les briseurs de machines surgissent dans toute l'Europe occidentale. Il y a une nouvelle flambée dans les premières années du xixe siècle. En Angleterre, le mouvement semble assez bien organisé. En tout cas, seuls sont détruits les métiers à tisser appartenant aux employeurs qui ont réduit les gages de leurs ouvriers. En France, le mouvement est nettement provoqué par la crainte du chômage ; il éclate quand apparaissent de nouvelles machines dans la cordonnerie, l'industrie textile, la chapellerie et l'imprimerie. Il y a deux grandes vagues de luddisme : de 1817 à 1821 et de 1830 à 1833.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Jean BRUHAT : maître assistant à la faculté des lettres et sciences humaines de Paris
- Bernard PUDAL : professeur émérite de science politique
Classification
Médias
Autres références
-
ABSTENTIONNISME
- Écrit par Daniel GAXIE
- 6 314 mots
- 3 médias
L'affaiblissement desmouvements ouvrier et catholique a joué un rôle important dans la progression de l'abstention des milieux populaires. Du fait de la désindustrialisation, des délocalisations, du chômage, du démantèlement des communautés ouvrières et de l'effondrement du communisme, les multiples... -
ADLER MAX (1873-1937)
- Écrit par Raoul VANEIGEM
- 648 mots
Longtemps occulté par la prépondérance de l'idéologie bolchevique, le rôle de Max Adler, l'un des principaux représentants de l'austro-marxisme, s'éclaire d'une importance accrue à mesure qu'on redécouvre les tendances anti-autoritaires apparues dans l'évolution de la doctrine marxiste....
-
AFL-CIO (American Federation of Labor-Congress of Industrial Organizations)
- Écrit par Claude JULIEN et Marie-France TOINET
- 6 914 mots
- 2 médias
...ancienne. Avant même la Déclaration d'indépendance (1776), les artisans se regroupent en sociétés d'entraide pour parer à la maladie ou au décès des adhérents. Très rapidement, à la fin du xviiie siècle, des organisations de défense se constituent, par métier (charpentiers, imprimeurs ou cordonniers) dans les... -
AMIENS CHARTE D' (1906)
- Écrit par Paul CLAUDEL
- 865 mots
Motion votée au IXe congrès confédéral de la C.G.T., tenu du 8 au 16 octobre 1906, la Charte d'Amiens est considérée comme le texte fondamental du syndicalisme révolutionnaire.
La C.G.T. avait été créée au congrès de Limoges en 1895 par la Fédération des Bourses du travail...
- Afficher les 88 références
Voir aussi
- INTERNATIONALE PREMIÈRE (1864-1876)
- RÉVOLUTIONS DE 1848
- SOCIALISME UTOPIQUE
- TRADE UNIONS
- OUVRIÈRE CLASSE
- COMPAGNONNAGE
- MAÎTRISE
- LUDDISME
- INTERNATIONALE DEUXIÈME (1889-1914)
- BRISEURS DE MACHINES
- TRAVAILLEURS ÉTRANGERS
- RÉPRESSION
- LUTTE DE CLASSES
- HISTOIRE SOCIALE
- IMMIGRATION
- CES (Confédération européenne des syndicats)