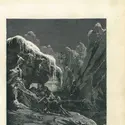MOUVEMENT
Article modifié le
Newton ou comment fonder une dynamique compatible avec la cinématique
Pour nécessaire qu'elle ait été historiquement, l'introduction de la cinématique n'est qu'une étape dans le développement de la conception moderne du mouvement. Une fois la « nature du mouvement » établie, restait à expliquer les phénomènes correspondants à partir de leurs causes ; autrement dit, restait à édifier une dynamique sur les ruines de celle de l'École. À vrai dire, ce n'était pas là la seule possibilité qui s'offrait à la science occidentale ; celle-ci s'est trouvée, après Galilée, à la croisée des chemins et la voie empruntée par Newton, qui consiste précisément à identifier les forces comme les causes des changements de mouvement, n'était pas la seule possible : on sait que Descartes s'était, quant à lui, proposé d'éliminer le concept de force de sa physique. Ironie de l'histoire : la solution qui s'est révélée être la « bonne », celle qui s'est imposée de façon contraignante, n'est pas la plus « relativiste ». Comme on va le voir, la théorie de Newton marque une forme de recul par rapport au principe, pourtant fondateur, de relativité (alors que Descartes, dans Le Monde, s'est efforcé de conduire ce principe à ses conséquences ultimes). En cela, la théorie de Newton est éminemment problématique – ce qui n'ôte rien à son intérêt épistémologique, bien au contraire.
Le rôle de l'espace absolu chez Newton
Toute l'œuvre de Newton peut se définir comme l'effort d'un homme pour établir une différentiation dynamique entre l'état de repos et les mouvements (de translation uniforme) auxquels il est équivalent en vertu du principe de relativité. Tentative très peu galiléenne, que Newton avait ses raisons (métaphysiques essentiellement) d'entreprendre. De là la fameuse distinction entre mouvements vrais et mouvements apparents, que le développement ultérieur de la physique a rendu caduque, mais sans laquelle rien de la dynamique de Newton ne peut se comprendre – puisque aussi bien c'est sur elle qu'est fondée l'introduction des forces : « Quant aux termes de temps, d'espace, de lieu et de mouvement, ils sont connus de tout le monde ; mais il faut remarquer que, pour n'avoir considéré ces quantités que par leurs relations à des choses sensibles, on est tombé dans plusieurs erreurs. Pour les éviter, il faut distinguer le temps, l'espace, le lieu et le mouvement en absolus et relatifs, vrais et apparents, mathématiques et vulgaires. Le mouvement absolu est la translation des corps d'un lieu absolu dans un autre lieu absolu. Le mouvement relatif est la translation des corps d'un lieu relatif en un autre lieu relatif. Les causes par lesquelles on peut distinguer le mouvement vrai du mouvement relatif sont les forces imprimées dans les corps pour leur donner le mouvement » (Principia).
Et Newton d'ajouter, cette fois-ci en parfaite conformité avec la théorie de Galilée (et plus spécifiquement avec l'idée qu'il existe des mouvements « sans cause ») : « Le mouvement vrai d'un corps ne peut être produit ni changé que par les forces imprimées à ce corps même, au lieu que son mouvement relatif peut être produit et changé sans qu'il éprouve l'action d'aucune force. » Ce qui fait dire à H. Weyl (dans Philosophy of Mathematics and Natural Science, 1949) que Newton n'a en définitive qu'à moitié rempli son programme (isoler les caractéristiques du repos vrai) ; en effet, s'il a réussi à établir ce qui, du point de vue dynamique, distingue les mouvements de translation uniforme des autres, en revanche, il n'est pas arrivé (et pour cause, serions-nous tentés de dire aujourd'hui) à mettre en évidence ce qui, parmi ces mouvements uniformes, singularise le repos absolu. De là vient que, dans la formulation de sa première loi, mouvement uniforme et repos figurent côte à côte, comme s'il s'agissait de deux choses différentes : « Tout corps persévère dans l'état de repos ou (souligné par nous) de mouvement uniforme... » À cette première loi vient s'ajouter, de façon toute naturelle, une deuxième loi (qui, dans l'enseignement français porte, à tort, le nom de « principe fondamental de la dynamique », abrégé en P.F.D.) : « Les changements qui arrivent dans le mouvement sont proportionnels à la force motrice et se font dans la ligne droite dans laquelle cette force a été imprimée » (la force motrice ayant elle-même été définie ailleurs comme le produit de la force imprimée par le temps que dure cette « impression »).
Il est intéressant de noter que cet énoncé des lois du mouvement est immédiatement suivi par un corollaire (Corollaire no 1) qui porte sur la composition des mouvements provoqués par deux forces agissant simultanément sur un même corps. Si l'on se rappelle que, chez Galilée, c'est précisément la définition cinématique des mouvements qui permet de penser leur composition, on perçoit bien quel est le sens de l'entreprise de Newton : superposer à la description cinématique de Galilée une description dynamique qui lui soit compatible ; autrement dit, annuler le décalage entre les deux descriptions du mouvement. L'entreprise est hérissée de difficultés et le résultat auquel aboutit Newton n'est pas de part en part satisfaisant, en dépit de l'incontestable puissance opératoire de sa dynamique.
Matière et mouvement : inertie et quantité de mouvement
Si l'entreprise est difficile, c'est bien parce que, pour intellectuellement contraignant et satisfaisant qu'il soit, le principe cinématique de relativité est éminemment difficile à traduire en termes de causes. Comment penser correctement, en effet, ces mouvements pour lesquels nulle force n'est requise : les mouvements de translation uniforme, que l'on désigne encore du nom de « mouvements inertiels » ?
L'adjectif « inertiel » est (on l'aura compris à travers ce qui a été dit de la nouvelle conception inaugurée par Galilée) à entendre au double sens qu'a le mot inertie dans la langue commune : résistance au mouvement, d'une part, et effet par lequel un mouvement se poursuit « tout seul », d'autre part. L'introduction de l'inertie dans la description du mouvement (inertie que Newton appelle aussi vis insita, c'est-à-dire force qui réside dans la matière) procède du souci d'attribuer une cause, l'inertie justement, aux mouvements de translation uniforme lorsqu'ils sont rapportés à l'espace absolu : les forces inertielles (par exemple, les forces centrifuges que met en évidence l'expérience du seau en rotation, expérience dite « du seau de Newton ») sont ce par quoi se manifeste l'emprise de l'espace absolu sur la matière dont sont constituées les choses qui s'y trouvent placées.
Cette conception de l'inertie revient à affirmer :
– que l'espace a une structure non seulement géométrique (structure définie par sa métrique), mais également physique ;
– que la « cause ultime » du mouvement (celle qui subsiste en l'absence de force « imprimée ») est la matière elle-même. C'est là que se marque tout particulièrement le génie de Newton ; car raisonner ainsi c'est introduire dans la physique une idée radicalement nouvelle (et fort peu intuitive) de la connexion entre matière et mouvement. En ce sens, Newton achève l'œuvre de démolition de la physique aristotélicienne entreprise par Galilée. L'exposé des Principia ne laisse subsister aucune ambiguïté sur l'importance de cette découverte, dans la mesure où c'est en tête de ses définitions préalables que Newton place celle de la masse :
« Définition I : La quantité de matière se mesure par la densité et le volume pris ensemble. » Que cette définition soit circulaire ne fait guère de doute (on l'a assez reproché à son auteur) ; il n'en reste pas moins que Newton est, selon l'expression d'Einstein, l'« inventeur du concept de masse ».
L'importance de ce concept dans le développement de la mécanique est bien connue. Ce qui nous intéresse ici, c'est que le concept de masse autorise une quantification du mouvement. En effet, cette première définition est suivie d'une seconde :
« Définition II : La quantité de mouvement est le produit de la masse par la vitesse. » En définissant ainsi la quantité de mouvement, Newton comble le fossé ouvert par l'introduction de la cinématique ; désormais, il devient possible d'associer à une grandeur cinématique (la vitesse) une grandeur dynamique (la quantité de mouvement) ; on pourrait presque dire que Newton procède ici à une « dynamification » de la vitesse. Cette opération est évidemment cohérente avec l'introduction de la notion de force : en effet, une fois définie la quantification du mouvement, la quantification de son changement (induit par une force imprimée, aux termes de la seconde loi) va de soi : le changement de la quantité de mouvement est proportionnel à la force motrice – soit, en termes mathématiques (et avec des notations évidentes) :

Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Françoise BALIBAR : physicienne, professeur à l'université de Paris-VII
Classification
Autres références
-
MOUVEMENT, notion de
- Écrit par Jean-Marc LÉVY-LEBLOND
- 905 mots
Le mouvement est aujourd'hui le plus souvent pensé par les physiciens comme le déplacement spatial d'un objet au cours d'une séquence temporelle. Il apparaît donc comme une notion dérivée de deux autres plus fondamentales, celles d'espace et de temps. Il faut pourtant remarquer que la ...
-
ABŪ L-HUDHAYL AL-‘ALLĀF (752-842)
- Écrit par Roger ARNALDEZ
- 792 mots
Premier grand penseur de la théologie mu‘tazilite, disciple indirect de Wāṣil b. ‘Atā', Abū l-Hudhayl al-‘Allāf est né à Baṣra et mort à Sāmarā. S'étant initié à la philosophie, il s'oppose vivement aux « physiciens » matérialistes, la dahriyya, qui...
-
ACTION & RÉACTION, physique
- Écrit par Jean-Marc LÉVY-LEBLOND
- 1 499 mots
...Lagrange (1736-1813) montrera que la mécanique de Newton peut se déduire d'un « principe variationnel ». L'idée en est la suivante : on considère pour un mobile toutes les trajectoires concevables entre deux points ; à chacune d'elles, on associe une certaine grandeur, calculée (par... -
ÂGE DE LA TERRE
- Écrit par Pascal RICHET
- 5 145 mots
- 5 médias
...devait alors admettre une absence de temps auparavant, ce qui était absurde puisque la notion d’« auparavant » présupposait l’existence du temps. De même, un mouvement ne pouvait pas se produire spontanément : soit il existait de toute éternité, soit il résultait de l’action d’un autre mouvement qui... -
ANTIQUITÉ - Naissance de la philosophie
- Écrit par Pierre AUBENQUE
- 11 140 mots
- 8 médias
...Dès l'Antiquité, on a pris l'habitude de faire donner la réplique à Parménide par un philosophe non moins exemplaire, Héraclite (env. 540-460). À la contestation parménidienne de la réalité ontologique du mouvement, on oppose volontiers la théorie héraclitéenne de la mobilité universelle, qui... - Afficher les 57 références
Voir aussi
- MÉCANIQUE HISTOIRE DE LA
- INERTIE
- ORDRE DU MONDE
- FORCE, physique
- TEMPS, physique
- VITESSE
- TRANSLATION
- RELATIVITÉ PRINCIPE DE
- PREMIER MOTEUR
- RELATIVITÉ GÉNÉRALE
- ACTE & PUISSANCE, philosophie
- NEWTON LOIS DE, mécanique
- MOUVEMENT UNIFORME
- QUANTITÉ DE MOUVEMENT
- PHYSIQUE HISTOIRE DE LA
- SCIENCES HISTOIRE DES