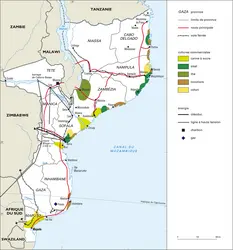MOZAMBIQUE
| Nom officiel | République du Mozambique |
| Chef de l'État et du gouvernement | Daniel Chapo - depuis le 15 janvier 2025 |
| Capitale | Maputo |
| Langue officielle | Portugais |
| Population |
33 635 160 habitants
(2023) |
| Superficie |
799 380 km²
|
Article modifié le
Histoire
L'histoire précoloniale
Si Vasco de Gama découvre la côte du Mozambique en 1498, l'histoire du territoire commence bien avant. Les fouilles archéologiques sont modestes et nos connaissances limitées. Mais on s'accorde généralement sur le fait que les premiers habitants connus dans cette région sont des chasseurs-cueilleurs, parents des Khoisan, qui auraient été déplacés au sud et à l'ouest du Mozambique, entre le ier et le ive siècle après J.-C., par des migrations bantoues. Ces nouvelles populations développent une organisation sociale et politique plus complexe, généralement autour de royautés. À la fin du Ier millénaire, les Karanga envahissent la région par le nord. Plus avancés technologiquement, ils dominent les peuples locaux et développent une civilisation sophistiquée (l'empire du Monomotapa) qui entretient des relations avec la péninsule Arabique, l'Asie et la Chine. Ils construisent des maisons, des forts et une majestueuse capitale de pierre, le Grand Zimbabwe (dans le sud de l'actuel Zimbabwe). Moins impressionnants mais non moins puissants, trois empires appelés Maraves émergent dans le centre de l'actuel Mozambique à partir du xve siècle. Les Portugais, eux, installent des comptoirs sur la côte mozambicaine dès la fin du xve siècle. Fantasmant sur les richesses du Zimbabwe, ils essaient de conquérir l'empire Karanga, mais en vain. Ils resteront, néanmoins, présents dans la vallée du Zambèze. Ailleurs, ils se heurtent, commercialement et militairement, aux Indiens, aux Arabes et aux sultanats swahilis.
Au xixe siècle, l'équilibre de la région est rompu. Le premier facteur de cette rupture est la nouvelle expansion du commerce international de l'esclavage, suscité par la révolution industrielle en Europe. Au total, près d'un million de personnes seront « exportées » du Mozambique. Le deuxième facteur est une série de sécheresses, entre 1794 et 1836, qui détruit la base économique de la région et provoque la crise de l'empire Karanga, des États Maraves et de la présence portugaise le long du Zambèze. Ces sécheresses engendrent une longue période de désintégration sociale, de guerres et d'expansion de l'offre d'esclaves. Enfin, le troisième facteur est lié aux migrations Nguni qui sont, elles aussi, une conséquence de la sécheresse. Originellement fermiers dans la région du Natal (dans l'actuelle Afrique du Sud), les Nguni se réorganisent socialement et politiquement en centralisant leurs institutions et en accroissant fortement leurs armées. Ils développent ainsi des États militaires qui vont se déplacer et ravager une aire allant de l'Afrique du Sud à la Tanzanie actuelle. Leur déplacement bouleverse profondément les équilibres sociopolitiques de la région.
C'est vers 1860 que les Portugais commencent à se préoccuper de la colonisation effective du Mozambique. À cette époque, les nouveaux États-nations européens s'engagent dans la conquête du continent. Les Portugais choisissent de se lancer dans la création d'un nouvel empire centré sur l'Afrique (le « troisième empire », faisant suite au premier empire développé en direction de l'Asie et au deuxième centré sur le Brésil). À partir de 1875, des campagnes de conquête et d'occupation du territoire sont lancées, campagnes qui dureront jusqu'à la fin de la Grande Guerre. L'ambition initiale et maximale des Portugais était de former une grande colonie traversant le continent d'est en ouest, du Mozambique à l'Angola (projet dit de la « carte rose », du nom d'un document officiel illustrant les prétentions du Portugal). Mais de telles visées entrent en conflit avec les ambitions des Britanniques qui cherchent, eux, à s'établir du Cap au Caire. Plus faible que ces derniers, le Portugal va devoir non seulement renoncer à ses ambitions, mais aussi accélérer sa colonisation afin de sécuriser les territoires conquis. C'est à cette fin que Lisbonne décide, en 1898, de déplacer la capitale du Mozambique du nord du pays à Lourenço Marques (actuel Maputo), dans l'extrême sud, où se développe un grand port au service des mines de l'Afrique du Sud voisine.
Le colonialisme portugais
Après avoir conquis des territoires en Afrique, le Portugal doit faire face au problème de l'administration de ses colonies. Le pays étant petit et relativement pauvre, le gouvernement de Lisbonne choisit de louer une partie de son empire à des compagnies à charte. Ces entreprises paient un loyer à l'État et, en échange, gèrent un territoire presque comme un gouvernement. Elles ont le droit, entre autres, de battre monnaie, taxer la population, faire la police, et gérer les domaines de la santé et de l'éducation. Seules les douanes et les relations internationales restent du ressort unique et direct du Portugal. Lisbonne attribue les deux tiers du Mozambique à trois compagnies : la Compagnie du Mozambique, la Compagnie de Zambézie et la Compagnie de Nyassa. Dominées par le capital financier (principalement britannique, français et allemand), ces compagnies vont souvent sous-louer des sections de leurs territoires à d'autres entreprises quand elles ne s'occupent pas uniquement des aspects immédiatement lucratifs (recrutement de travailleurs, impôts, etc.). Comme dans les autres colonies sur le continent, ce système s'avère instable, peu productif et il ne résiste pas, au Portugal, à la montée du nationalisme. À partir de 1926, les compagnies commencent à perdre ou à abdiquer leur pouvoir ; en 1941, la dernière d'entre elles rend ses terres et ses droits au gouvernement de Lisbonne.
À la suite de la reprise du contrôle direct de la colonie, l'État portugais étend sa présence administrative sur tout le territoire et s'engage dans le développement économique du Mozambique. Cela se fait en parallèle avec le développement de l'État Nouveau (Estado Novo) au Portugal, à partir de 1926, le régime autoritaire d'António Salazar. La première étape de cette nouvelle politique coloniale est légale. Le pouvoir édicte de nouvelles lois fondamentales pour le territoire dont l'Acte colonial (1930), la Constitution portugaise (1933) et l'Acte de réforme de l'administration d'outre-mer (1933). Ensemble, ces lois réintègrent la colonie au Portugal, la soumettent au pouvoir direct de Lisbonne et établissent de nouvelles normes de fonctionnement. Au cours de la deuxième étape, Lisbonne crée un État bureaucratique et centralisé. Il nomme un gouverneur général directement subordonné aux ministres en métropole, et il développe une administration puissante. Le développement de cette bureaucratie inclut la délégation de certaines fonctions à l'Église catholique. À la suite de la signature entre le Vatican et le Portugal d'un concordat et d'un accord missionnaire (1940), l'institution religieuse reçoit des subsides afin de s'occuper de l'éducation et de la santé des populations africaines. Enfin, lors de la dernière étape, Lisbonne élabore une politique qui intègre la colonie à l'espace économique de la métropole, afin de consolider le développement de cette dernière.
L'objectif est, d'une part, de renforcer toutes les activités générant des devises (ports et chemins de fer en particulier) et, d'autre part, de donner une impulsion forte à la production de matières premières nécessaires aux industries métropolitaines naissantes. En 1932, des prix fixes sont établis pour le coton et le riz et, en 1940, ces cultures sont rendues obligatoires dans plusieurs régions – en 1944, la culture forcée du coton touchait 791 000 personnes. Reflétant ces choix stratégiques, un premier plan de développement du Mozambique recommande, en 1937, la construction de nouveaux chemins de fer, de systèmes d'irrigation, de barrages et d'un aéroport. Selon ce plan, les entreprises nationales doivent être privilégiées, mais cela n'empêchera pas le développement de grandes entreprises étrangères dans le sucre, le thé et le coprah en particulier. Après la Seconde Guerre mondiale, la politique économique de l'État portugais change. Face aux premières décolonisations en Afrique francophone et anglophone, Lisbonne élabore un deuxième plan de développement (1959-1964), plus politique et moins centré sur le développement d'infrastructures de services. Il soutient la recherche scientifique sur des thèmes tels que la nutrition, l'éducation ou la productivité, il investit dans l'éducation et il projette la migration de Portugais et le développement du colonat. La migration de la population de la métropole, jusqu'alors contrôlée, explose : en 1973, elle atteindra 225 000 personnes pour une population non blanche de 9,3 millions d'habitants.
La réintégration du Mozambique au Portugal durant la première moitié du xxe siècle impliquait théoriquement l'application de la loi portugaise sur tout le territoire colonial et la restauration de la citoyenneté pour tous les habitants. Mais, dans les faits, cela ne concerne que les Européens et les « assimilés », car les indigènes étaient et devaient rester soumis à des lois différentes. Le principe était raciste : la « race » blanche était perçue comme supérieure et seules les personnes pouvant prouver leur « assimilation » à cette race (par le biais d'un examen) pouvaient prétendre à des droits équivalents à ceux des Blancs portugais – en 1950, il n'y avait que cinq mille « assimilés » au Mozambique. Maintenus sous un régime légal différent, les Africains avaient peu de droits et beaucoup de devoirs – cultures forcées, travaux forcés, etc. De plus, le système scolaire qui leur était destiné, géré par l'Église catholique, limitait sérieusement leur mobilité sociale. Face à l'oppression coloniale, certaines populations s'enfuirent dans des régions inaccessibles ou dans les colonies voisines. Les élites africaines et métisses tentèrent, elles, de s'adapter au nouveau système. Mais si certains s'assurèrent des petits postes dans l'administration, les hôpitaux ou l'éducation coloniale, la majorité se retrouva marginalisée. Ainsi, si le premier universitaire africain Kamba Simango obtint sa licence aux États-Unis au début du xxe siècle, il faudra attendre cinquante ans pour qu'un Mozambicain africain obtienne un doctorat. Il s'agit d'Eduardo Mondlane, le futur président du mouvement nationaliste Frelimo et, après son assassinat en 1968, le principal héros national.
La lutte anticoloniale
La guerre de libération du Mozambique commence en 1964, peu après la formation du Frelimo. La littérature affirme généralement que celui-ci est né de la fusion de trois partis ethno-régionalistes, en 1962, et qu'il est à l'origine de la guerre de libération. Mais la réalité est plus compliquée. Des partis anticoloniaux se créent dès 1957 en Tanzanie, en Rhodésie du Sud et au Nyassaland (actuel Malawi), avec le soutien du Ghana et de la Tanzanie en particulier. Après diverses évolutions (création, fusion, disparition), seuls quatre partis continuent d'exister en 1961. À la suite de l'indépendance de la Tanzanie en 1960, trois d'entre eux ouvrent des bureaux dans ce pays et, sous la pression du gouvernement tanzanien, tentent de fusionner en 1962. Si le Frelimo est créé ainsi, les anciens partis ne s'éteignent pas pour autant. Bien que la Tanzanie se saisisse de leurs biens et ferme leurs bureaux, plusieurs dirigeants nationalistes refusent de rejoindre le Frelimo ou le quittent rapidement pour reprendre leur formation politique initiale. Sans bases arrière, ces éléments et ces organisations vont être rapidement marginalisés (même s'ils ont lancé les toutes premières opérations militaires de la guerre de libération) et le Frelimo, avec à sa tête Mondlane, va s'imposer tant sur la scène militaire que sur la scène politique internationale. En 1967, tous les partis anticolonialistes mozambicains tentent de s'unir à nouveau, mais le Frelimo se retire au dernier moment. Les partis restants fusionnent et créent le Comité Revolucionário de Moçambique (Coremo). Ce dernier mènera quelques opérations militaires dans la province de Tete, mais, sans soutien significatif, il périclitera à la fin de la décennie. Ainsi, malgré ses divisions et des luttes internes, le Frelimo passera de parti dominant à parti hégémonique, à tel point que, en 1974, il apparaîtra pour beaucoup comme le seul parti indépendantiste légitime.
Les combats contre les Portugais restent longtemps limités aux provinces du nord de Cabo Delgado et de Niassa. Malgré diverses tentatives, ce n'est qu'après quatre ans de guerre, en 1968, que l'armée du Frelimo s'implante dans la province de Tete, au nord-est du pays. Cette avancée est importante dans la mesure où le Frelimo met en danger le plus grand projet de développement de la région à l'époque (le barrage de Cabora Bassa) et qu'il provoque la dispersion des troupes portugaises. Mais la présence du Frelimo ne progressera guère par la suite : à la fin du conflit, le mouvement de libération n'a une présence notable que dans les trois provinces du nord et un début d'action dans les provinces de Manica et de Sofala. Stratégiquement, le Frelimo mène une guerre de guérilla – harcèlements, attaques surprises et retrait dans des régions inaccessibles. Côté portugais, la guerre avait été préparée de longue date. L'armée adopte les tactiques et stratégies anti-insurrectionnelles développées par les Français en Algérie et les Américains au Vietnam, notamment en forçant les populations des zones « affectées », ou pouvant l'être, à vivre dans des « villages protégés ». En 1970, le général Arriaga, le nouveau chef des forces armées, décide de lancer une opération de grande envergure dans le nord du pays afin d'en finir avec le Frelimo. Mobilisant à elle seule 35 000 soldats et cent hélicoptères et avions, l'opération coûte cher et oblige Lisbonne à l'écourter. Avant de quitter le Mozambique, le général porte la guerre dans deux autres directions, qui vont avoir des conséquences importantes après l'indépendance : il implique les Rhodésiens et les Sud-Africains dans le conflit et il africanise ses troupes, créant même des troupes spéciales à base ethnique.
L 'indépendance du Mozambique n'a pas été proclamée à la suite d'une victoire sur le champ de bataille, mais elle a eu lieu après un coup d'État à Lisbonne, mené par des capitaines portugais qui contestaient les guerres coloniales. Ce coup d'État du 25 avril 1974 met fin au régime de l'État Nouveau, inaugure la « révolution des œillets » et, un an plus tard, permet l'indépendance négociée du Mozambique et des autres colonies portugaises. Selon le Frelimo, dirigé depuis 1970 par Samora Machel, c'est la guerre au Mozambique qui aurait porté un coup fatal au moral et à la motivation des troupes portugaises, favorisant ainsi le coup d'État et donc la décolonisation. Mais, s'il est vrai que le mouvement des forces armées, issu du mouvement des capitaines au Portugal, était décidé à terminer les guerres d'outre-mer, il n'avait pas de plan pour l'avenir des colonies. Alors que certains éléments du nouveau gouvernement sont en faveur d'un retrait unilatéral des colonies, d'autres veulent remplacer l'empire par une communauté fédérale portugaise. Au même moment, différents partis nationalistes africains rentrent au Mozambique, ou s'y créent (Coremo, Grupo Unidade de Mozambique...), et réclament la tenue d'élections. Considérant le Frelimo comme la meilleure option, le gouvernement portugais décide finalement de signer uniquement avec ce parti les accords de Lusaka le 7 septembre 1974. Ces derniers prévoient un cessez-le-feu immédiat, un gouvernement de transition pour neuf mois et le transfert total du pouvoir au Frelimo. Le 24 juin 1975, à minuit, le drapeau portugais est baissé et le nouveau drapeau du Mozambique hissé au stade de Machava, près de Maputo, dans le cadre d'une grande cérémonie officielle dirigée par le Frelimo, symbolisant la cessation définitive du pouvoir portugais au Mozambique.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Bernard CALAS : professeur de géographie à l'université de Bordeaux-III-Michel-de-Montaigne
- Eric MORIER-GENOUD : docteur en sociologie, chargé de cours à l'université de Lausanne, Suisse
- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis
Classification
Médias
Autres références
-
MOZAMBIQUE, chronologie contemporaine
- Écrit par Universalis
-
AFRIQUE (Structure et milieu) - Géologie
- Écrit par Anne FAURE-MURET
- 18 792 mots
- 22 médias
On appelle province mozambiquienne toute la région qui est située le long de la côte est de l'Afrique, à l'est des cratons de Tanzanie et du Zimbabwe. Vers le nord, il est difficile de savoir quels sont ses rapports avec le bouclier arabo-nubien. Madagascar appartient à cette vaste province du fait... -
AFRIQUE AUSTRALE
- Écrit par Jeanne VIVET
- 6 102 mots
- 5 médias
...crise économique, d'une hyperinflation et de graves crises politiques, qui ont engendré une pauvreté de masse. Dans le « deuxième cercle », l'Angola et le Mozambique ont connu une croissance économique spectaculaire dans les années 2000 ; cette croissance de rattrapage post-conflit était également tirée... -
BEIRA
- Écrit par Encyclopædia Universalis
- 310 mots
Ville portuaire située au centre de la côte du Mozambique, Beira est construite sur le canal de Mozambique (océan Indien) à l'embouchure des rivières Púngoè et Búzi. Sa fondation remonte à 1891, date à laquelle les Portugais établirent le siège de la Companhia de Moçambique (« compagnie du Mozambique...
-
CABORA BASSA BARRAGE DE
- Écrit par Pierre VENNETIER
- 191 mots
Construit entre 1967 et 1974 au Mozambique, le barrage de Cabora Bassa (ou Cahora Bassa) fait partie de l'aménagement général de la vallée du Zambèze dont une autre pièce maîtresse est le barrage de Kariba, au Zimbabwe, sur la frontière entre cet État et la Zambie. Cabora Bassa, construit...
- Afficher les 18 références
Voir aussi
- PORTUGAIS EMPIRE COLONIAL
- DENSITÉ DE POPULATION
- HYDROÉLECTRICITÉ
- SÉCHERESSE
- NGUNI ou NGONI
- CHISSANO JOACHIM ALBERTO (1939- )
- RENAMO (Résistance nationale du Mozambique)
- PAUVRETÉ
- GUERRES D'INDÉPENDANCE & INSURRECTIONS PATRIOTIQUES
- GUERRE CIVILE
- COMPTOIRS
- GUEBUZA ARMANDO (1943- )
- SOCIALISME AFRICAIN
- AFRIQUE, économie
- NACALA
- AIDE ÉCONOMIQUE
- AFRIQUE, géographie
- AFRIQUE NOIRE, histoire, période coloniale
- AFRIQUE NOIRE, histoire, des indépendances à nos jours
- AFRIQUE NOIRE ÉTATS D'
- AFRIQUE NOIRE, histoire précoloniale
- FRELIMO (Frente de Libertação de Moçambique)
- MAIN-D'ŒUVRE
- AFRIQUE NOIRE RELIGIONS DE L'
- PERSONNES DÉPLACÉES