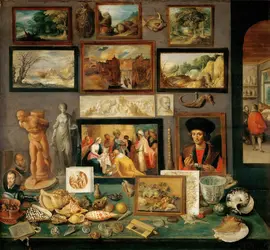- 1. Trésors religieux et collections princières
- 2. La vénération de l’Antique et l’émergence d’une approche scientifique
- 3. L’ouverture des collections et la question du bâtiment (xvie-xviiie siècles)
- 4. En France, l’œuvre de la Révolution
- 5. Spolier et protéger
- 6. Consacrer les artistes (xixe siècle)
- 7. Vers l’universalité
- 8. Un développement mondial (xixe et xxe siècles)
- 9. Vers une mission d’éducation
- 10. La passion de l’histoire et du patrimoine
- 11. Remise en cause et renouveau
- 12. Avancées muséographiques
- 13. Enrichir les collections
- 14. Une politique d’accueil et d’information
- 15. Mondialisation et après ?
- 16. Bibliographie
MUSÉE
Article modifié le
Une politique d’accueil et d’information
C'est par une politique d'accueil, d'information et d'animation, et pour une action pédagogique redoublée que les musées s'efforcent depuis une quarantaine d'années de faire oublier l'aspect désuet ou élitaire qu'ils revêtaient fréquemment jusque-là. Les expositions qui trouvent leur origine dans les Salons du xviiie siècle et les grandes manifestations internationales de l'époque suivante connaissent de nos jours une vogue sans précédent. Elles se succèdent à un rythme soutenu dans le calendrier de tous les établissements à caractère culturel permettant, en particulier pour l'histoire de l'art, la publication des résultats de la recherche par le truchement des catalogues, ainsi que de très utiles confrontations porteuses d'autres découvertes, constituant sans doute la forme la plus attrayante sinon la plus efficace de divulgation des connaissances scientifiques. Mais en tant qu'« événements », en satisfaisant par là le besoin inaltérable de nouveauté qui marque notre temps, il n'est pas exclu qu'elles concurrencent les musées eux-mêmes plutôt qu'elles ne suscitent parmi le public le désir de fréquenter ceux-ci assidûment. Les musées pourraient-ils devenir des centres d'étude pour spécialistes et des dépôts d'objets – les espaces réservés aux bureaux, aux ateliers et laboratoires excèdent dans certaines réalisations modernes, tel le musée de Tel-Aviv, ceux qui sont dévolus à la présentation des collections –, des « réservoirs » pour les expositions locales et internationales ? L'idée n'est pas nouvelle et elle ne manque pas de défenseurs. Cependant, la mode des grandes expositions semble avoir abordé depuis quelques années une phase de crise, dont les raisons sont d'ordre financier, culturel et technique : généralement coûteuses (assurances, transports, frais d'impression des catalogues), elles grèvent considérablement le budget des musées au détriment de l'entretien des collections et de la rénovation des salles. Par ailleurs, des protestations se font jour face à une pratique qui a pour effet de déparer les musées de leurs plus belles pièces pendant de longues périodes. Enfin et surtout, les risques de détérioration auxquels sont exposées les œuvres d'art, durant leur convoiement ou du fait des changements de conditions atmosphériques qui en résultent, amènent de plus en plus souvent les conservateurs à en refuser le prêt. Aussi n'est-il pas impossible que le phénomène subisse un certain ralentissement dans les prochaines années, et que les musées trouvent là l'occasion de redéployer leurs activités dans une voie moins spectaculaire et plus essentielle, celle d'un travail d'information et d'éducation fondé sur les collections permanentes et leur mise en valeur véritable. Les questions soulevées notamment par la cancel culture – avec leur incidence, par exemple, sur le titre des œuvres qui montrent des individus de couleur, tel Négresse aux pivoines de Frédéric Bazille, devenu Jeune Femme aux pivoines (musée Fabre, Montpellier) – et par des sujets plus techniques, comme l’écriture inclusive et la renonciation aux chiffres romains sur les cartels et fiches d’œuvres, devraient trouver dans ce secteur matière à réflexion sur la vérité historique.
L'avance prise par les musées américains sur ceux d'Europe quant à l'animation et l'encadrement du public mérite d'être soulignée : grâce à leurs programmes réguliers et très riches de visites-conférences, de lectures, de projections de films documentaires, et à leurs services pédagogiques opérationnels, la plupart d'entre eux parviennent, semble-t-il, à assumer un rôle culturel authentique. L'existence de cafés, de restaurants et de points de vente de livres et de reproductions à l'intérieur des bâtiments en fait des lieux attractifs, en continuité avec la vie quotidienne, et propices aux loisirs. Leur succès est d'ailleurs incontestable : après la Seconde Guerre mondiale, le nombre des entrées des musées a connu aux États-Unis un essor assez spectaculaire (près de 300 millions de visiteurs selon par an America’sMuseums : The Belmont Report, 1968). Ici, comme partout dans le monde, la « crise Covid » a stoppé cette progression, en raison de la fermeture momentanée des établissements puis de la baisse du tourisme, une situation que l’institution n’a pas encore surmontée (voir notamment le rapport de l'UNESCO, Les Musées dans le monde face à la pandémie de Covid-19, 2021).
La France, avec un certain retard, a épousé ce mouvement progressivement depuis les années 1960 dans les musées nationaux, plus volontairement depuis les années 1980 à la faveur du mouvement de rénovation des musées. Dans les 1 200 « musées de France », label créé par la loi du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, établissements nationaux, territoriaux ou associatifs, des services spécialisés proposent en principe au public, scolaire ou adulte, une programmation culturelle en rapport avec les collections. La prise en charge du public est la plupart du temps intégrée dans les projets muséographiques (zones d'accueil, librairies-boutiques, cafétérias, auditoriums...). Des mesures tarifaires modulées sont mises en place (cartes d'adhésion à l'année, journée de gratuité, passes spéciaux pour les jeunes, etc.). Le numérique (sites Internet, bases de données, aides à la visite), promu assez tôt par les associations régionales de conservateurs, est devenu un outil essentiel de la relation au public, aux enseignants et aux chercheurs. En mars 2021, le musée du Louvre, qui accusait dans ce domaine un certain retard par rapport à d’autres grands musées français (dont Orsay, le musée du quai Branly et le château de Versailles) et étrangers (Rijksmuseum d’Amsterdam, National Gallery, Victoria & Albert Museum et British Museum à Londres, musée du Prado à Madrid, Metropolitan Museum à New York, Ermitage à Saint-Pétersbourg…), a mis en ligne une nouvelle base de données – collections.louvre.fr –, plateforme qui rassemblait à son lancement plus de 480 000 œuvres du musée, avec différents niveaux de consultation et d’accès : recherche simple ou avancée, accès par département, albums thématiques. Le plan interactif permet de préparer ou de prolonger une visite, en explorant le musée salle par salle. Enrichies en permanence par les départements, les notices sont évolutives et visent à refléter les avancées de la recherche. On peut cependant regretter la disparition des anciennes notices détaillées de la base « cartels ». Le Louvre a également produit une nouvelle version de son site Internet – louvre.fr – plus ergonomique, plus visuelle, plus immersive.
Beaucoup plus ambitieuse quant à son dessein est l'évolution qui consiste à arracher le musée à son isolement pour l'intégrer à un complexe culturel – tel le musée Abteiberg à Mönchengladbach (Allemagne), achevé en 1982, qui voisine avec un centre audiovisuel, un conservatoire doté d'une salle de concert, une bibliothèque, un dépôt d'archives, une école, un centre de formation pour adultes, une maison de jeunes et des logements (architectes : Hans Hollein et Thomas van den Valentyn) – voire à une entité nouvelle : l'idée en est lancée dès les années 1950 avec le projet du musée d'Art moderne de Rio (construit par l'architecte brésilien Reidy à partir de 1957 et détruit par un incendie en 1978), auquel devaient être primitivement associés une salle polyvalente pour le théâtre, la danse et le cinéma, ainsi qu'un centre de formation permanente et de recherches artistiques (cinéma, design, arts plastiques). À l'instar du Kulturset de Stockholm, le Centre national Georges-Pompidou (architectes : Piano et Rogers), institution plurale vouée à l'acquisition et à la conservation de collections d'art contemporain (musée), à la recherche et à la formation d'artistes et de spécialistes (Centre de création industrielle et IRCAM), et à l'information du public (bibliothèque en accès libre, expositions, programmes cinématographiques, etc.), constitue l'un des points d'aboutissement de cette politique, bien que le projet initial n’ait pas été entièrement respecté. Les établissements de ce type bénéficient d'ailleurs d'un immense succès en raison de leur ancrage au présent, des moyens technologiques, en eux-mêmes attractifs, dont ils disposent, et de la diversité des centres d'intérêt auxquels ils répondent (3,27 millions de visiteurs au Centre Pompidou en 2019).
Le musée est ici le point de départ, la pierre angulaire d'un ensemble fondé sur une conception unitaire de la culture et le désir d'une interaction ou simplement d'une coexistence harmonieuse entre les disciplines. L'influence de ces réalisations se fait sentir jusque dans les musées tournés vers le passé et de conception plus traditionnelle : le musée du xixe siècle, installé dans les locaux de l'ancienne gare d'Orsay à Paris (architectes R. Bardon, P. Colboc et J.-P. Philippon ; aménagement intérieur initial par G. Aulenti), s'est donné pour mission d'offrir au public un panorama exhaustif de toutes les formes d'expression artistique de cette époque, y compris l'architecture, la littérature et la scénographie, et de rendre compte de leurs interférences multiples à travers des expositions du même type que celles qui sont organisées depuis quelques années par le Centre Beaubourg. La programmation culturelle du musée du Louvre s'inscrit dans le même mouvement. Avec Beaubourg, comme vraisemblablement avec le Louvre et Orsay, le musée, lieu de « mémoire » et de conservation du patrimoine, lieu du « temps long », se doit de fonctionner aujourd’hui, aux yeux d’un public familier des réseaux sociaux et des médias, comme un producteur inlassable d'événements sans lesquels sa légitimité serait probablement remise en cause. Il est clair que les performances en termes d’animation et de développement des ressources propres, attendues des grands établissements nationaux et territoriaux par leurs tutelles, ont favorisé cette évolution.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Robert FOHR : historien de l'art
Classification
Médias
Autres références
-
MUSÉE, NATION, PATRIMOINE 1789-1815 (D. Poulot)
- Écrit par Robert FOHR
- 1 521 mots
Dominique Poulot est l'un des meilleurs spécialistes français de l'histoire des musées, plus spécialement sous la Révolution et au xixe siècle. Parmi les nombreuses études qu'il a consacrées à ce domaine, il faut citer notamment « L'Avenir du passé, les musées en mouvement » (in ...
-
MUSÉES DE FRANCE STATUT DES
- Écrit par Marie CORNU
- 2 654 mots
La loi relative aux musées de France, dite loi musée, adoptée le 4 janvier 2002, vient opportunément encadrer l'activité des institutions en charge de la conservation et de la présentation au public des collections. Jusque-là, une ordonnance provisoire du 13 juillet 1945 fixait très sommairement...
-
MUSÉE ET MÉDIATION NUMÉRIQUE
- Écrit par Geneviève VIDAL
- 3 325 mots
- 1 média
Les médiations numériques muséales, qui relèvent d’innovations techniques, culturelles et sociales en évolution permanente, font l’objet d’une grande variété d’usages, par le biais de dispositifs de communication. Elles soulèvent plusieurs enjeux relatifs aux politiques numériques conduites...
-
AIX-LA-CHAPELLE, histoire de l'art et archéologie
- Écrit par Noureddine MEZOUGHI
- 1 002 mots
- 2 médias
Aix connut son apogée quand Charlemagne s'y installa définitivement, en 794. Il entreprit alors la construction d'un vaste palais sur un plan régulier imité de l'Antiquité romaine. L'ensemble a malheureusement disparu, à l'exception de la célèbre chapelle...
-
ANGIVILLER CHARLES CLAUDE DE LA BILLARDERIE comte d' (1730-1809)
- Écrit par Marie-Geneviève de LA COSTE-MESSELIÈRE
- 607 mots
- 1 média
La faveur de Louis XVI vaut à d'Angiviller de remplacer, en 1774, le marquis de Marigny comme surintendant des bâtiments du roi. Ses idées sont plus personnelles que celles de son prédécesseur, mais il reconnaît la valeur de l'œuvre accomplie par lui grâce aux sages conseils dont il a su s'entourer...
-
ANTHROPOLOGIE DU PATRIMOINE
- Écrit par Cyril ISNART
- 4 703 mots
- 2 médias
...privilégié de l’anthropologie sociale et culturelle, notamment à travers la mise en valeur des productions plastiques des peuples non occidentaux dans les musées d’ethnographie dès le xixe siècle ou l’émergence du folklore comme science des cultures européennes. La littérature consacrée à la transmission... -
ARCHÉOLOGIE (Archéologie et société) - Archéologie et enjeux de société
- Écrit par Jean-Paul DEMOULE
- 4 678 mots
- 2 médias
...du territoire métropolitain ne fit l'objet d'aucune recherche institutionnelle appuyée sur l'Université, et se trouva abandonnée aux notables locaux. Le musée des Antiquités nationales, créé en 1867, ne fut pas en France, comme dans d'autres pays, installé au cœur de la capitale, mais dans sa banlieue,... - Afficher les 160 références
Voir aussi
- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, droit et institutions
- GREC ART
- COLLECTION, art et culture
- TEMPLE
- COLLECTIONNEURS
- SCIENCES HISTOIRE DES, XVIIe et XVIIIe s.
- MÉDIÉVAL ART
- HISTOIRE DE L'ART
- RENAISSANCE ARTS DE LA
- LOUVRE-LENS MUSÉE DU
- MODÈLE, art
- CLASSIQUE ART
- ART DU XXe ET DU XXIe SIÈCLE
- ANONYMAT DANS L'ART
- ÉCOMUSÉE
- LOUVRE MUSÉE DU
- VERSAILLES
- FRANCE, histoire, de 1789 à 1815
- ARCHITECTURE DU XVIIIe SIÈCLE
- TECHNIQUES HISTOIRE DES, XIXe s.
- ANTIQUITÉ, sculpture
- ARCHITECTURE DU XXe ET DU XXIe SIÈCLE
- CATALOGUE, histoire de l'art
- POLITIQUE CULTURELLE
- PILLAGE DES ŒUVRES D'ART
- BARNES FONDATION
- LOUVRE ABU DHABI, musée
- HERMITAGE AMSTERDAM, musée