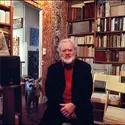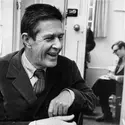MUSIQUE CONTEMPORAINE L'évolution de la musique depuis 1945
Article modifié le
Perception et musiques nouvelles
Il est possible de distinguer deux grandes tendances dans l'évolution de la musique depuis le début du xxe siècle : celle qui accorde la primauté aux relations entre les sons – illustrée, par exemple, par les compositeurs sériels – et celle qui s'attache à l'élaboration du son lui-même, et qui consiste, selon Jean-Claude Risset, à « sculpter le son, agir à la naissance des processus sonores, [...] faire s'interpénétrer un monde synthétique et le monde réel ». Monde synthétique, car cette dernière forme de création musicale est fondée sur la synthèse sonore par ordinateur, afin de produire des sonorités complexes inouïes ; l'évolution du son et les spectres sonores y jouent un rôle fonctionnel, d'où le nom de musique spectrale donnée à cette tendance, qui émerge en France à la fin des années 1970 avec le groupe L'Itinéraire, et plus particulièrement Gérard Grisey et Tristan Murail. Monde réel, car ce processus conduit à s'interroger de nouveau sur la perception auditive, notamment sur les mécanismes de reconnaissance des hauteurs et des timbres. La relation entre la structure d'un son et la perception du message sonore est en effet un phénomène complexe, et une divergence considérable peut naître entre la réalité sonore et la sensation que l'on en a.
Pour analyser la perception globale d'un son, il est nécessaire d'étudier les quatre paramètres liés les uns aux autres qui le composent : hauteur, intensité, durée et timbre.
Avec des sons sinusoïdaux de fréquence fixe, la perception de la hauteur dépend de l'intensité : si l'intensité d'un son aigu ou grave augmente, l'auditeur éprouve la sensation d'une hauteur accrue ou diminuée, respectivement . De plus, un temps minimal est nécessaire pour mémoriser la hauteur d'un son : au-delà de douze notes par seconde, la perception de hauteur devient floue.
Les choses deviennent plus ardues quand il s'agit de sons complexes, c'est-à-dire non sinusoïdaux. Lorsqu'on enregistre sur une bande magnétique un son complexe dont le fondamental est à 100 hertz et que l'on coupe, avec un filtre, ce fondamental ainsi que les harmoniques 2 et 3, l'auditeur continue à entendre un son à 100 hertz ; le timbre est cependant altéré et le son paraît moins riche. On peut d'ailleurs couper tout ce que l'on veut dans le spectre, pourvu qu'on laisse quelques harmoniques perceptibles à l'oreille, voisins du fondamental et équidistants : l'auditeur perçoit toujours un son à 100 hertz. À partir de quelques harmoniques équidistants, le cerveau parvient en fait à reconstituer le fondamental et les harmoniques manquants. Aussi étonnant que cela puisse paraître, la sensation de hauteur n'est donc nullement liée à la fréquence du fondamental : percevoir la hauteur, c'est en fait percevoir le degré d'écartement entre harmoniques voisins.
Pour un son de même hauteur joué ou enregistré avec la même intensité par deux instruments différents, la perception de la hauteur n'est pas identique. Cette disparité apparente de hauteur résulte des caractéristiques différentes des spectres des sons émis par les deux instruments. Lorsque l'on écoute la même note – un la3 à 440 hertz –, émise par une flûte et par un hautbois, l'auditeur perçoit toujours une différence de hauteur : le spectre du hautbois présente en effet des formants – un formant est un harmonique renforcé – autour de 3 000 hertz, fréquence qui correspond à la région de sensibilité maximale de l'oreille, alors que le spectre de la flûte n'en comporte pas dans cette zone.
Pour la grande majorité, percevoir une hauteur exacte est difficile. Mais un musicien qui n'a pas l'oreille absolue – c'est-à-dire ne reconnaît pas une hauteur exacte – peut néanmoins accorder son instrument, même sans diapason. Il reconnaît en fait la forme acoustique du son dans son ensemble, et plus particulièrement celle du timbre, car un même instrument présente des caractéristiques de timbre différentes selon que le son monte ou descend. Insistons sur le fait que l'absence d'oreille absolue ne constitue pas une entrave à l'activité d'interprète ou de compositeur : Igor Stravinski, par exemple, n'avait pas l'oreille absolue, ce qui ne l'a pas empêché d'écrire des œuvres d'une très grande complexité. Ce n'est pas l'oreille absolue qui importe, mais l'oreille relative, c'est-à-dire la capacité de discerner les intervalles. Remarquons par ailleurs que l'oreille absolue est fonction du pays : en France, le la3 est aujourd'hui à 440 hertz, en Allemagne à 445 hertz.
Aussi curieux que cela puisse paraître, on ne peut reconnaître un timbre que par ses transitoires d'attaque et d'extinction, dont les rôles ont été prouvés à l'aide d'expériences menées par des acousticiens comme Émile Leipp, fondateur du Laboratoire d'acoustique musicale de l'université de Paris-VI, ou Michèle Castellengo. Un son musical ne s'établit pas et ne s'éteint pas instantanément : les transitoires sont les phénomènes acoustiques qui apparaissent lors de l'établissement et de l'extinction des sons.
Les transitoires d'attaque et d'extinction sont directement liés aux modes d'excitation de l'instrument . Dans le cas des instruments à cordes, il s'agit du frottement de l'archet sur les cordes.
Si on enregistre une note de flûte d'une durée de 10 millisecondes, que l'on ne garde que le transitoire d'attaque (c'est-à-dire le souffle) et que l'on « colle » celui-ci à une note de violoncelle d'une durée de 60 millisecondes coupée de son propre transitoire d'attaque, l'auditeur subit une chimère acoustique : il ne perçoit qu'un son de flûte !
Le transitoire d'extinction paraît plus important encore que le transitoire d'attaque : si on enregistre un son de piano et que l'on monte le niveau d'enregistrement à mesure qu'il s'éteint afin d'obtenir une intensité constante pendant un certain temps, aucun sujet, même musicien, n'est capable d'identifier le timbre s'il n'entend pas l'extinction du son.
Les transitoires constituent la signature du timbre ; ils représentent la seule possibilité pour l'auditeur de différencier des sons de même hauteur et de même intensité, dont le spectre est identique mais dont les transitoires diffèrent (par exemple une flûte, un violon et un piano).
Berlioz a eu l'intuition de ces phénomènes : dans la Symphonie fantastique, il s'est plu à faire surgir à plusieurs reprises un instrument soliste d'un tutti d'orchestre. N'ayant pas entendu le transitoire d'attaque de l'instrument, l'auditeur éprouve de la difficulté à identifier son timbre.
Les composantes du spectre d'un son jouent aussi un rôle important dans la perception, car la sensibilité de l'oreille varie avec la fréquence : les très basses et les très hautes fréquences sont généralement plus distinctement perçues que les sons intermédiaires. Pour un même niveau physique, des fréquences comprises entre 30 hertz et 12 000 hertz ne sont pas perçues avec la même intensité auditive. La représentation sonagraphique du la3 à 440 hertz montre ainsi onze harmoniques d'égal niveau (représentés par des traits équidistants et de même épaisseur ). En revanche, lorsqu'on choisit un filtre qui privilégie la zone la plus sensible de l'oreille, le spectre du la3 indique un renforcement des harmoniques – un formant – autour de 2 000 hertz. La perception du timbre est donc modifiée lorsque le son est transposé vers l'aigu ou vers le grave, même si les rapports d'intensité entre harmoniques restent semblables : lorsqu'un son a un fondamental et un harmonique 2 faibles, il possède un certain timbre ; si on transpose ce fondamental à la douzième en le multipliant par trois, le fondamental et l'harmonique 2 aboutissent dans la zone sensible de l'oreille et paraissent donc renforcés.
La sensation de timbre varie en fonction du nombre de composantes et de leur situation dans l'aire audible. Pour un son dont le fondamental est intense et qui possède peu d'harmoniques, le timbre est velouté dans les tessitures grave et médium. Transposé dans l'aigu ou le suraigu, le timbre devient difficilement identifiable, le son paraît détimbré. La représentation sonagraphique de ce son montre que ses harmoniques sortent de la zone sensible de l'oreille, devenant donc imperceptibles pour l'auditeur : pour un fondamental de 3 000 hertz, l'harmonique 5 est déjà à 15 000 hertz, donc imperceptible.
Tout instrument possède plusieurs registres de timbres. Lorsqu'un son contient beaucoup d'harmoniques de faible intensité, il est maigre. Lorsque les harmoniques graves deviennent plus intenses, le timbre devient plus lumineux, plus plein. En revanche, lorsqu'il existe des harmoniques intenses dans le grave et dans l'aigu mais pas dans le médium, le timbre est généralement creux. Si les harmoniques intenses sont situées uniquement dans le suraigu, le timbre est criard.
Les tenants de la musique spectrale manifestent un refus des modèles extramusicaux et des procédés mathématiques. La musique tout entière est pour eux contenue dans les sons, elle émane véritablement des propriétés acoustiques du son. S'appuyant sur les travaux d'Émile Leipp, l'École spectrale met à profit les nouvelles technologies, qui permettent les manipulations sonores. L'idée dominante des « spectraux » consiste à créer un nouvel univers en explorant le son de l'intérieur : il ne s'agit plus de l'organiser de l'extérieur par manipulation de notes, mais de se fonder sur son analyse, sur l'empilement de ses harmoniques et sur leur évolution dans le temps. En se situant sur le plan de la perception, elle s'oppose radicalement au système sériel, imposé de manière abstraite.
Le nom de cette école prête cependant à ambiguïté : il peut en effet abuser et laisser penser que le spectre sonore se substitue de manière totalement arbitraire à la série. Or la musique spectrale ne se limite pas à l'étude du spectre et tente de prendre en compte la totalité du phénomène sonore.
Gondwana, pour orchestre, composé en 1980 par Tristan Murail, peut à ce titre être considéré comme l'une des illustrations les plus fascinantes de ce courant musical. Après avoir étudié le spectre d'une cloche, ses fréquences, ses dynamiques, ses résonances, Tristan Murail a distribué les harmoniques aux divers instruments de l'orchestre avant de leur faire subir des métamorphoses dans le temps et dans l'espace. Cette démarche est d'autant plus fondée que le spectre d'une cloche, bien que proche d'un spectre harmonique, demeure inharmonique : il comporte en effet des partiels – c'est-à-dire des éléments qui ne sont pas des multiples entiers du fondamental – et non pas des harmoniques équidistants, ce qui lui confère une hauteur très approximative. De plus, le transitoire d'extinction est très imprécis car la vibration de la cloche s'arrête lentement, aboutissant à l'impression d'un écho. Aucun instrument seul ne pourrait reproduire le son d'une cloche ; seul un orchestre entier peut le faire. On peut évidemment s'interroger sur l'intérêt de reproduire de manière réaliste le son d'une cloche. Mais Gondwana n'est pas une œuvre naturaliste : la référence au son de cloche est parfois évidente, parfois brouillée et lointaine lorsque ce son est intégré dans un tissu orchestral éclatant. Par ses métamorphoses sonores, cette œuvre, porteuse d'une grande poésie, s'impose à l'auditeur sans brutalité car tout y est lié, tissé, enchaîné, d'une grande unité ; elle rappelle parfois certaines œuvres de György Ligeti, comme Atmosphères ou Lontano, même si la technique de composition reste fondamentalement différente. Mais, en distribuant les harmoniques aux divers instruments en présence, les deux compositeurs ont artificiellement reconstitué des spectres sonores.
Il arrive parfois que les compositeurs créent un accord ou une harmonie hybride, par exemple en faisant jouer un accord de septième majeure puis en faisant subir à celui-ci des métamorphoses, par exemple en lui ôtant les harmoniques qui lui donnaient la propriété de septième majeure. Les modèles les plus frappants de cette métamorphose harmonique se trouvent dans Partiels, pour deux groupes instrumentaux de 16 ou de 18 musiciens, de Gérard Grisey (1975).
L'École spectrale ne se limite pas à la France. Elle est illustrée en Allemagne par le groupe Feedback, avec notamment Johannes Fritsch, Mesías Maiguashca, Peter Eötvös, Claude Vivier et Klarenz Barlow. En Roumanie, elle est représentée par Ştefan Niculescu et Cǎlin Ioachimescu. Elle a également influencé Kaija Saariaho, Jonathan Harvey, Magnus Lindberg, Marc-André Dalbavie, Philippe Hurel... L'Italien Giacinto Scelsi (1905-1988) a aussi travaillé sur les transformations sonores dès les années 1950. Sa pièce la plus aboutie est Anahit, pour violon et 18 instruments (1965), dans laquelle il entoure plusieurs notes pivots de sons graves qui génèrent beaucoup d'harmoniques et dont les résonances donnent l'impression d'un puits sonore. Sur une matière en apparence pauvre, le compositeur a livré toute sa richesse d'imagination : il déploie les notes pivots à travers les octaves en exploitant dans leur intégralité le spectre harmonique de chacune d'elles et fait évoluer les autres notes autour d'elles de manière à créer un bouillonnement qui rappelle parfois le son d'un orchestre qui s'accorde. L'écoute de ce déconcertant poème de timbres fait mieux comprendre pourquoi, à l'instar de John Cage, Scelsi refusait le qualificatif de compositeur et préférait celui de « passeur de sons ».
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Michel CHION : écrivain, compositeur, réalisateur, maître de conférences émérite à l'université Paris-III
- Juliette GARRIGUES : musicologue, analyste, cheffe de chœur diplômée du Conservatoire national supérieur de musique de Paris, chargée de cours à Columbia University, New York (États-Unis)
Classification
Médias
Autres références
-
ABSIL JEAN (1893-1974)
- Écrit par Alain PÂRIS
- 943 mots
Figure dominante de la musique belge contemporaine, Jean Absil voit le jour à Bonsecours, dans le Hainaut. Il est élevé dans l'univers rigoureux de la musique d'église avant d'être admis au Conservatoire royal de Bruxelles. Il y remporte les premiers prix d'orgue, d'harmonie et de fugue et complète...
-
ACOUSMATIQUE MUSIQUE
- Écrit par François BAYLE
- 7 825 mots
- 5 médias
Reste qu'un certain nombre d'expériences marquantes constituent autant de jalons dans la découverte des propriétés du support-espace et permettent d'envisager favorablement l'avenir. Il est utile d'en rappeler la genèse et la progression. -
ADAMS JOHN (1947- )
- Écrit par Patrick WIKLACZ
- 1 969 mots
- 2 médias
...milieu idéal à ses activités, puisqu'il est nommé chef du département de composition du Conservatoire de San Francisco, où il va enseigner de 1972 à 1982. Edo De Waart, alors directeur musical de l'Orchestre symphonique de San Francisco, remarque ce professeur hors du commun et lui propose en 1978 un poste... -
ALÉATOIRE MUSIQUE
- Écrit par Juliette GARRIGUES
- 1 302 mots
- 4 médias
On range sous la dénomination de musique aléatoire les pratiques compositionnelles qui rejettent totalement ou ponctuellement la fixité. Cette musique fondée sur le hasard et l'indétermination est née au cours des années 1950, en réaction au sérialisme intégral. La part d'indétermination et de hasard...
- Afficher les 247 références
Voir aussi