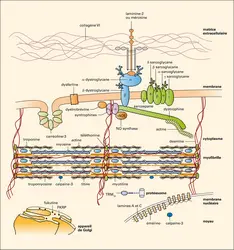MYOPATHIES
Article modifié le
Essais de stratégies thérapeutiques
Le développement des connaissances en génétique et en biologie moléculaire et cellulaire a ouvert le champ à de nouvelles approches thérapeutiques. Le traitement curatif reste l'objectif principal, même s'il paraît encore éloigné. Différentes stratégies thérapeutiques sont actuellement poursuivies.
La thérapie génique des myopathies
La thérapie génique vise à transférer un gène dans un but thérapeutique. Le gène introduit dans la cellule peut être le gène normal ou un autre gène permettant de pallier le déficit lié au gène muté responsable de la maladie. Pour acheminer le gène thérapeutique, le véhicule idéal serait un vecteur capable de franchir la paroi des cellules, puis celle de leur noyau, tout en esquivant le système immunitaire. Il devrait atteindre un grand nombre de cellules, mais uniquement celles qui ont besoin d'être soignées. Une palette de vecteurs a été mise au point. Tous comportent leurs points forts, mais aussi malheureusement leurs faiblesses.
Une première approche a consisté à injecter le gène sain porté par un plasmide (un morceau d'ADN circulaire). Cette approche est limitée par la faible incorporation de plasmides par les fibres musculaires.
Les vecteurs viraux sont maintenant utilisés pour apporter le gène réparateur au sein de la cellule. En effet, les virus traversent facilement les membranes cellulaires. L'ADN de ces virus est modifié pour ne pas être capable de se reproduire (on parle de virus inactivé). Des vecteurs rétroviraux, lentiviraux et adénoviraux ont été initialement utilisés, mais ce sont les adeno-associated virus ou AAV qui se sont par la suite montrés les mieux adaptés au traitement de modèles animaux de myopathies. Malheureusement, leur capacité d'incorporation d'ADN étranger est faible, ce qui empêche leur utilisation pour des myopathies dues à l'altération d'un gène trop long. Dans certains cas, un gène raccourci ou minigène peut apporter un bénéfice thérapeutique partiel.
La technique du « saut d'exon » est une nouvelle approche de thérapie génique. Elle consiste à obliger la « machinerie cellulaire » à sauter les portions du gène, les exons, porteuses d'anomalies. Ceci ne peut s'appliquer qu'à certaines protéines dont la structure « en modules » permet qu'une protéine incomplète ait une fonction suffisamment préservée.
La thérapie génique se heurte également à la durée de l'expression du gène curateur. En effet celle-ci doit être suffisante pour entraîner une amélioration de l'état des patients. Cette durée est d'autant plus essentielle qu'il est actuellement impossible de faire des injections répétées car le système immunitaire s'attaque au vecteur lors des réinjections. L'approfondissement des connaissances des outils de la thérapie génique (vecteurs, gènes, cellules), mais aussi des réponses du système immunitaire et des mécanismes physiopathologiques des myopathies vise à franchir ces obstacles.
La thérapie cellulaire des myopathies
Le principe consiste en l'injection de cellules (éventuellement modifiées) dans le muscle malade afin d'en compenser les déficiences. Les cellules satellites et les myoblastes, précurseurs des cellules musculaires adultes, ont été les premiers types cellulaires transplantés. Les résultats se sont avérés décevants du fait du rejet des cellules transplantées et de leur faible fusion avec les cellules musculaires de l'hôte. Une autre limitation réside dans la difficulté de produire un grand nombre de précurseurs musculaires.
Les recherches actuelles se concentrent sur le potentiel thérapeutique des cellules souches. Ces dernières ne sont pas déterminées vers la différenciation musculaire comme les cellules satellites. Elles sont capables de se reproduire en tant que cellules souches. Elles peuvent aussi, dans des conditions particulières, se différencier en un type cellulaire précis comme les cellules musculaires. On distingue ainsi les cellules souches embryonnaires et adultes. Les premières ont une énorme capacité proliférative, avec le risque d'emballement et de formation de tumeur. Elles peuvent se transformer en n'importe quel type cellulaire de l'organisme. La difficulté consiste à les obliger à se convertir en un type cellulaire bien précis, sauf à leur imposer la synthèse de facteurs de transcription appropriés (essais américains en 2008 avec Pax 3 chez la souris).
Les cellules souches adultes sont, en revanche, à un stade de maturation plus avancé que leurs homologues embryonnaires, ce qui les rend plus maîtrisables. De plus, la possibilité de les obtenir à partir du patient lui-même permet de limiter le risque de rejet. Les cellules souches adultes ne peuvent cependant se différencier qu'en un nombre limité de types cellulaires. Pour le traitement des myopathies, il convient donc d'identifier les cellules souches adultes capables de se différencier en cellules musculaires, et elles ne semblent pas nombreuses. Cellules souches embryonnaires et cellules souches adultes présentent donc chacune leurs atouts et leurs inconvénients, mais toutes deux constituent un potentiel thérapeutique à explorer.
Les thérapies pharmacologiques des myopathies
En marge des traitements médicamenteux visant à atténuer les symptômes, des recherches sont menées vers les thérapies pharmacologiques des myopathies. Plusieurs approches se révèlent encourageantes. La première consiste à utiliser des agents pharmacologiques pour induire l'expression d'un gène semblable au gène altéré et normalement non exprimé dans le muscle adulte. Ce peut être un gène embryonnaire ou un gène exprimé dans des types cellulaires différents. Il doit assurer une fonction similaire à celle du gène muté de façon à compenser son anomalie. La deuxième approche exploite l'effet d'un facteur de croissance sur le métabolisme cellulaire pour accroître les défenses de la cellule. Par exemple, l'insulin-like growth facteur 1 (IGF-1) stimule la prolifération et la différenciation des cellules satellites. Il augmente ainsi le diamètre et la force des fibres musculaires. Il reste à résoudre le problème du mode d'administration de l'IGF-1, qui doit éviter les effets généraux de ce facteur et doit donc être adressé spécifiquement aux muscles. Pour ce faire, le recours à la thérapie génique est envisagé. Un autre exemple, similaire dans son principe mais opposé dans la méthode, est apporté par l'inhibition de l'expression de la myostatine. Dans l'organisme normal, cette protéine limite la croissance musculaire. Dans les myopathies, et ceci a été montré dans un modèle de myopathie chez la souris, l'inhibition de la myostatine par injection d'anticorps spécifiques a permis d'améliorer la croissance des fibres musculaires.
Bien qu'aucun traitement curatif n'existe actuellement, l'accroissement des connaissances en génétique, ainsi qu'en biologie moléculaire et cellulaire, a permis des avancées très importantes dans le développement des thérapies géniques, cellulaires et pharmacologiques. Ces différentes approches, loin d'être concurrentes, sont complémentaires et permettent d'envisager dans le futur le traitement d'un grand nombre de myopathies.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Gisèle BONNE : docteur des Universités, université de Paris-VII, directeur de recherche à l'I.N.S.E.R.M.
- Valérie DECOSTRE : docteur en sciences biomédicales, Université catholique de Louvain, (Belgique), chercheuse post-doctorante à l'I.N.S.E.R.M.
- Anne LOMBÈS : docteur, I.N.S.E.R.M., M.D., Ph.D.
Classification
Médias
Autres références
-
ÉLECTROPHYSIOLOGIE
- Écrit par Max DONDEY , Jean DUMOULIN , Alfred FESSARD , Paul LAGET et Jean LENÈGRE
- 17 363 mots
- 15 médias
...syndrome myogène, le nombre des unités motrices reste inchangé mais il y a une atteinte irrégulièrement répartie des fibres musculaires. L'exemple type est la myopathie de Duchenne de Boulogne. Les tracés recueillis ont un caractère commun : ils sont interférentiels d'emblée, ils ont une amplitude et une durée... -
HÉRÉDITÉ
- Écrit par Charles BABINET , Luisa DANDOLO , Jean GAYON et Simone GILGENKRANTZ
- 11 237 mots
- 7 médias
Parmi les nombreuses maladies récessives liées à l'X, la dystrophie musculaire de Duchenne (D.M.D.), individualisée vers 1860 par le neurologue Guillaume B. Duchenne de Boulogne, est l'une des mieux connues et des plus sévères (cf. myopathies). Chez les garçons atteints, la dégénérescence... -
MALADIES MOLÉCULAIRES
- Écrit par Jean-Claude DREYFUS et Fanny SCHAPIRA
- 6 790 mots
- 1 média
...d'une maladie liée au chromosome X. Un des succès les plus précoces et les plus impressionnants de la méthode dite de génétique inverse a été la myopathie appelée dystrophie musculaire de Duchenne de Boulogne. C'est la plus fréquente des maladies liées au sexe, atteignant un garçon sur 3 500 environ.... -
MALFORMATIONS CONGÉNITALES
- Écrit par Jean de GROUCHY
- 2 931 mots
- 1 média
Les maladies des muscles peuvent être particulièrement sévères.Les myopathies sont les plus fréquentes. Elles sont dues à une atrophie qui frappe les muscles de façon progressive et entraîne une impotence clouant le malade au lit. La maladie, récessive, liée au sexe, frappe les garçons....
Voir aussi
- HÉRÉDITAIRES MALADIES ou MALADIES GÉNÉTIQUES
- NOYAU CELLULAIRE
- HANDICAPÉS
- MYOFIBRILLE
- THÉRAPIE CELLULAIRE
- CELLULES SOUCHES
- ÉLECTROMYOGRAPHIE
- BIOPSIE
- VECTEUR, thérapie génique
- HISTOLOGIE PATHOLOGIQUE
- CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES
- ANATOMIE PATHOLOGIQUE
- CELLULES SOUCHES ADULTES
- THÉRAPIE GÉNIQUE
- HISTOCHIMIE
- SAUT D'EXON
- EMERY-DREIFUSS DYSTROPHIE MUSCULAIRE D'
- LAMINES
- ÉMERINE
- GÉNÉTIQUE MOLÉCULAIRE
- DUCHENNE MYOPATHIE DE
- IGF (insulin-like growth factor)
- DYSTROPHINE
- DYSTROPHIE MUSCULAIRE