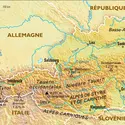NATIONALISATION
Article modifié le
Le régime juridique des nationalisations
La nationalisation est un acte de souveraineté. Mais elle doit, comme tous les actes de la puissance publique, respecter le droit interne et le droit international.
Les nationalisations et le droit interne
Le droit interne des États prévoit, souvent, la possibilité de procéder à des nationalisations et détermine, au moins sommairement, leur régime juridique. Ce régime comporte deux aspects : la réglementation du pouvoir de nationaliser et la fixation des règles relatives à l'indemnité. Le cas de la France est, à cet égard, topique.
Le pouvoir de nationaliser
La question revêt, là encore, deux aspects : qui peut nationaliser, et dans quelles conditions ?
La nationalisation est, en principe, opérée par une loi. Il peut arriver, cependant, que les transferts soient décidés par des actes du pouvoir exécutif sur la base d'une loi qui pose le principe de la nationalisation d'un secteur déterminé. Cette dernière méthode a, par exemple, été suivie pour la nationalisation des industries d'armement, en France, en 1936 (la loi du 11 août 1936 donne au gouvernement les pleins pouvoirs pour procéder à la nationalisation des entreprises de fabrication du matériel de guerre, jusqu'au 31 mars 1937).
Il s'agit alors de savoir si l'État dispose, dans l'ordre juridique interne, en la matière, d'un pouvoir totalement discrétionnaire ou, au contraire, conditionné. La question se double, dans cette dernière hypothèse, de celle de savoir qui est investi de la fonction de contrôler le respect des conditions posées à la licéité d'une nationalisation. La réponse est variable suivant les constitutions des États.
Lorsque existe une cour suprême, chargée de contrôler la constitutionnalité des lois, les nationalisations donneront lieu à un contrôle réel. C'est ainsi que la Cour suprême de l'Union indienne a déclaré inconstitutionnelle la nationalisation des banques opérée par la loi.
De manière générale, les tribunaux, à moins qu'ils ne disposent du pouvoir de contrôler la constitutionnalité des lois par voie d'exception, ne peuvent que tirer les conséquences d'une loi de nationalisation.
Les dernières nationalisations opérées en France ont donné l'occasion au Conseil constitutionnel de contribuer de manière importante à la théorie des nationalisations. En effet, le premier texte voté par le Parlement le 18 décembre 1981 a été déclaré contraire à la Constitution dans une décision du 16 janvier 1982 qui a déterminé les principes applicables en droit français. Ces principes reposent sur l'idée que la nationalisation doit être assimilée à l' expropriation, dont elle n'est qu'une forme particulière, comme l'admet la conception anglo-saxonne.
La nationalisation doit donc respecter les principes fondamentaux du droit de l'expropriation. Cependant, le Conseil constitutionnel a retenu une seconde idée qui limite le pouvoir de nationaliser : celle d'une « constitution économique » de la France, qui veut que les principes fondamentaux de la propriété privée des moyens de production et de la liberté d'entreprise aient une valeur constitutionnelle. Il en résulte les deux règles suivantes :
– comme toute expropriation, la nationalisation, pour être licite, doit être nécessaire. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de 1789, dispose, en effet, que l'expropriation ne peut avoir lieu que pour cause de « nécessité publique ». Le Conseil constitutionnel a jugé que la situation de crise économique justifiait, au regard de cette règle, les nationalisations décidées par le législateur, en l'absence d'erreur manifeste d'appréciation ;
– en tout état de cause, quels que soient les motifs invoqués, les nationalisations ne doivent pas entraîner des transferts d'une importance telle que les restrictions apportées au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre remettraient en cause le fondement essentiellement libéral de l'économie française. Le Conseil a estimé, dans sa décision, que les nationalisations réalisées restaient dans des limites acceptables au regard de ce critère.
On a pu, légitimement, s'interroger sur la portée du contrôle effectué par la haute instance. D'une part, la situation économique est la même pour pratiquement tous les pays occidentaux ; or, seule, la France a adopté la nationalisation comme moyen de lutte contre la crise. Cela montre bien qu'il n'existe aucune nécessité de procéder à des nationalisations, mais qu'elles relèvent d'un choix de politique économique et même, plus exactement, d'un choix de société. Le contrôle de la licéité des nationalisations sous le seul angle économique est un leurre ; et il semble illusoire de poser un principe d'extension maximale du secteur public, car, d'une part, il n'existe aucune définition opérationnelle du secteur public, d'autre part, il est impossible de dire avec quelque exactitude à partir de quel degré de « publicisation » de l'économie le système économique libéral est remis en cause.
Si l'on ajoute que le secteur public français, avant 1982, avait déjà un poids déterminant en termes d'effectifs, avec environ 1 100 000 salariés, auxquels les nationalisations de la loi du 11 février 1982 ajoutèrent quelque 760 000 personnes, ce qui fait qu'il représentait 10 p. 100 de la population active et le tiers des emplois industriels, on voit que la marge pour d'éventuelles nouvelles nationalisations aurait été étroite.
L'indemnisation
Si la reconnaissance du principe du droit à une juste indemnité fait peu de difficulté, il n'en est pas de même des modalités de l'indemnisation ni de la détermination de son montant. Il faut reconnaître que nombre de nationalisations opérées dans le passé se sont traduites par une véritable spoliation.
En théorie, l'indemnité devrait être versée préalablement au transfert ou, au moins, de manière concomitante. Cette règle connaît un assouplissement généralisé, dans la mesure où la plupart des nationalisations donnent lieu à une remise de titres dont l'amortissement se fait sur une longue durée. Cette pratique pose deux questions. La première est celle du montant du titre indemnitaire qui devrait, en toute logique, compenser la perte produite par la nationalisation. La seconde est celle du maintien de la valeur du titre en période d'inflation, ce qui suppose soit une indexation, soit que le rendement dépasse, en tout état de cause, le taux de l'inflation. En ce qui concerne les dernières nationalisations françaises, le Conseil constitutionnel a exigé que le mode d'indemnisation soit « suffisamment équivalent à un paiement en numéraire ». Il a jugé cette condition remplie pour les titres prévus par la loi du 11 février 1982 : il s'agissait d'obligations produisant intérêt, immédiatement négociables car inscrites à la cote officielle, et remboursables en quinze tranches annuelles (ce qui fait apparaître une échéance moyenne de remboursement de sept ans et demi).
Mais la question essentielle est, en fait, quasi insoluble : c'est celle de la fixation du montant de l'indemnité. La solution la plus simple et la plus souvent adoptée est de prendre pour base la valeur des titres, si l'entreprise nationalisée est une société. Si la société est cotée, la valeur du titre en bourse peut être prise comme référence pour l'indemnité : l'indemnité globale à verser sera égale au montant, plus ou moins corrigé, de la capitalisation boursière.
C'est ce qui s'est fait pour les dernières nationalisations françaises. Est-ce la juste valeur de l'entreprise nationalisée ? C'est contestable. D'autres nationalisations ont été indemnisées sur la base de la valeur liquidative, mais une telle méthode n'intègre aucun élément dynamique représentant la rentabilité de l'entreprise. De plus, il faut noter que, pour les grosses participations et les filiales, l'indemnisation sur la base de la cotation boursière ne correspond certainement pas à la perte subie dans le cadre d'une stratégie à long terme : ce qui est perdu, c'est le pouvoir sur une entreprise ou sur un secteur entier, et c'est une perte bien plus considérable que celle de la valeur des titres correspondants.
Les nationalisations et le droit international
Du point de vue du droit international, les nationalisations posent une double question : celle des conditions de leur licéité et de leurs effets au-delà du territoire de l'État qui les réalise.
Le droit international a considérablement évolué vis-à-vis du problème des nationalisations. Dans un premier temps, elles ont été considérées comme illicites. Puis, leur multiplication, surtout après la décolonisation, a conduit à abandonner complètement cette conception. L'évolution s'est faite alors vers la reconnaissance d'un droit de nationaliser pratiquement sans limite, consacré par la charte des droits et des devoirs économiques des États (rés. 3281 XXIX du 12 décembre 1974). Il semble que le droit international revienne actuellement à une conception plus proche des idées classiques en la matière.
En principe, la nationalisation n'a pas d'effet au-delà du territoire national, ou, du moins, pas d'effet automatique. Dans la mesure où elle apparaîtrait contraire à l'ordre juridique des États étrangers, ses effets peuvent se trouver paralysés. C'est ainsi, par exemple, que le tribunal de commerce de Namur a décidé, à la demande d'actionnaires de Saint-Gobain, en juin 1982, de placer sous séquestre les actions détenues par Saint-Gobain dans sa filiale belge des glaceries de Saint-Roch. Seul un accord entre l'État nationalisant et les propriétaires ou les États étrangers peut donner aux nationalisations leur plein effet au-delà du territoire national.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Jean-Claude BONICHOT : maître des requêtes au Conseil d'État
- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis
Classification
Autres références
-
ALGÉRIE
- Écrit par Charles-Robert AGERON , Encyclopædia Universalis , Sid-Ahmed SOUIAH , Benjamin STORA et Pierre VERMEREN
- 41 845 mots
- 25 médias
...le secteur du pétrole... » La participation algérienne est portée à 51 % dans l'ensemble des sociétés pétrolières françaises implantées en Algérie. La nationalisation est effective pour les gisements et le transport des hydrocarbures. Cette décision, prise moins de dix ans après l'indépendance du pays,... -
ALLEMAGNE (Politique et économie depuis 1949) - République démocratique allemande
- Écrit par Georges CASTELLAN et Rita THALMANN
- 19 518 mots
- 6 médias
...propriété soviétique (SowjetAktiengesellschaft : S.A.G.) et seraient exploitées au compte des réparations. Quant aux autres usines sous séquestre, des lois de nationalisation furent promulguées par les Länder : 3 843 entreprises industrielles furent touchées, représentant 20 à 25 p. 100 de la capacité... -
ASSURANCE - Histoire et droit de l'assurance
- Écrit par Jean-Pierre AUDINOT , Encyclopædia Universalis et Jacques GARNIER
- 7 497 mots
- 1 média
...(1850) établissement public, la C.N.P. a été transformée en 1992 en société anonyme appartenant au secteur public et rebaptisée CNP-Assurances. Par ailleurs, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale (25 avril 1946), l'État procéda à la nationalisation – comme il le fit pour certaines... -
AUTRICHE
- Écrit par Roger BAUER , Jean BÉRENGER , Annie DELOBEZ , Encyclopædia Universalis , Christophe GAUCHON , Félix KREISSLER et Paul PASTEUR
- 34 129 mots
- 21 médias
...aux exigences soviétiques, le S.P.Ö. et l'Ö.V.P. prônent la mise en place d'un vaste secteur nationalisé, idée qui reçoit alors l'aval des Américains. En juillet 1946 et en mars 1947, deux lois sur les nationalisations transfèrent à l'État les grandes banques, la totalité du secteur de l'industrie lourde,... - Afficher les 45 références
Voir aussi
- TIERS MONDE
- ÉCONOMIQUE DROIT
- CONSTITUTION SOVIÉTIQUE DE 1936
- COLLECTIVISATION
- EXPROPRIATION
- INTERVENTIONNISME, économie
- PLANIFICATION, économie
- PAYS EN DÉVELOPPEMENT (PED)
- SNCF (Société nationale des chemins de fer français)
- TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ
- ÉCONOMIE MIXTE
- FILIALES
- RENAULT
- TITRE, banque et Bourse
- ÉCONOMIES SOCIALISTES
- POLITIQUE ÉCONOMIQUE
- SERVICE PUBLIC
- ENTREPRISES PUBLIQUES
- SOCIALISATION, économie
- FRANCE, économie
- FRANCE, histoire, de 1939 à 1958
- FRANCE, histoire, de 1974 à nos jours
- CONSTITUTION FRANÇAISE DE 1946
- INDEMNISATION
- PRODUCTION MOYENS DE
- ÉCONOMIE DU DÉVELOPPEMENT
- CONTRÔLE DES ENTREPRISES PUBLIQUES
- PRIVATISATION
- CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ