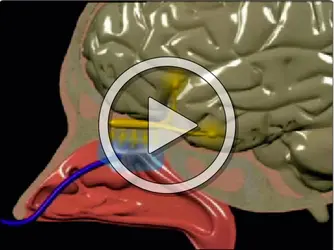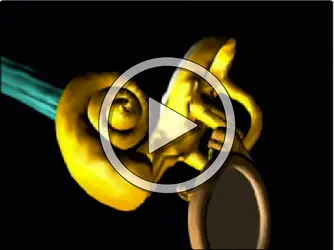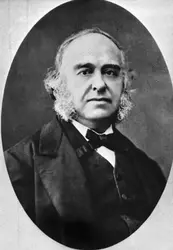NEUROLOGIE
Article modifié le
Neurologie clinique
L' étude médicale du système nerveux constitue l'objectif des sciences neurologiques. Leur but est de détecter aux différents étages de l'appareil nerveux, une lésion altérant soit ses voies, soit ses structures. C'est ainsi que le processus pathogène, qui dégrade une fonction, peut siéger aux différents niveaux de l'encéphale, de l'axe médullaire ou des nerfs périphériques sensitifs ou moteurs.
Les symptômes qui extériorisent l'événement pathologique se traduisent, très schématiquement, soit par un trouble déficitaire, soit par un trouble excitatoire : déficitaire, en diminuant l'efficience normale d'une fonction (telles paralysie, diminution de l'acuité perceptive d'une sensation, incoordination du geste, ou encore baisse du niveau de la vigilance) ; excitatoire, en exaltant le rôle dévolu à une structure (crise d'épilepsie, par exemple).
Le diagnostic de ces maladies, qui se fondait autrefois uniquement sur la méthode clinique, s'est progressivement enrichi de l'apport de disciplines d'exploration nerveuse, telles que la neuroradiologie, la neurohistologie, la neurochimie, la neuroélectrologie et les techniques physiques fondées sur les radio-isotopes, les ultrasons et, plus récemment encore, sur la résonance nucléaire magnétique (I.R.M.) ou la tomographie par émission de positrons.
Quatre étapes seront nécessaires pour parvenir au diagnostic d'une affection neurologique :
– La première étape consiste à déceler chez un patient l'existence de perturbations des fonctions nerveuses, à déterminer leur nature, leur signification par rapport aux différents systèmes qui président au comportement de la vie de relation : c'est l'étape sémiologique représentée par l'examen clinique.
– La deuxième étape est d'ordre intellectuel et dialectique : elle a pour but, en fonction, d'une part, des données de l'anatomie et de la physiologie du système nerveux, d'autre part des constatations de l'examen clinique, de déterminer le siège de la lésion en cause (fig. 1), c'est-à-dire le niveau du système nerveux où l'existence d'une lésion est susceptible d'entraîner les différentes anomalies constatées à l'examen clinique.
– La troisième étape va chercher à déterminer quel est le processus pathologique à l'origine de la lésion constatée. Ces processus ne sont pas particuliers au système nerveux : accidents de type traumatique ou vasculaire, tumoral, infectieux, toxique, métabolique, allergique ; ou bien anomalies dégénératives, malformatives.
À ces trois étapes purement cliniques vient s'ajouter celle dite des examens complémentaires. Ceux-ci prennent, de nos jours, une importance de plus en plus grande, et l'on ne saurait actuellement porter un diagnostic sans mettre en œuvre un ou plusieurs d'entre eux, chacun ayant ses possibilités et ses limites. À vrai dire, ces examens complémentaires ne constituent pas une étape du diagnostic à proprement parler, mais jalonnent les différentes phases du bilan neurologique. Par souci de clarté, nous avons regroupé, de façon un peu arbitraire, ces différents examens et nous les décrirons après les sous-chapitres traitant de l'examen clinique et du diagnostic de la cause de la lésion.
La thérapeutique de ces affections bénéficie, selon leur nature, soit des méthodes chirurgicales dont l'ensemble constitue la neurochirurgie, soit de méthodes pharmacologiques ou encore physiques.
L'examen clinique
L' examen clinique comporte deux grandes étapes : l'interrogatoire et l'examen objectif du malade.
L'interrogatoire constitue peut-être la phase la plus importante de l'investigation clinique. Il devra être conduit avec rigueur, sans influencer le malade et en lui évitant des digressions inutiles. Il devra s'efforcer de préciser le mode d'apparition, la durée de l'évolution et la chronologie des différents symptômes. Il recherchera, dans le passé du malade ou chez ses ascendants, des faits susceptibles d'éclairer le diagnostic étiologique (en particulier, antécédents traumatiques, infectieux, néonataux, familiaux, épisodes neurologiques antérieurs). La qualité de cet interrogatoire peut être compromise du fait de l'état du malade... (détérioration intellectuelle, troubles du langage, troubles caractériels, état confusionnel, troubles de la mémoire), ou même il peut devenir pratiquement impossible lorsqu'il existe une baisse plus ou moins profonde du niveau de la vigilance. C'est dans ces circonstances que l'interrogatoire de l'entourage immédiat ou des témoins de certains faits pathologiques revêtira toute son importance.
L'histoire de la maladie reconstituée, le neurologue commence l'examen du sujet en étudiant minutieusement la fonction du système nerveux qui lui paraît concernée d'après les données de l'interrogatoire. Cette première étape de l'examen objectif du malade ne dispense nullement le spécialiste de pratiquer un bilan neurologique complet. Cela lui permettra de recueillir d'autres signes, et de préciser ainsi la topographie de la lésion observée. Cela lui fournira également, dans certains cas, la clef du diagnostic étiologique ; de plus, la découverte de signes multiples à distance de la région principalement lésée permettra d'évoquer par exemple, chez un sujet jeune, la possibilité d'une sclérose en plaques. Parfois, l'interrogatoire n'ayant recueilli que des signes indirects sans valeur topographique, seul l'examen systématique de chaque fonction aidera à formuler un diagnostic et, en tout cas, à orienter les examens complémentaires. L'examen clinique se déroulera ainsi par étapes.
La connaissance des grandes lignes de la physiologie du système nerveux étant nécessaire à la compréhension des différentes phases de l'examen, on rappellera brièvement les caractères physiologiques essentiels de chaque fonction interrogée avant d'en décrire l'examen.
La motricité
La fonction motrice met en jeu différentes structures : cellules « pyramidales » motrices de la circonvolution frontale ascendante du cortex cérébral ; voies motrices descendantes (pyramidale et géniculée) ; cellules motrices de la corne antérieure de la moelle ; fibres motrices périphériques ; jonction entre les fibres motrices et les muscles (plaque motrice) ; enfin, le muscle lui-même (fig. 1).
L' examen neurologique explore avec soin la force musculaire des différents segments des membres, s'attachant plus particulièrement aux régions désignées par l'histoire clinique de la maladie. On appréciera successivement la motricité des membres, des différentes régions du tronc, de la nuque et de la face. Cet examen permettra de préciser l'intensité de l'atteinte motrice et sa répartition. Il orientera soit vers une atteinte périphérique, soit vers une atteinte des voies centrales et définira éventuellement une formule topographique des déficits moteurs ( hémiplégie, paraplégie, quadriplégie ou monoplégie).
Le tonus musculaire
Le muscle est normalement maintenu dans un certain état de contraction grâce à l'influence du système nerveux et plus particulièrement, grâce au système de régulation médullaire et supramédullaire de la motricité. La conjonction de ces différentes influences permet le maintien de la station debout et sous-tend les différentes phases du déroulement du mouvement.
L'examen est essentiellement fondé sur l'exploration de la résistance musculaire rencontrée au cours de la mobilisation passive des segments de membre, le sujet étant totalement relâché. L'observateur pourra ainsi mettre en évidence soit une exagération du tonus ( hypertonie), soit une diminution de celui-ci (hypotonie).
Parmi les hypertonies, deux formules caractéristiques peuvent être extériorisées : l'hypertonie d'origine pyramidale, qui se traduit par un état de contracture systématisée et non « plastique », le membre ayant tendance à reprendre sa position initiale lorsqu'il est mobilisé (elle s'accompagne presque toujours d'un certain degré de déficit moteur) ; l'hypertonie d'origine extrapyramidale, qui détermine une contracture plastique diffuse, cédant par à-coups lorsque le membre est mobilisé (phénomène de la « roue dentée »).
Parmi les hypotonies, on distingue : l'hypotonie d'origine cérébelleuse, qui s'accompagne des autres stigmates du syndrome cérébelleux (cf. infra, Syndrome cérébelleux) ; les hypotonies des atteintes périphériques, par interruption de l'arc réflexe médullaire contrôlant la tonicité segmentaire, les hypotonies d'origine pyramidale et les hypotonies sous-jacentes de certains mouvements anormaux de type choréique par exemple.
La trophicité
La dénervation est susceptible d'entraîner des modifications tissulaires touchant les différents plans, tant cutanés que musculaires, articulaires ou osseux. Ce sont les lésions médullaires et celles des voies nerveuses périphériques qui sont, le plus souvent, responsables de ces troubles de la trophicité.
La dénervation motrice détermine une diminution du volume musculaire ; cette amyotrophie résulte de l'atteinte des voies nerveuses qui relient la corne antérieure de la moelle au muscle.
Les arthropathies et les maux perforants ont en principe pour origine les troubles de la vasomotricité des réseaux tissulaires, conjugués à des troubles de la sensibilité des systèmes de contrôle de la trophicité. Quant aux algodystrophies, qui compliquent certaines affections neurologiques, elles sont vraisemblablement dues à un dysfonctionnement du système sympathique.
L'examen peut révéler les trois types de troubles décrits ci-dessus. L'amyotrophie est le plus souvent visible ; elle s'accompagne, en règle générale, de fibrillations musculaires, traduites par de rapides ondulations sous-cutanées, et d'une abolition du réflexe tendineux correspondant (ces deux derniers signes permettent, en particulier, de distinguer l'amyotrophie d'origine nerveuse de l'amyotrophie primitive d'une myopathie, où ils sont absents). Dans les arthropathies neurogènes, les désordres articulaires entraînés par des affections nerveuses, comme le tabès et la syringomyélie, ont pour caractère essentiel d'être totalement indolores, alors que le dommage anatomique est souvent très important ; quant aux maux perforants, ils sont le plus souvent plantaires, et ne s'accompagnent d'aucune douleur réactionnelle.
Les réflexes
La fonction interrogée dans le cas des réflexes tendineux est l'arc réflexe sensitivo-moteur (réflexe d'étirement ou réflexe myotatique). On sait que, schématiquement, il comporte une fibre sensitive d'origine musculaire qui s'articule avec une cellule motrice (motoneurone alpha) qui, elle-même, innerve ce même muscle. En fait, ce schéma est simpliste (cf. somesthésie).
L'examen des réflexes tendineux est pratiqué en percutant les tendons du muscle exploré. Cette manœuvre, qui doit se faire sur un sujet en parfait relâchement musculaire, est pratiquée grâce à un marteau spécialement adapté à cet effet. La réponse réflexe est appréciée aussi bien en elle-même que par comparaison avec le côté opposé. Les réflexes les plus couramment explorés sont ceux des membres supérieurs (réflexes bicipitaux, tricipitaux, stylo-radiaux et cubitopronateurs), des membres inférieurs (réflexes rotuliens et achilléens), de la face (réflexe massétérin).
Les modifications pathologiques constatées sont essentiellement de deux ordres : d'une part, l'abolition d'un réflexe, ou son affaiblissement par rapport à celui du côté opposé, témoigne le plus souvent d'une lésion directe d'un des composants nerveux de l'arc réflexe (chaque réflexe correspondant à un niveau médullaire donné, on conçoit que son abolition ait, du même coup, une valeur localisatrice fondamentale) ; d'autre part, l'exagération d'un réflexe traduit toujours l'existence d'une lésion centrale, c'est-à-dire des voies descendantes de contrôle de l'excitabilité de l'arc réflexe. Cette exaltation est le plus souvent synonyme, pour le neurologue, d'une lésion du faisceau moteur pyramidal qui est l'émanation de l'aire motrice du cortex cérébral.
La fonction interrogée, dans le cas des réflexes cutanés, met en jeu des circuits plus complexes que ceux impliqués dans le réflexe tendineux. La valeur sémiologique de ces réflexes est identique à celle des réflexes tendineux tant sur les plans lésionnel que topographique.
L'examen des réflexes cutanés portera avant tout sur les réflexes cutanés abdominaux, crémastériens et cornéens.
Il faut faire une place bien à part au réflexe cutané plantaire, ou signe de Babinski, qui joue un rôle fondamental dans l'examen neurologique du malade. L'excitation de la plante du pied le long de son bord externe, en allant du talon vers les orteils, entraîne normalement la flexion du gros orteil. Si cette réponse se fait en extension lente, on affirme l'existence d'un signe de Babinski et, par là même, l'existence d'une lésion de la voie motrice pyramidale. Lorsque ce signe est recherché dans de bonnes conditions, sa constatation a une valeur sémiologique absolue.
La sensibilité
Chaque type de sensibilité correspond théoriquement à un faisceau particulier de fibres nerveuses. La sensibilité profonde consciente ou articulaire est conduite par les fibres des cordons postérieurs de la moelle, de même que la sensibilité tactile. De là, ces fibres, après s'être décussées sur la ligne médiane, se rendent au noyau spécifique du thalamus, puis à la région pariétale du cerveau. La sensibilité douloureuse emprunte le faisceau antérolatéral de la moelle après avoir croisé la ligne médiane. Les cibles structurales de ces fibres sont mal systématisées, un faible contingent atteignant le thalamus alors que la majeure partie rejoint des structures non spécifiques des centres nerveux cérébraux (cf. douleur). La sensibilité thermique est également conduite par le faisceau antérolatéral de la moelle, et ses cibles sont sensiblement identiques à celles de la sensibilité douloureuse, seul un faible contingent atteignant le cortex pariétal du cerveau.
En ce qui concerne l'examen, il doit être pratiqué en deux phases.
– Les sensibilités dites sensibilités superficielles (tactile, douloureuse et thermique) sont inventoriées sur la surface du corps selon un schéma d'examen rationnel, le malade ayant les yeux fermés. Comme l'étude de la motricité et des réflexes, l'étude de la sensibilité permettra d'apporter des informations topographiques sur la lésion causale. On pourra ainsi évoquer soit l'atteinte d'un tronc nerveux ou d'une racine, soit une atteinte intramédullaire, soit enfin une atteinte des voies sensitives dans leur trajet ascendant ou dans leur zone de projection corticale.
C'est ainsi, par exemple, que la présence de symptômes traduisant, sur plusieurs segments médullaires, une dissociation entre l'atteinte des sensibilités douloureuse et thermique (abolies) et la conservation de la sensibilité tactile caractérise une lésion intramédullaire. S'il existe, d'un côté du corps, une atteinte de la sensibilité thermo-algique et, de l'autre côté, un trouble de la sensibilité articulaire et tactile associé à un déficit moteur du même côté, il s'agit d'un syndrome de Brown-Séquard ou d'hémisection de la moelle.
– Les sensibilités dites sensibilités profondes conscientes sont explorées en interrogeant le sens des attitudes segmentaires. Chaque individu normal peut en effet reconnaître, les yeux fermés, la position de ses segments de membre dans l'espace. De multiples manœuvres ont ainsi été codifiées afin de déceler un déficit du sens de position articulaire.
Plus complexe est l'examen de la stéréognosie, c'est-à-dire de la faculté de reconnaître un objet placé dans la main, en l'absence de contrôle de la vue. Son intégrité demande, en effet, à la fois la conservation de la sensibilité superficielle et celle de la sensibilité profonde consciente.
La coordination du mouvement
C'est le cervelet, et plus particulièrement ses régions latérales (neocerebellum), qui règle la coordination du geste. Cet ajustement de la motricité résulte du jeu harmonieux des muscles agonistes et antagonistes des différents segments de membre engagés dans le mouvement. Les régions latérales du cervelet sont plus particulièrement en relation avec le cortex cérébral par un circuit cortico-cérébello-cortical presque fermé.
De multiples épreuves ont été décrites pour mettre en évidence l'incoordination dynamique qui se traduit sous trois formes : l' hypermétrie, extériorisée par la manœuvre du « doigt sur le nez » (ou sur le lobule de l'oreille), ou celle du « talon sur le genou » qui mettent en évidence une imprécision du geste, elle-même traduite par un dépassement du but, alors que la direction générale du mouvement est conservée ; l' asynergie, décelée par l'exécution d'un mouvement complexe qui permet de constater une décomposition du mouvement en plusieurs temps, alors que, normalement, ces différents temps sont étroitement fusionnés ; l' adiadococinésie, marquée par une difficulté d'exécution des mouvements alternatifs complexes, celui dit de la « manœuvre des marionnettes », par exemple.
Ces signes évoluent en règle générale sur un fond d'hypotonie musculaire.
La statique
La statique est assurée par le système vestibulaire, par la région vermienne du cervelet et par les circuits de la sensibilité profonde.
– Le système vestibulaire est organisé de telle façon qu'il est capable de détecter à tout moment la position de la tête dans l'espace et ses déplacements par rapport à une position référentielle. Ces informations sont essentiellement captées par l'appareil vestibulaire qui est situé dans l'os temporal, et plus particulièrement par les canaux semi-circulaires (oreille interne). Tout changement de position alerte immédiatement les centres vestibulaires du tronc cérébral et détermine une réaction immédiate de correction dans la répartition du tonus musculaire antigravifique.
L'examen comporte l'étude de la marche : le sujet dévie préférentiellement d'un côté au cours d'un déséquilibre d'origine vestibulaire ; l'étude d'un sujet debout, pieds joints, où l'on constate une tendance à la chute d'un côté ( signe de Romberg labyrinthique) qui reste toujours le même au cours de plusieurs épreuves successives ; la recherche d'un nystagmus, signe fondamental du dysfonctionnement du système vestibulaire, qui s'extériorise par l'existence de secousses oculaires comportant une composante lente dans un sens et rapide dans l'autre : il est constaté lorsque le sujet regarde latéralement. La valeur sémiologique du nystagmus est très importante et le neurologue peut, dans certains cas, rapporter la lésion vestibulaire à une atteinte soit périphérique (nystagmus dans le regard horizontal), soit centrale (nystagmus dans le regard vertical, ou dans toutes les différentes possibilités extrêmes du regard : nystagmus multiple).
Cet examen de la fonction vestibulaire sera complété par des épreuves instrumentales.
– Le système cérébelleux : c'est essentiellement la partie médiane (vermis et lobe floculo-nodulaire) du cervelet qui joue un rôle de premier plan dans le maintien d'une statique normale. Cette région du cervelet est en étroite connexion avec la moelle recevant des informations multiples, en particulier des fuseaux neuromusculaires des muscles et des récepteurs tendineux, et émet des influx qui assurent la coordination statique, contrôle l'activité motrice des membres supérieurs, des membres inférieurs et du tronc. Cette région assure ainsi la coordination des groupes musculaires engagés dans le maintien de la posture debout, de la marche et de l'équilibre.
À l'examen, les troubles statiques résultant des lésions de la région vermienne s'expriment par un déséquilibre différent de celui constaté lors d'une atteinte vestibulaire. Le malade a une allure titubante, sans latéralisation, sa base de sustentation est élargie lors de la marche et durant la station debout ; il oscille, mais la chute est exceptionnelle.
– La sensibilité profonde : on interroge ici la qualité de la sensibilité profonde consciente dont le mauvais fonctionnement se manifeste par une perte du sens de position des segments de membre. Ce type de sensibilité (cf. supra, La sensibilité) est transmis par les cordons postérieurs de la moelle, puis se rend, après relais dans le tronc cérébral, au thalamus, pour se projeter sur les régions pariétales. On comprend qu'une lésion bilatérale, située le plus souvent au niveau des cordons postérieurs de la moelle, se traduise par un trouble de l'équilibre, le sujet ignorant la position de ses membres par rapport au sol. L'examen met ici en évidence une marche incertaine et talonnante ; la position « pieds joints » permet de constater des oscillations, mais, surtout, l'occlusion des yeux entraîne une aggravation considérable de ces troubles, qui peut aller jusqu'à la chute.
Les fonctions génito-sphinctériennes
Le contrôle des sphincters et de l'appareil sexuel est d'ordre réflexe ; il est exercé par le système neurovégétatif, plus spécialement par des centres situés dans la partie sacrée de la moelle et qui sont eux-mêmes contrôlés par les voies médullaires descendantes. C'est dire que les troubles seront essentiellement rencontrés lors des atteintes bilatérales de la moelle basse ou des racines sacrées (syndrome de la queue-de-cheval), mais ils peuvent être également présents dans les atteintes médullaires bilatérales plus haut situées. Ils ne devront pas être confondus avec les troubles sphinctériens par dissolution du contrôle volontaire tels qu'on les constate lors des syndromes des lobes frontaux.
Les paires crâniennes
Au nombre de douze, les paires crâniennes sont systématiquement examinées au cours de l'examen neurologique, car leur valeur dans le diagnostic lésionnel topographique est fondamentale. Parmi celles-ci, nous réserverons l'étude du nerf optique (II) et des voies visuelles au chapitre consacré aux examens complémentaires, et cela pour deux raisons : d'une part, le nerf optique n'est pas un nerf crânien, au sens strict du terme, mais une évagination d'origine cérébrale, et, d'autre part, son exploration est surtout du domaine du spécialiste ophtalmologiste.
Le nerf olfactif
Le nerf olfactif est très court et se rend au bulbe olfactif situé sous le lobe frontal. De là, les influx sensitifs gagnent les régions antérieures du lobe temporal incluses dans ce qu'il est convenu d'appeler le rhinencéphale. La fonction olfactive est responsable non seulement de la perception des substances odorantes par voie aérienne, mais également d'une partie de la gustation. Seuls, parmi les sensations alimentaires perçues, le salé, le sucré, l'acide et l'amer sont l'apanage de la gustation. Toutes les autres nuances gustatives sont appréciées grâce à l'appareil olfactif.
L'examen consiste à faire percevoir des substances odorantes, narine par narine. Cet examen sommaire peut être complété par des épreuves plus précises, utilisant un olfactomètre.
Les nerfs moteurs oculaires (III, IV, VI)
On interroge ici la fonction oculomotrice :
– Le nerf moteur oculaire commun (III) émerge du tronc cérébral, au niveau des pédoncules cérébraux, et innerve essentiellement les muscles adducteurs et élévateurs du globe oculaire et le muscle releveur de la paupière. Il participe, par les fibres parasympathiques qui suivent son trajet, à l'innervation de la pupille.
– Le nerf moteur oculaire externe (VI) naît au niveau de la protubérance et dessert le muscle abducteur de l'œil (muscle droit externe).
– Le nerf pathétique (IV) quitte le tronc cérébral par sa face dorsale et, après avoir croisé la ligne médiane, vient innerver le muscle grand oblique, ou muscle du « mépris ».
À l'examen, la paralysie du III est aisément reconnue devant une chute de la paupière supérieure (ptôsis) et un strabisme divergent ; la paralysie du VI détermine un strabisme convergent, et la paralysie du IV une limitation de l'abaissement et de l'abduction du globe oculaire.
À côté de ces paralysies de la musculature extrinsèque du globe oculaire, le neurologue recherche d'autres formes d'atteinte de la mobilité oculaire. Il peut constater : a) une atteinte de la musculature intrinsèque ( si l'existence d'une dilatation pupillaire paralytique signale une lésion des fibres parasympathiques solidaires du III, la constatation d'une immobilité pupillaire à la lumière, contrastant avec la conservation d'une accommodation à la distance, met en évidence le signe d'Argyll-Robertson ; la valeur sémiologique de ce signe est de premier plan, car il traduit le plus souvent une syphilis nerveuse) ; b) l'atteinte associée des mouvements des deux yeux : la paralysie de cette fonction résulte d'une atteinte des voies supranucléaires qui vont du cortex cérébral aux noyaux des nerfs moteurs oculaires (elle constitue soit un syndrome de Parinaud avec paralysie de la verticalité et de la convergence du regard, soit un syndrome de Foville avec paralysie de la latéralité du regard).
Le nerf trijumeau (V)
Le nerf trijumeau, qui naît au niveau de la protubérance, assure l'innervation sensitive de la plus grande partie de la face et d'une partie du cuir chevelu. Il possède également un contingent moteur qui commande la motricité de la mâchoire.
L'examen de la sensibilité se fait par comparaison avec le côté opposé, et une mention spéciale doit être faite pour l'exploration de la sensibilité cornéenne car elle peut être atteinte isolément. L'atteinte motrice est décelée par l'exécution des mouvements d'ouverture, de fermeture et de latéralité de la mâchoire inférieure.
Signalons que le dysfonctionnement de ce nerf peut donner lieu à une des douleurs les plus intenses que puisse ressentir l'homme (névralgie faciale).
Le nerf facial (VII)
Le nerf facial, qui naît au niveau de la protubérance du tronc cérébral, assure la motilité du visage.
L'examen doit être particulièrement précis, et un certain nombre d'épreuves ont été codifiées afin de faire la différence entre une asymétrie faciale d'origine constitutionnelle et une asymétrie pathologique. Le nerf facial est accompagné par des fibres sensitives et sensorielles qui constituent le nerf intermédiaire de Wrisberg (VII bis). Ces fibres participent à la sensibilité de l'oreille externe et à la sensibilité gustative des deux tiers antérieurs de la langue.
Le nerf acoustique (VIII)
Le nerf acoustique est couplé avec le nerf vestibulaire. Il pénètre dans le tronc cérébral au niveau du sillon bulbo-protubérantiel, puis s'articule avec les voies ascendantes qui se projettent elles-mêmes sur le lobe temporal.
Le neurologue peut détecter une baisse de l'acuité auditive, qui est le plus souvent constatée par le malade lui-même, mais la recherche du niveau lésionnel (oreille moyenne, oreille interne, nerf acoustique ou même atteinte centrale) est du ressort du spécialiste.
Le nerf glosso-pharyngien (IX)
Naissant au niveau du bulbe, ce nerf assure essentiellement l'innervation du tiers postérieur de la langue et de la voûte du palais ; son rôle moteur se confond avec celui du X et du XI bulbaire.
À l'examen, lorsque le malade prononce la lettre « a », on assiste, en cas d'atteinte du glosso-pharyngien, à un déplacement latéral du voile du palais (signe du rideau). Ce signe apparaît avec une grande netteté lorsque la paralysie du IX se combine à une paralysie du X.
Le pneumogastrique (X)
Le pneumogastrique, ou nerf vague, naît de la région bulbaire et a essentiellement un rôle végétatif parasympathique. Il assure également une fonction sensitive et motrice au niveau de la région pharyngo-laryngée.
À l'examen, l'atteinte de ce nerf se traduit par une hémiparalysie du voile du palais et du larynx.
Le nerf spinal (XI)
Le nerf spinal comporte deux branches, interne et externe. La branche interne recouvre les mêmes territoires que ceux du nerf pneumogastrique ; la branche externe a une destinée motrice assurant l'innervation des muscles sterno-cléido-mastoïdien et trapèze.
Pour déceler une atteinte éventuelle de ce nerf, le neurologue recherche la disparition de la saillie du tendon du sterno-cléido-mastoïdien lors des mouvements de rotation de la tête, et l'effacement du muscle trapèze lors des mouvements de haussement des épaules.
Le nerf grand hypoglosse (XII)
Le nerf grand hypoglosse, qui naît au niveau du bulbe à sa partie tout inférieure, est purement moteur et assure l'innervation de la langue.
Lorsque le sujet tire la langue, on constate une déviation de celle-ci du côté paralysé. De plus, l'hémilangue est atrophique ; des fibrillations musculaires s'y produisent.
Fonctions d'intégration complexes
L'exploration clinique des fonctions d'intégration complexes vise à mettre en évidence les troubles du langage (aphasies), les troubles de l'exécution des gestes (apraxies), les troubles de la reconnaissance des symboles extérieurs aussi bien visuels qu'auditifs ou tactiles (agnosies).
Aphasies
L'exercice de la fonction du langage présuppose : a) des structures de réception, plus particulièrement les régions occipitale (vision) et temporale antérieure (audition) ; b) des structures effectrices, et plus spécialement les régions de commande de la motricité bucco-pharyngo-laryngo-faciale, localisées à la partie inférieure de la zone motrice ; c) des structures d'intégration et de formulation représentées par la région du carrefour temporo-occipito-pariétal, située au centre des structures afférentes et efférentes. Cette région constitue une étape indispensable pour l'extraction des informations et réalise la première phase de la formulation du langage.
Ce schéma est certes infiniment plus complexe dans la réalité, car le système nerveux fonctionne comme un tout et les messages subissent de multiples modifications durant leur trajet, convergeant vers des structures d'intégration avant même d'aborder les régions plus particulièrement impliquées dans la construction du langage. Fait fondamental et très singulier, le langage est l'apanage de l'hémisphère gauche chez les droitiers.
L 'examen d'un aphasique, qui est souvent pris pour un dément lorsqu'on ignore la sémiologie de ce trouble, est particulièrement complexe. Il faudra, en effet, tester tout à la fois la compréhension orale, l'expression orale, la compréhension écrite et l'expression écrite.
L'étude de la compréhension orale montre l'existence d'un trouble que l'on qualifie de « surdité verbale ». Tous les degrés peuvent être réalisés. Le plus souvent le sujet comprend les ordres simples, mais échoue dans les ordres complexes.
L'étude de l'expression orale donne des résultats variables. Parfois, le malade présente une réduction considérable de son langage, qui peut aller de la suppression totale de celui-ci à la seule émission de quelques phonèmes indifférenciés. Souvent, l'aphasie se manifeste par un « manque » du mot et son remplacement par un mot déformé ou différent (paraphasie) ou par un mot totalement incompréhensible (jargonophasie). L'épreuve de la dénomination des objets est le test fondamental de l'examen d'un aphasique mettant en évidence un trouble plus ou moins profond de l'évocation des substantifs : l'objet est défini par l'usage. Le mot n'est cependant pas oublié car il peut être évoqué spontanément par le malade lors d'un automatisme verbal. L'existence de cette dissociation automatico-volontaire, ou principe de Baillarger-Jackson, constitue la base même du trouble aphasique.
L'étude du langage écrit recherche l'existence d'une alexie, c'est-à-dire d'un trouble plus ou moins important de la compréhension de l'écriture, la « cécité verbale ». L'examen de l'écriture du malade retrouve les perturbations de la formulation, décelées lors de l'examen oral et qualifiées de dysgraphie ou d'agraphie.
Cet examen permet de classer très schématiquement les aphasies selon deux grands groupes : l'aphasie de Broca, où prédominent les troubles articulatoires et la réduction du langage ; l'aphasie de Wernicke où la compréhension et l'émission du langage sont profondément troublées sans qu'il existe de troubles de la phonation. Ces deux groupes se décomposent eux-mêmes en plusieurs sous-groupes (par exemple, aphasie-amnésie, aphasie de conduction).
Agnosies
Les régions cérébrales impliquées dans l'agnosie sont situées à la frontière des zones de projection spécifiques du cerveau. Elles sont dotées de propriétés d'intégration des informations permettant une confrontation des données nouvelles avec les acquisitions antérieures. Ces régions permettent de comparer ce qui est vu, entendu ou touché à ce qui a été vu, entendu ou touché antérieurement.
Apraxies
La désorganisation du geste en l'absence de troubles moteurs, sensitifs ou cérébelleux définit l'apraxie. Cette désorganisation intéresse plus particulièrement les activités acquises au cours de l'apprentissage pendant l'enfance. Les lésions sont, en règle générale, situées dans les régions pariétales, avec dominance d'un côté ou de l'autre du cerveau selon le type d'apraxie.
L'examen d'un apraxique consiste à faire exécuter par le malade des gestes simples, ou des gestes compliqués comportant plusieurs séquences, à faire mimer certains actes simples ou symboliques, à faire dessiner et, enfin, à examiner comment un sujet parvient à passer un vêtement.
Ces différentes épreuves permettent de mettre en évidence soit une apraxie idéomotrice (geste simple), soit une apraxie idéatoire (geste complexe et séquentiel), soit une apraxie constructive (dessin), soit enfin une apraxie de l'habillage.
Examens généraux
L'examen neurologique d'un malade sera complété par des examens généraux avec :
– une évaluation de l'état des fonctions psychiques et, plus particulièrement, la recherche d'une détérioration intellectuelle, de troubles de la mémoire, de l'attention et de l'affectivité ;
– la recherche de signes d'irritation méningée, qui s'extériorisent par des maux de tête et des vomissements et se traduisent objectivement par des signes physiques : raideur de la nuque et contracture des membres inférieurs, mis en évidence par la recherche des signes de Kernig et de Brudzinski (flexion automatique des membres inférieurs lorsque le malade s'assoit ou lorsqu'on soulève ses membres inférieurs allongés ; toute entrave à cette flexion est douloureuse) ;
– la recherche de troubles neurovégétatifs traduisant une « souffrance » du tronc cérébral ou complétant l'éventail sémiologique, telle que modification de la sudation, de la salivation, de l'horripilation, ou existence d'un signe de Claude Bernard-Horner (myosis, rétrécissement de la fente palpébrale, exophtalmie) ;
– la recherche de perturbations des fonctions endocrines, car les tumeurs hypophysaires retentissent fréquemment sur les formations de la base du cerveau, et en particulier sur le chiasma optique, et les atteintes hypothalamiques déterminent, dans certains cas, un syndrome endocrinien et des troubles du comportement alimentaire ;
– un examen somatique complet.
Les grands syndromes topographiques
Compte tenu de l'organisation anatomique et histologique du système nerveux, on peut décrire un certain nombre de syndromes que nous appellerons topographiques car ils correspondent à des affections des hémisphères cérébraux, du tronc cérébral, du cervelet, de la moelle et enfin des structures périphériques.
Syndromes des hémisphères cérébraux
Les hémisphères cérébraux représentent la partie la plus volumineuse du système nerveux : ils comportent à leur périphérie, au niveau de l'écorce cérébrale, ou cortex, toutes les formations d'où partent et où aboutissent toutes les grandes voies. De plus, à la partie centrale des hémisphères se trouvent des noyaux gris donnant naissance au système extra-pyramidal qui joue un rôle capital dans la régulation du tonus musculaire.
On doit donc distinguer les syndromes hémisphériques corticaux ou cortico-sous-corticaux et les syndromes hémisphériques profonds touchant la région centrobasale des hémisphères où se trouvent les noyaux gris entre lesquels passe la voie pyramidale.
Épilepsies
Il convient de rappeler qu'une lésion des hémisphères cérébraux, et plus particulièrement à l'étage cortical, est susceptible de provoquer, à côté du déficit que produit toute lésion du système nerveux à quelque étage que ce soit, des phénomènes d'excitation, les crises d'épilepsie, qui sont en quelque sorte les différentes manifestations cliniques de la décharge hypersynchrone d'une population neuronique.
Les crises d'épilepsie sont de différents types : les unes, dites crises généralisées, n'ont aucune spécificité quant au siège de la région dont elles expriment la souffrance ; les autres, dites crises focalisées, sont caractérisées par une activité anormale en rapport avec le siège de la lésion qui les provoque. Ces crises focalisées seront décrites avec chacun des différents syndromes.
Les crises généralisées sont d'aspects divers. On peut schématiquement en décrire deux types :
– La crise de « grand mal » débute brutalement par une perte de conscience entraînant une chute brutale en même temps que se déclenche une contracture tonique généralisée qui dure de 10 à 20 secondes ; vient ensuite une phase clonique (faite d'une série d'épisodes de contractions musculaires durant de 20 à 30 secondes) à laquelle succède une phase stertoreuse de résolution musculaire avec relâchement des sphincters.
– La crise de « petit mal » est une « absence » faite d'une dissolution brève de la conscience accompagnée parfois de quelques mouvements myocloniques bilatéraux et synchrones.
Ces deux types de crises s'observent dans la maladie épileptique, ou épilepsie essentielle, qui apparaît dans l'enfance ou à l'adolescence et dont l'origine ne s'explique par aucune cause ni aucune lésion ; mais alors que le petit mal ne s'observe que dans l'épilepsie essentielle, le grand mal peut être symptomatique d'une lésion cérébrale de siège très varié et de n'importe quelle nature ; son apparition, particulièrement à partir de l'âge adulte, doit faire considérer a priori l'épilepsie non plus comme « essentielle », mais comme « symptomatique ».
Les crises focalisées doivent toujours être considérées comme symptomatiques et seront donc décrites avec les différents syndromes topographiques corticaux.
Syndromes cortico-sous-corticaux
Les syndromes cortico-sous-corticaux sont, grossièrement, ceux des aires corticales spécifiques. On peut distinguer les formes suivantes :
Le syndrome prérolandique, ou syndrome frontal postérieur, traduit l'atteinte du centre cortical moteur. Le déficit se manifeste par une hémiplégie controlatérale (qui a les caractères d'une hémiplégie par lésion du faisceau pyramidal) s'accompagnant de contracture, d'exagération des réflexes et d'un signe de Babinski. Sa particularité est d'être habituellement incomplète et non proportionnelle car, le plus souvent, la lésion n'intéresse pas la totalité de la circonvolution frontale ascendante (cortex moteur).
Les crises focalisées de la région motrice sont les crises bravais-jacksoniennes : apparition brusque, parfois après contracture tonique, de mouvements cloniques survenant dans une partie quelconque d'une moitié du corps, y restant localisés ou, au contraire, s'étendant aux segments voisins, ou même à la totalité de l'hémicorps, et durant de quelques secondes à une minute.
Le syndrome postrolandique, ou syndrome pariétal, traduit la souffrance du centre cortical sensitif. Le déficit se traduit par des troubles sensitifs de l'hémicorps controlatéral, peu importants pour les sensibilités superficielles, plus importants pour la sensibilité profonde, le fait prédominant étant, de toute façon, une perturbation du sens stéréognosique.
Les crises focalisées sensitives se manifestent par des fourmillements, des paresthésies, des sensations de « courant électrique », qui, débutant dans un segment de l'hémicorps, y restent localisées ou s'étendent à la totalité de l'hémicorps.
Le syndrome occipital traduit l'atteinte du centre cortical visuel, par une hémianopsie controlatérale, c'est-à-dire une perte bilatérale de la moitié du champ visuel du côté opposé à celui de la lésion. Les crises focalisées occipitales sont caractérisées par l'apparition brusque de phénomènes visuels, qui peuvent être élémentaires, à type de phosphènes, ou plus élaborés, consistant en la vision d'une forme, d'un visage, d'un paysage ou même d'une véritable scène.
Les lésions du lobe frontal n'entraînent de perturbations qu'à la condition d'être bilatérales ou, tout au moins, qu'existe un dysfonctionnement bilatéral. Ce sont alors des perturbations complexes que l'on peut définir, d'une manière générale, comme des troubles du comportement dont le support est un état d'indifférence béate.
L'absence de centres primaires dans cette région explique que les crises focalisées n'y ont pas de caractères particuliers possédant une valeur localisatrice indiscutable, en dehors des crises provoquées par l'irritation d'une région limitée, située sur la face interne du lobe frontal : l'aire motrice supplémentaire de Penfield.
Les atteintes du lobe temporal sont totalement différentes selon qu'il s'agit de l'hémisphère droit ou de l'hémisphère gauche. Chez les droitiers, alors que le déficit du lobe temporal droit n'a pas d'expression neurologique, celui du lobe temporal gauche s'exprime essentiellement par une défaillance du langage, c'est-à-dire par un syndrome d'aphasie.
Les crises temporales, qui s'observent aussi bien à droite qu'à gauche, sont les plus élaborées des crises focalisées. Elles peuvent se traduire par plusieurs types de manifestations : hallucinations sensorielles simples ou complexes (visuelles, auditives ou olfactives) ; perturbations du champ de la conscience et de l'affectivité à type d'état de rêve, d'illusion, de remémoration, de déjà vu, de pensée forcée s'accompagnant d'une tonalité affective d'étrangeté, d'angoisse, de bonheur ineffable ; activités automatiques inconscientes soit simples, avec mastication, déglutition ou rotation de la tête, soit complexes, avec activité gestuelle coordonnée mais dénuée de motivation ; troubles végétatifs paroxystiques avec pâleur et salivation.
Ces crises peuvent résulter soit d'une lésion superficielle proprement temporale, soit d'une atteinte plus profonde, rhinencéphalique.
La région centrobasale du cerveau commune aux deux hémisphères est formée d'éléments anatomiques différents les uns des autres : des formations commissurales unissant les deux hémisphères, des cavités liquidiennes, des noyaux de substance grise, des faisceaux blancs allant du cortex cérébral au tronc cérébral.
Sur le plan de la physiopathologie, on peut distinguer plusieurs variétés de syndromes de cette région.
La capsule interne située entre les noyaux gris est formée essentiellement des fibres du faisceau pyramidal. Sa lésion entraîne une hémiplégie controlatérale avec contracture, exagération des réflexes et signe de Babinski, dont la particularité est qu'elle est habituellement totale, complète et proportionnelle.
Le thalamus, ou couche optique, est un volumineux noyau gris dont le rôle physiologique est considérable, car, s'il est le relais des voies spécifiques somesthésiques, il joue également un rôle important en tant que formation non spécifique. En effet, il réalise la synthèse des différentes informations par ses structures « associatives » et exerce une influence sur la totalité du cortex par son « système thalamique diffus ».
Malgré cette importance physiologique particulière, le thalamus s'exprime relativement peu en pathologie neurologique. Le syndrome le mieux défini est le syndrome sensitif de Déjerine-Roussy, qui entraîne dans l'hémicorps controlatéral des troubles sensitifs à type d'anesthésie, prédominant sur la sensibilité profonde, une discrète hémiparésie et, surtout, une hyperpathie avec des douleurs souvent intolérables, à la suite d'excitations discrètes qui ne seraient pas douloureuses pour le sujet normal.
Plus rarement, les lésions de cette structure entraînent des syndromes démentiels par lésions bilatérales des noyaux associatifs, des aphasies avec modification de la fluence verbale.
Les noyaux striés (noyau caudé et noyau lenticulaire) forment, avec le thalamus et avec d'autres formations grises plus bas situées (le corps de Luys et le locus niger), un ensemble qui constitue le système extrapyramidal dont le rôle est essentiel dans la régulation du tonus et de la motricité.
Le syndrome des noyaux gris se manifeste par des troubles du tonus, à type d'hypertonie ou de dystonie, des mouvements anormaux de type choréique ou athétosique, un tremblement, de l' akinésie consistant en une rareté des mouvements.
L’ hypothalamus constitue un centre d'intégration important, contrôlant à la fois les fonctions neurovégétatives (rythme cardiaque et respiratoire, tension artérielle, fonction digestive, coordination des facteurs de lutte contre la chaleur et le froid), des fonctions endocriniennes soit par l'intermédiaire des releasing factors (qui contrôlent l'activité endocrinienne du lobe antérieur de l' hypophyse), soit directement par sécrétion des hormones antidiurétiques qui sont accumulées dans le lobe postérieur de l'hypophyse, des fonctions comportementales et mnésiques (corps mamillaires), en liaison étroite avec le cerveau limbique ou rhinencéphale, et enfin des fonctions métaboliques des glucides et des lipides.
Syndromes du tronc cérébral
Le tronc cérébral qui unit le cerveau à la moelle est formé de trois parties : le pédoncule cérébral, la protubérance annulaire et le bulbe. Le tronc cérébral est une formation complexe : c'est d'abord le lieu de passage des grandes voies ascendantes ou descendantes allant du cerveau à la moelle ; c'est également le lieu d'émergence de nerfs crâniens moteurs et sensitifs ; c'est enfin le siège de formations qui, si elles n'ont pas le caractère de relais d'une voie spécifique déterminée, jouent, par leurs multiples connexions avec les différents systèmes spécifiques, le rôle de régulateurs. Il en est ainsi spécialement de la substance réticulaire qui règle les fonctions fondamentales, vigilance, motricité, sensibilité, fonctions végétatives.
Les lésions du tronc cérébral entraînent des tableaux très différents selon qu'elles sont bien limitées en hauteur et en largeur ou que, au contraire, elles sont diffuses ; d'où la distinction entre syndromes focalisés et syndromes diffus. Lorsque les lésions atteignent les centres végétatifs bulbaires et la formation réticulée, elles entraînent l'apparition de signes de haute gravité.
Les syndromes focalisés du tronc cérébral sont caractérisés par une association avec l'atteinte d'une ou de plusieurs des grandes voies sensitives ou motrices, d'une paralysie d'un ou de plusieurs des nerfs crâniens. Celle-ci, outre qu'elle permet de localiser la lésion au tronc cérébral, en fixe le niveau en hauteur : la paralysie du III correspond à une lésion pédonculaire ; la paralysie du VI, du VII, à une lésion protubérantielle ; la paralysie des nerfs mixtes (IX, X, XI) et du XII, à une lésion bulbaire.
Les syndromes diffus du tronc cérébral consistent en une atteinte plus ou moins complète de noyaux des nerfs crâniens qui peut être isolée, associée à l'atteinte d'une ou de plusieurs des grandes voies, ou encore associée à des lésions diffuses d'encéphalomyélite.
Les syndromes graves du tronc cérébral sont dus à des lésions qui entraînent soit des troubles des fonctions végétatives (respiratoires, cardiaques, tensionnels), et ce sont essentiellement des formes bulbaires bilatérales, soit des troubles de conscience avec modifications du tonus dont la forme la plus typique est le coma avec rigidité de décérébration.
Syndrome cérébelleux
Le cervelet, situé en arrière du tronc cérébral, est en quelque sorte séparé et isolé de l'ensemble du système nerveux central, auquel il est relié uniquement par trois paires de pédoncules, les pédoncules cérébelleux supérieurs, moyens et inférieurs, qui l'unissent aux trois parties du tronc cérébral. Son rôle consiste essentiellement dans la régulation du tonus et du mouvement. Le syndrome cérébelleux est fait de troubles du tonus et de troubles de la coordination des mouvements. Le trouble du tonus consiste en une hypotonie, dont l'élément le plus important est l'exagération de la passivité, c'est-à-dire l'accentuation du mouvement imprimé par la mobilisation passive. Le trouble de la coordination du mouvement est fait de divers éléments : retard dans la vitesse d'exécution du mouvement (dyschronométrie) ; exagération de l'amplitude du mouvement qui dépasse le but (hypermétrie) ; impossibilité de coordonner harmonieusement les différentes phases élémentaires de l'accomplissement d'un geste (asynergie).
Ces trois éléments primordiaux rendent compte de l'impossibilité d'exécuter vite des mouvements alternatifs (adiadococinésie) et de l'apparition dans l'exécution d'un geste d'un tremblement d'amplitude plus ou moins importante (tremblement intentionnel).
L'ensemble des éléments du syndrome cérébelleux entraîne une perturbation importante dans l'exécution de tous les mouvements et de tous les gestes. La simple station debout est gênée et la marche est très perturbée.
À vrai dire, le syndrome cérébelleux n'est total et complet que dans les lésions diffuses de tout le cervelet. Lorsqu'une lésion prédomine sur la région médiane du cervelet, le vermis, le syndrome est essentiellement statique et se manifeste par des troubles de la marche et de la station debout ; lorsque la lésion touche un seul hémisphère cérébelleux, le syndrome est surtout cinétique, unilatéral et homolatéral par rapport à la lésion.
Syndromes médullaires
Située dans le canal rachidien, la moelle épinière qui fait suite au tronc cérébral conduit les voies nerveuses sur toute la hauteur du rachis et permet ainsi, à chaque étage de ce canal, la diffusion vers la périphérie des messages du système nerveux et, de la même manière, l'apport au système nerveux des informations périphériques. Elle assure donc à la fois le passage des grandes voies sensitives et motrices et l'émergence du système nerveux périphérique.
Une lésion médullaire peut atteindre en totalité la largeur de la moelle, quelle que soit son étendue en hauteur, ou, au contraire, être localisée à un secteur déterminé de celle-ci.
– Le syndrome médullaire total associe deux composantes : un syndrome central qui traduit la « souffrance » de toutes les voies qui traversent la moelle et intéresse toute la portion du corps située au-dessous de la lésion. Ce syndrome sous-lésionnel est fait de paralysies avec contracture, exagération des réflexes, réflexes de défense, signe de Babinski, troubles sphinctériens et troubles sensitifs ; un syndrome périphérique qui traduit le dysfonctionnement des neurones périphériques intra- et extra-médullaires au niveau de la lésion. Ce syndrome est lésionnel, avec paralysie flasque, abolition des réflexes, atrophie musculaire et troubles sensitifs en bandes radiculaires. Dans la majorité des cas, ce syndrome est très réduit. Il n'est que peu ou pas extériorisable, et ses deux éléments les plus importants sont la douleur, dans le cas d'une irritation radiculaire, et l'abolition d'un réflexe ostéotendineux, lorsque la lésion est située dans le territoire correspondant.
– Le syndrome hémimédullaire, ou syndrome de Brown-Séquard, se traduit par un syndrome sous-lésionnel, très caractéristique du fait du caractère direct ou croisé des voies intramédullaires. Du côté de la lésion existent un déficit moteur et des troubles de la sensibilité profonde ; du côté opposé, des troubles de la sensibilité superficielle, thermique et douloureuse.
– Le syndrome centromédullaire exprime l'atteinte, sur une hauteur plus ou moins étendue de la moelle, de la substance grise ainsi que des fibres sensitives qui traversent la commissure grise pour aller former le faisceau spino-thalamique. Cette double atteinte donne un territoire pathologique « suspendu », c'est-à-dire nettement segmentaire : paralysie flasque (avec abolition des réflexes et atrophie musculaire) et trouble sensitif dissocié (atteinte de la sensibilité thermique et douloureuse avec conservation de la sensibilité profonde et de la sensibilité tactile discriminative).
Syndromes périphériques
Le système nerveux périphérique est formé de tout le réseau des nerfs se ramifiant dans la totalité du corps, amenant, d'une part, à la moelle et au tronc cérébral, les informations recueillies à la périphérie, et, d'autre part, conduisant, du tronc cérébral et de la moelle jusqu'aux muscles, les messages envoyés du cortex par le faisceau pyramidal et modulés par les différents systèmes extra-pyramidaux.
Les syndromes périphériques, quels que soient leur niveau, leur territoire et leur étendue, sont faits de trois éléments plus ou moins également importants et situés dans le même territoire : une paralysie avec hypotonie, abolition des réflexes, atrophie musculaire et troubles des réactions électriques ; des troubles sensitifs associant souvent à un déficit allant de l'hypoesthésie à l'anesthésie complète un élément irritatif sous forme de douleurs ; des troubles trophiques touchant souvent, outre le plan musculaire, le plan cutané et les phanères.
Possédant ces mêmes caractères communs, les syndromes des différentes portions du système nerveux périphérique sont caractérisés par leur topographie.
– Les syndromes radiculaires s'individualisent par des anomalies segmentaires siégeant au niveau de territoires cutanés ou musculaires correspondant aux métamères médullaires. Ils peuvent être : monoradiculaires, comme la sciatique par hernie discale ; pauciradiculaires, par lésion (généralement compressive) touchant plusieurs racines situées au voisinage les unes des autres ; ou pluriradiculaires, comme pour le syndrome de la queue-de-cheval dans lequel les racines, rassemblées, peuvent être lésées par un processus commun. Dans ce syndrome de la queue-de-cheval, les troubles sensitifs prédominent souvent sur les racines sacrées et donnent une anesthésie caractéristique par sa topographie : l'anesthésie en selle ; les troubles sphinctériens sont fréquemment très importants.
Enfin, il existe un syndrome radiculaire diffus que l'on nomme « polyradiculonévrite » ; au syndrome clinique s'associe une dissociation albumino-cytologique qui est précoce, importante et prolongée.
– Les syndromes de neuropathies périphériques désignent les syndromes périphériques extra-rachidiens diffus, et, d'une façon conventionnelle, on appelle « polynévrites » les neuropathies qui touchent d'une façon symétrique des fibres nerveuses destinées à des muscles fonctionnellement synergiques, et « multinévrites » celles qui sont caractérisées par l'atteinte d'une série de syndromes tronculaires habituellement bilatéraux mais non symétriques et sans synchronisme fonctionnel.
– Les syndromes de paralysies tronculaires (ou nerveuses) sont caractérisés chacun par l'atteinte de territoires moteurs et sensitifs innervés par le tronc nerveux ou par l'une de ses branches périphériques.
Bien que ne relevant pas d'une lésion du système nerveux central ou périphérique, il convient de mentionner ici que, dans certaines maladies du muscle, la diminution de la force ou l'impotence fonctionnelle oriente souvent vers une affection neurologique. En fait, ces maladies peuvent affecter soit la jonction neuromusculaire, et ce sera le cas de la myasthénie, soit la structure musculaire elle-même, et ce sera le cas des myopathieset des myosites (cf. muscles).
Les examens complémentaires
L'examen clinique achevé, la localisation lésionnelle déterminée, le neurologue prescrira des examens paracliniques qui étayeront le diagnostic et préciseront l'étiologie. Ces examens sont multiples et dépendent naturellement de l'orientation clinique.
Examen ophtalmologique
L'examen ophtalmologique, partiellement pratiqué par le neurologue, demande à être toujours complété et précisé par l'ophtalmologiste.
Étude du champ visuel
Les voies visuelles, qui naissent au niveau de la rétine, se groupent pour former le nerf optique qui rejoint celui du côté opposé au niveau du chiasma optique. Ces fibres poursuivent ensuite leur trajet, constituant les bandelettes optiques qui, après un relais à la partie postérieure du tronc cérébral, se projettent sur les régions occipitales internes (scissures calcarines). L'étude du champ visuel est d'une importance décisive pour situer éventuellement une lésion, car les fibres provenant des champs rétiniens temporal, nasal et maculaire ont une répartition topographique particulière selon le niveau de leur trajet.
Certes, le neurologue peut déceler au doigt une modification du champ visuel, mais c'est surtout le spécialiste, en utilisant en particulier le campimètre de Goldman, qui pourra cerner finement les contours de l'amputation visuelle. Il pourra ainsi mettre en évidence soit un scotome (amputation centrale ou paracentrale du champ visuel), soit une atteinte de la totalité du champ visuel d'un œil, soit une hémianopsie bitemporale (atteinte du champ visuel temporal de chaque œil, indiquant une lésion chiasmatique), soit une hémianopsie latérale homonyme (atteinte du champ temporal d'un œil et du champ nasal de l'autre, révélant une lésion de la bandelette ou du lobe occipital opposé).
Étude du fond d'œil
En utilisant un ophtalmoscope, il est possible d'explorer visuellement la rétine et, entre autres, l'émergence du nerf optique et les vaisseaux rétiniens. L'œil joue pour le neurologue le rôle d'un véritable hublot qui permet de recueillir certaines informations utiles au diagnostic d'une lésion nerveuse. C'est ainsi qu'on pourra déceler une stase papillaire traduisant, par exemple, une hypertension intracrânienne, une atrophie optique par lésion du nerf, une modification de la pression de l'artère ophtalmique, reflet de la circulation dans le territoire de la carotide interne.
Étude de la motricité oculaire et de l'acuité visuelle
L'examen fait par le neurologue sera complété, en particulier, en utilisant le coordimètre de Lancaster qui précisera une atteinte des nerfs moteurs oculaires. Un examen en chambre noire appréciera l'état de la motilité intrinsèque de la pupille. L'ophtalmologiste pourra également déceler l'origine d'une baisse de l'acuité visuelle et la rapporter éventuellement à une origine neurologique.
Examen otoneurologique
Le spécialiste apportera également une aide précieuse au neurologue en précisant l'existence et le niveau d'une surdité (examen audiométrique), l'existence et le niveau d'une atteinte des voies vestibulaires (étude de leur réflectivité par stimulation calorique ou rotatoire).
Cet examen de spécialité fournira également des précisions sur les modifications d'origine nerveuse de régions non accessibles au neurologue, comme le larynx. Il pourra enfin interroger très finement la fonction olfactive et distinguer une anosmie d'origine locale d'une anosmie d'origine nerveuse.
Examen radiographique
Examen du crâne
L' examen standard comporte des clichés de face et de profil qui pourront mettre en évidence des lésions osseuses au niveau de la base du crâne ou de la voûte, et l'existence éventuelle de calcifications intracrâniennes. Ce premier examen pourra être complété par des incidences spéciales étudiant plus particulièrement les différents os de la base du crâne et les orifices de sortie ou d'entrée des différents nerfs crâniens. Des tomographies réalisant de véritables coupes sériées radiologiques des structures osseuses compléteront des investigations radiologiques sans préparation.
Examen de la colonne vertébrale
L' examen radiologique du rachis recherche sur les clichés de face, de profil et de trois quarts l'existence d'une éventuelle lésion osseuse au niveau de la région déterminée par l'examen neurologique. Ils seront donc centrés sur les segments cervical, dorsal ou lombaire de la colonne vertébrale. Certaines incidences spéciales seront demandées en cas de lésion située au niveau des deux premières vertèbres cervicales, atlas et axis. Ces radiographies, complétées éventuellement par des tomographies, rechercheront des lésions destructives ou constructives au niveau des corps, des lames et des pédicules vertébraux. Elles pourront également mettre en évidence le pincement d'un disque intervertébral, l'élargissement d'un trou de conjugaison ou la modification des courbures rachidiennes.
La tomodensitométrie
Depuis les années 1980, le diagnostic des affections neurologiques a été considérablement facilité par l'introduction d'une technique atraumatique d'explorations cérébrales, résultat des travaux de Hounsfield et Ambrose, qui permet la visualisation des tissus en fonction de leur densité et de leur coefficient d'absorption au rayonnement X. Cette technique de tomodensitométrie est valable pour l'exploration de l'ensemble du corps humain ; elle occupe dans les disciplines neurologiques une place de choix et a fait pratiquement disparaître des techniques souvent traumatisantes comme la pneumoencéphalographie et la ventriculographie. Elle permet d'obtenir, à partir de signaux électriques fonction eux-mêmes des modulations d'intensité du rayonnement X après la traversée du crâne, une image reconstituée de la plupart des atteintes pathologiques dont la densité est différente de celle du parenchyme cérébral sain (fig. 2). L'appareillage permet de faire de véritables coupes le plus souvent axiales de 10 mm et éventuellement des coupes frontales. L'examen est pratiqué en règle générale avant et après injection d'un produit de contraste qui permet d'accentuer dans certains cas le coefficient d'absorption du rayonnement X au niveau du site pathologique.
Les processus expansifs sont détectés par cette technique qui permet d'une part la visualisation du processus lui-même, et d'autre part l'existence d'un éventuel effet de masse qui déplace les cavités ventriculaires. Les processus pathologiques donnent des résultats différents selon leur nature sans que l'image soit toujours spécifique. Parmi les tumeurs, l'astrocytome donne une image d'hypodensité, le glioblastome une image hétérogène qui est accentuée par le produit de contraste, le méningiome une image homogène de densité élevée fortement amplifiée par le produit de contraste les métastases des images hypo- ou hyperdenses. Les tumeurs s'accompagnent fréquemment d'une réaction œdémateuse de voisinage visible sur les coupes tomodensitométriques. Les processus d'origine vasculaire sont également décelés : les ischémies fournissent une image d'hypodensité, au niveau du territoire vasculaire mal irrigué, alors que les hémorragies se caractérisent par une image d'hyperdensité en dehors de toute préparation. Cette différenciation morphologique est importante, quand on sait que, cliniquement, le diagnostic entre ramollissement et hémorragie cérébrale est souvent difficile. Les hémorragies méningées sont décelées par des aspects d'hyperdensité spontanée, à la convexité cérébrale, au niveau des citernes, éventuellement dans les ventricules. Les malformations vasculaires (angiomes et anévrismes) peuvent être également visualisées après injection d'un produit de contraste. Les processus d'origine traumatique sont également identifiables : l'hématome extra-dural provoque une image d'hyperdensité homogène le plus souvent biconvexe et un déplacement des cavités ventriculaires ; l'hématome sous-dural est visualisé généralement par une image en forme de demi-lune. Enfin, d'autres processus pathologiques sont également visibles, en particulier les hydrocéphalies, qui entraînent une dilatation importante et symétrique du système ventriculaire, et les atrophies, qui déterminent une visibilité anormale des sillons corticaux et des citernes. Citons encore la visualisation possible des hémangioblastomes qui déterminent une image kystique hypodense avec, souvent, un nodule dural qui prend le contraste, et, dans le domaine des affections inflammatoires du système nerveux, la sclérose multiloculaire dont les plaques apparaissent le plus souvent dans les régions périventriculaires. La tomodensitométrie est également utilisée dans le diagnostic des affections rachidiennes (hernie discale, tumeur médullaire, tumeur d'origine osseuse, syringomyélie, etc.). En définitive, la tomodensitométrie contribue de façon importante au diagnostic de la plupart des processus pathologiques qui affectent le système nerveux.
Les imageries IRM et PET
Indispensables à l'étude fonctionnelle des structures cérébrales, elles ont transformé le diagnostic et le suivi clinique des encéphalopathies. Leur description et leurs indications sont étudiées dans l'article cerveau humain.
Les examens électrophysiologiques
L' éventail des examens électrophysiologiques est assez étendu puisqu'il comprend l'enregistrement des activités spontanées du cerveau, c'est-à-dire l'électro-encéphalogramme (E.E.G.), l'enregistrement des activités provoquées (potentiels évoqués) et celui des activités des voies nerveuses périphériques et des muscles (électrodiagnostic).
L'E.E.G. consiste à recueillir sur le cuir chevelu des variations du potentiel du tissu cérébral qui, convenablement amplifiées, sont inscrites sur une bande d'enregistrement qui se déroule à une vitesse constante.
Cet examen, qui s'adresse aux différentes régions du cerveau et est entré depuis une quarantaine d'années dans la pratique courante, peut physiologiquement recueillir plusieurs types de rythmes, classés selon leur fréquence et leur amplitude : le rythme alpha, de 8 à 12 c/s, ayant un aspect en fuseau et à dominance postérieure, constitue l'activité électrique physiologique ; il est interrompu par l'ouverture des yeux (réaction d'arrêt) ; plus accessoirement, le rythme bêta, de fréquence supérieure à 14 c/s (rythme d'éveil attentif), et le rythme thêta, de fréquence de 4 à 7 c/s, parfois visible de façon symétrique sur les régions temporales ; leur abondance est très variable d'un sujet à l'autre. Sur le plan pathologique, le tracé présente des aspects très variés, qui sont considérés en fonction de leur morphologie et de leur répartition : selon leur morphologie, les ondes anormales peuvent s'exprimer soit par un ralentissement de rythme (rythme delta, de l à 3 c/s), soit par une accélération de fréquence et d'amplitude, telles les altérations de type épileptique ; selon leur répartition, ces ondes peuvent soit être diffuses, dans le cas d'un état de souffrance cérébrale, soit n'affecter qu'un seul hémisphère, soit enfin être focalisées à une partie de celui-ci. L'apparition de ces anomalies peut être favorisée par l'hyperpnée, la stimulation lumineuse intermittente et le sommeil. Dans la majorité des cas, l'E.E.G. ne constitue qu'une première étape d'orientation diagnostique et sa négativité ne saurait être synonyme d'intégrité de la fonction cérébrale dans certains cas d'enregistrements de longue durée de l'activité cérébrale, les méthodes informatiques peuvent être utilisées pour établir des spectres de fréquence et d'énergie. Il est également possible de pratiquer certains enregistrements par télémesure.
L' enregistrement des potentiels évoqués, utilisé actuellement en clinique humaine, est une technique qui dérive de la neurophysiologie expérimentale. Elle consiste à recueillir au niveau des aires spécifiques du cortex cérébral les signaux provoqués par la stimulation d'un nerf sensitif ou d'un récepteur sensoriel (visuel ou acoustique). Cette technique, qui nécessite l'utilisation d'ordinateurs numériques afin d'extraire ces signaux du « bruit de fond » de l'E.E.G., peut rendre certains services dans le diagnostic neurologique, en fournissant des informations sur l'état des voies sensitivo-sensorielles. Le potentiel évoqué recueilli est analysé dans sa latence par rapport à la stimulation, dans l'aspect des différentes ondes qui le composent et dans leur dispersion. Qu'il s'agisse de potentiels évoqués visuels, acoustiques, ou somesthésiques, ils doivent fournir au neurologue une donnée intéressante sur la localisation d'une lésion et parfois accréditer un diagnostic étiologique, insuffisamment étayé, comme dans la sclérose en plaques (potentiels évoqués visuels et du tronc cérébral). Quant aux potentiels évoqués du tronc cérébral, qui sont le reflet le plus souvent d'une activation des différents relais auditifs du tronc cérébral, ils demandent un appareillage assez sophistiqué et peuvent apporter certaines contributions au diagnostic d'affections inflammatoires comme la sclérose en plaques, hérédo-dégénératives, ou dans certaines tumeurs de la fosse postérieure.
Signalons que l'activité spontanée et provoquée des neurones cérébraux peut également être recueillie de façon plus exceptionnelle en chirurgie stéréotaxique. Celle-ci permet d'introduire dans le tissu cérébral des électrodes à la fois réceptrices et stimulatrices, qui sont dirigées vers une structure donnée en fonction de coordonnées qui permettent une véritable « navigation » à l'intérieur du cerveau. L'intérêt de l'électrophysiologie dans cette discipline peut permettre un repérage plus précis d'une structure, comme dans la chirurgie de l'épilepsie ; et de certains mouvements anormaux, ou de stimuler, comme dans certains traitements exceptionnels de la douleur chronique.
Les méthodes d'électrodiagnostic sont appliquées à l'exploration du système nerveux périphérique, c'est-à-dire, d'une part, des fibres motrices issues des motoneurones alpha de la moelle, de la jonction neuromusculaire, et des muscles, et, d'autre part, des fibres sensitives ainsi que des réflexes médullaires. Le système neuromusculaire est exploré par deux méthodes, qui sont susceptibles d'être combinées : les électrodiagnostics de détection et de stimulation. L'un recueille par une électrode coaxiale l'activité de repos et de contraction du muscle, l'autre stimule le nerf moteur par un courant bref, dont on peut faire varier la durée et l'intensité, et observe la contraction musculaire qui en résulte. Cette technique apporte au neurologue un élément d'information sur l'existence ou non d'une atteinte du système nerveux périphérique et sur le niveau de cette atteinte (motoneurone alpha, fibres motrices, jonction neuromusculaire, ou muscles).
Signalons également, toujours dans le domaine de l'électrophysiologie, la possibilité de mesurer les vitesses de conduction des fibres sensitives et motrices, et de tester l'activité électrique des réflexes tendineux (réflexe H, ou d'Hoffmann).
Les examens neuro-isotopiques
Ces examens s'adressent aux différents compartiments du système nerveux, tissulaire, liquidien et vasculaire.
Le compartiment tissulaire est exploré par une molécule marquée au 99m technetium, injectée par voie intraveineuse. La radioactivité cérébrale est recueillie par une gamma-caméra (fig. 3). Cette méthode permet l'exploration du tissu cérébral sous deux formes différentes, statique ou dynamique : statique (scintigraphie), réalisant en quelque sorte la « photographie » de la radioactivité cérébrale de 2 à 5 heures après injection du radiotraceur ; dynamique (angioscintigraphie), fondée sur l'étude séquentielle du radio-isotope durant les 60 premières secondes qui suivent son injection, le traitement de l'information étant effectué par un ordinateur. Les résultats obtenus sont également de deux types : a) selon la répartition spatiale de la radioactivité, permettant de faire le diagnostic d'hématome sous-dural lorsque le foyer d'hyperactivité épouse la convexité hémisphérique, de métastase lorsque existent plusieurs foyers, de ramollissement cérébral lorsque l'hyperactivité épouse un territoire vasculaire ; b) selon l'évolution temporelle de la radioactivité, permettant de faire le diagnostic de glioblastome, tumeur maligne primitive, lorsque l'étude angioscintigraphique montre une fixation tardive hétérogène et qui augmente avec le temps, ou celui de méningiome, tumeur bénigne, devant une apparition précoce du foyer d'hyperfixation du radiotraceur. La fiabilité de cet examen sur le plan morphologique est inférieure à celle du tomodensitome (scanner), cependant il permet souvent d'affiner le diagnostic étiologique du processus pathologique en cause.
Le compartiment liquidien est exploré par l'incorporation au liquide céphalo-rachidien (L.C.R.), soit par voie lombaire, soit par voie sous-occipitale, plus rarement par voie intraventriculaire, d'une molécule isotopique qui permet de suivre le transit du L.C.R. depuis son point d'injection jusqu'aux aires de résorption (fig. 4), c'est-à-dire au niveau de la convexité du cerveau (granulations de Pacchioni). Cette exploration est particulièrement utilisée, d'une part dans le diagnostic de l'hydrocéphalie à pression normale, où elle montre un reflux ventriculaire à contre-courant et surtout un retard considérable de la résorption du L.C.R. au niveau de la convexité hémisphérique et, d'autre part, dans la recherche de fistules ostéoméningées entraînant l'écoulement (le plus fréquemment dans les fosses nasales) de L.C.R.
Le compartiment vasculaire étudie la morphologie des vaisseaux à destinée cérébrale immédiatement après injection intraveineuse du radiotraceur. Comme pour l'effet Doppler, cette technique, qui permet d'objectiver des thromboses et des sténoses, n'a de valeur que lorsqu'elle est positive, un examen négatif ne devant pas faire différer des études plus approfondies. En complément de ces indications, l'angioscintigraphie permet de déceler des malformations vasculaires cérébrales (angiomes), qui présentent une cinétique tout à fait caractéristique.
La mesure du débit sanguin cérébral par les radio-isotopes occupe une place particulière. C'est à la fois une technique vasculaire et une technique tissulaire, puisqu'elle s'adresse à la circulation à l'échelon cellulaire cérébral. Technique assez récente, et actuellement totalement atraumatique, elle est fondée sur la mesure de la clairance cérébrale au 133 xénon. Elle permet d'obtenir une véritable cartographie vasculaire du cerveau, qui est particulièrement indiquée dans les accidents vasculaires cérébraux, pour connaître les possibilités d'intervention chirurgicale ou pour évaluer l'efficacité éventuelle des vasodilatateurs. Elle est également utilisée dans l'étude du retentissement vasculaire des hémorragies méningées, afin de déceler un éventuel spasme en aval de l'anévrisme qui conditionne l'acte opératoire, dans le diagnostic des hydrocéphalies à pression normale, pour les différencier des hydrocéphalies par démences séniles et préséniles. Enfin, elle rend possibles certaines études neuropsychologiques sur les fonctions cérébrales, sur le langage en particulier, sur la latéralisation hémisphérique, et sur certaines affections psychiatriques.
Examen du liquide céphalo-rachidien
Le liquide céphalo-rachidien (L.C.R.), sécrété par les plexus choroïdes situés dans les ventricules cérébraux, baigne les cavités ventriculaires et les espaces sous-arachnoïdiens qui gainent le cerveau et la moelle. Ce liquide se résorbe essentiellement au niveau de la convexité des hémisphères cérébraux.
Recueilli le plus souvent par ponction au niveau de la région lombaire basse, étant donné l'absence de moelle épinière à ce niveau, ce liquide, normalement incolore et limpide, peut être l'objet de nombreux examens de laboratoire : études cytologique, biochimique (dosage de l'albumine, du chlorure de sodium, du glucose), bactériologique. On peut également pratiquer des réactions humorales : benjoin colloïdal, réaction de Bordet-Wassermann, test de Nelson, bilan immuno-électrophorétique.
Les résultats ainsi obtenus peuvent témoigner d'une hémorragie, d'une infection (à pyogènes, à bacille de Koch, à virus), d'un blocage du transit du liquide au niveau de la moelle (dissociation entre une albuminorachie élevée et un taux d'éléments normal : liquide xanthochromique), d'une réaction immunologique anormale comme une augmentation des gamma-globulines (sclérose en plaques), de l'existence d'une syphilis cérébrale (B. W. et test de Nelson), enfin de la présence de cellules anormales, témoins de l'évolution d'une tumeur maligne.
L'existence d'un obstacle sur les voies de transit du L.C.R. peut également être détectée en évaluant la pression de ce liquide et ses modifications durant la compression des veines jugulaires (épreuve de Queckenstedt-Stookey).
Les examens de contraste
L' injection d'air ou de substance opaque aux rayons X peuvent apporter au neurologue ou au neurochirurgien des informations fondamentales dans l'élaboration de leurs diagnostics et éventuellement de leur tactique opératoire. Les explorations utilisant un contraste gazeux, pneumoencéphalographique ou ventriculographique ont pratiquement disparu de l'éventail des investigations neuro-radiologiques, avantageusement remplacées par la tomodensitométrie. Seule la myélographie gazeuse par injection d'air dans les cavités périmédullaires, qui permet d'effectuer par tomographie une étude fine des rapports de la moelle avec le canal rachidien et de la morphologie de celle-ci, est encore indiquée dans certains cas. Les explorations fondées sur l'injection d'un produit de contraste opaque aux rayons X gardent au contraire une place de choix. Elles ont pour but d'opacifier soit les régions périmédullaires ou ventriculaires, soit le système artériel. L'étude des régions périmédullaires et de la queue-de-cheval, qui était autrefois fondée sur l'opacification par le radiolipiodol, a recours actuellement à des substances hydrosolubles. Injectées par voie lombaire ou sous-occipitale, ces substances permettent de mouler la moelle, de déceler un éventuel obstacle extra- ou intramédullaire ou une compression d'une ou de plusieurs racines de la queue-de-cheval. Cet examen peut également être couplé avec une étude tomodensitométrique. Lorsqu'elles sont injectées par voie ventriculaire, les substances de contraste permettent notamment de rechercher un obstacle au niveau des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien, lorsque les résultats de l'étude tomodensitométrique ne sont pas décisifs.
Les explorations vasculaires occupent une place considérable dans les examens paracliniques de la neurologie. Elles consistent en l'injection d'une substance opaque dans la lumière d'un vaisseau et en la prise de clichés radiologiques en série permettant l'étude de la morphologie des artères, des artérioles et des veines, et de leurs éventuels déplacements. Elles s'adressent soit aux vaisseaux cérébraux, soit aux vaisseaux médullaires. L' angiographie cérébrale (fig. 5) est effectuée soit au niveau des artères carotides internes, qui irriguent la presque totalité des hémisphères cérébraux, soit au niveau des artères vertébrales, qui alimentent le tronc cérébral, le cervelet et la partie postérieure des hémisphères. L'opacification de ces vaisseaux permet d'étudier plusieurs facteurs : la perméabilité des vaisseaux, détectant le rétrécissement ou l'obstruction de la lumière artérielle d'une artère principale (infarctus cérébral), leur déplacement par un processus expansif, tumoral, infectieux ou hémorragique, et l'existence d'une éventuelle malformation vasculaire (angiome ou anévrisme). L'utilisation de sondes intravasculaires permet actuellement de pratiquer des angiographies plus sélectives dans un territoire donné. L'angiographie médullaire permet de visualiser radiologiquement les différentes artères de la moelle après cathétérisme de leur origine par voie aortique et injection d'une substance opaque aux rayons X. Son apport est actuellement fondamental dans le diagnostic et les indications chirurgicales des angiomes de la moelle. Cette méthode a largement bénéficié des techniques électroniques de soustraction osseuse.
L'échoscopie ultrasonore
Ce type d'exploration est fondé sur l'effet Doppler qui peut être défini ainsi : une onde ultrasonore se réfléchissant sur des particules entraînées par un liquide en mouvement subit une variation de fréquence proportionnelle à la propagation de la vitesse du réflecteur. Au niveau d'un vaisseau, le liquide en mouvement est le sang, et les particules les globules rouges. Un transducteur, à la fois émetteur et récepteur, est placé perpendiculairement par rapport aux vaisseaux étudiés. La comparaison de la fréquence émise par rapport à la fréquence reçue est automatiquement déterminée par l'appareillage électronique. Sur le plan neurologique, les vaisseaux les plus accessibles sont les deux arbres carotidiens dans leur trajet extra-crânien, l'artère ophtalmique et les artères vertébrales. Cette technique vélocimétrique, dont l'intérêt est d'être totalement atraumatique, permet de déceler des thromboses carotidiennes ou vertébrales, ou des rétrécissements vasculaires lorsque ceux-ci modifient la vitesse circulatoire, ou enfin d'éventuelles turbulences, témoins d'une plaque d'athérome sur la paroi du vaisseau étudié. Cet examen a cependant des limites ; sa positivité est certes de grande valeur, alors que sa négativité ne doit pas faire surseoir à des examens plus précis si l'histoire clinique du malade le justifie.
Les progrès techniques ont permis l'élaboration d'un appareillage permettant la visualisation de l'axe artériel par un échographe de type B à balayage électronique. Ce système permet d'obtenir une coupe longitudinale du vaisseau et de visualiser éventuellement des plaques d'athérome.
La biopsie neuromusculaire
Elle consiste à prélever un fragment de nerf et de muscle dans le territoire atteint neurologiquement et à effectuer sur celui-ci plusieurs types d'examens. Le plus courant est l'examen en microscopie optique après fixation et inclusion en paraffine et colorations particulières. Les plus récents sont, d'une part, les examens des ultrastructures utilisant la microscopie électronique et, d'autre part, les examens neurochimiques histo-enzymologiques ou histofluorescents. Ces investigations complémentaires apportent au clinicien des renseignements importants. Elles peuvent, en effet, dans certains cas difficiles, différencier une atrophie musculaire d'origine neurogène d'une atrophie myogène primitive. De plus, elles peuvent apporter des arguments concernant le diagnostic étiologique de l'affection en cause. Enfin, certaines d'entre elles permettent de préciser des mécanismes neurophysiopathologiques complexes. La biopsie nerveuse est d'un intérêt indéniable ; elle est souvent effectuée simultanément avec le prélèvement musculaire. Son aspect essentiel est d'ordre étiologique, pouvant renseigner dans quelques cas sur la nature infectieuse, dysmétabolique, inflammatoire ou familiale d'une affection du système nerveux périphérique.
Les grandes étiologies
Les différents processus susceptibles de provoquer une lésion du système nerveux ne sont pas différents de ceux de la pathologie générale : on distingue des étiologies vasculaire, tumorale, infectieuse, inflammatoire, toxique et métabolique, malformative, dégénérative et traumatique.
Cette division est assez schématique, certaines lésions étant en quelque sorte mixtes : ainsi un abcès du cerveau est à la fois infectieux et tumoral. Elle est également provisoire pour un certain nombre de maladies du système nerveux, telle, par exemple, la sclérose en plaques dont la véritable nature reste indéterminée ; il est possible de la classer arbitrairement parmi les infections virales, les maladies toxiques et allergiques ou les affections dégénératives. Malgré ces réserves, dont on pourrait multiplier les exemples, une classification étiologique présente un intérêt pratique indiscutable.
Étiologie vasculaire
On entend par étiologie vasculaire aussi bien les accidents d'hémorragie par rupture d'un vaisseau ou par diapédèse des globules sanguins hors des vaisseaux que les accidents de thrombose entraînant une ischémie dans le territoire irrigué par ce vaisseau (cf. AVC [accident vasculaire cérébral]). C'est la cause la plus importante des affections neurologiques en raison de l'extrême fréquence de l' athérosclérose cérébrale.
Se produisant progressivement et se manifestant après la cinquantaine, l'athérosclérose cérébrale constitue, à partir de cet âge, l'un des grands facteurs de la morbidité générale et l'une des causes principales de la mortalité. En revanche, cette athérosclérose est relativement rare au niveau de la moelle, et il existe un contraste entre la fréquence des accidents vasculaires cérébraux et la rareté des accidents vasculaires médullaires.
La caractéristique essentielle de l'étiologie vasculaire réside dans la constitution brutale ou brusque d'un syndrome neurologique focalisé.
Cette règle comporte, bien entendu, des exceptions, car il existe des accidents vasculaires de constitution progressive et même des manifestations chroniques d'insuffisance circulatoire cérébrale, cependant que des accidents neurologiques non vasculaires peuvent se manifester brusquement. Malgré ces réserves, tout syndrome neurologique focalisé de constitution brutale ou brusque évoque, avant tout, un processus vasculaire.
L' artériographie et les progrès de la neurochirurgie ont considérablement accru l'intérêt, naguère encore purement spéculatif, des accidents vasculaires cérébraux. L'artériographie a montré que, à côté de l'athérosclérose, d'autres causes d'accidents vasculaires cérébraux peuvent être observées à tout âge, y compris l'enfance, telles les malformations vasculaires sous forme soit d'anévrismes artériels siégeant électivement sur les vaisseaux de l'hexagone de Willys et donnant des hémorragies méningées, soit d'anévrismes artério-veineux, encore appelés « angiomes », entraînant des hémorragies cérébrales et cérébro-méningées. Ces malformations sont justiciables d'une intervention chirurgicale autant pour faire l'exérèse de l'hématome intracérébral, s'il en existe un, que pour supprimer la malformation avec les risques d'hémorragie récidivante.
De la même manière, au cours d'accidents ischémiques, l'artériographie a montré la relative fréquence de thromboses situées non pas à l'origine du territoire vasculaire ischémié, mais en amont, à distance et, tout particulièrement, dans la portion cervicale des vaisseaux cérébraux.
Au niveau de la moelle, les accidents vasculaires sont rares, mais on peut observer des malformations vasculaires à type d'anévrismes artério-veineux (ou angiomes).
L'artériographie de la moelle, qui est une acquisition de ces dernières années due à René Djindjian, permet l'étude et l'approche chirurgicale de ces malformations ; elle permettra probablement de constater que, si l'insuffisance circulatoire médullaire est moins fréquente que l'insuffisance circulatoire cérébrale, elle n'en existe pas moins pour autant.
Étiologie tumorale
L' étiologie tumorale englobe toutes les néoformations se développant à l'intérieur de la cavité crânienne, c'est-à-dire, à côté des surproductions tissulaires (ou tumeurs au sens anatomopathologique du terme), d'autres processus néoformatifs, infectieux comme les abcès parasitaires, mycosiques, kystiques, inflammatoires ou même hémorragiques ; bien que moins fréquente que l'étiologie vasculaire, elle est toutefois loin d'être exceptionnelle.
Sa caractéristique réside dans la constitution progressive d'un syndrome neurologique focalisé, associé ou non à une hypertension intracrânienne.
Cette hypertension intracrânienne constitue, lorsqu'elle existe, un argument considérable en faveur d'une néoformation ; elle se manifeste par des céphalées, parfois des vomissements, une obnubilation progressive, des troubles visuels et une stase papillaire décelée à l'examen du fond d'œil. Mais l'absence de cette dernière, ou plus simplement d'œdème papillaire, de même que l'absence de toute manifestation clinique d'hypertension, ne permet en rien d'éliminer le diagnostic d'une tumeur. Celui-ci doit donc être évoqué, même en l'absence de tout signe d'hypertension intracrânienne, devant tout syndrome neurologique focalisé d'évolution progressive.
Les examens complémentaires – et il faut insister surtout sur l'importance de la gammagraphie et de l'artériographie – vont confirmer le diagnostic et préciser le siège de la tumeur, mais en même temps, joints aux données de la clinique, s'efforcer d'en préciser la nature.
Les tumeurs cérébrales les plus fréquentes sont les gliomes, les méningiomes et les métastases.
Gliomes
Les gliomes représentent 50 p. 100 des tumeurs cérébrales. Le fait essentiel est qu'ils sont constitués aux dépens du tissu cérébral et plus précisément du tissu glial de soutien, en sorte que leur exérèse chirurgicale entraîne l'ablation de toute la zone cérébrale infiltrée par la tumeur. Ce sont des tumeurs malignes, mais leur malignité est purement locale. Ils récidivent toujours localement et ne métastasent pratiquement jamais.
On peut distinguer parmi eux des formes bien différenciées, les moins malignes (astrocytomes et oligodendrogliomes) et des formes immatures, les plus malignes (glioblastomes et médulloblastomes).
Méningiomes
Les méningiomes sont des tumeurs bénignes qui, se développant aux dépens de la méninge, n'envahissent pas le tissu cérébral et, bien que s'enchâssant dans celui-ci, restent extra-cérébraux. Ils sont d'évolution lente et progressive.
Métastases
Les métastases sont de plus en plus fréquemment observées. Leur diagnostic est aisé si elles sont secondaires à un cancer connu ; mais, très souvent, elles sont primitives en apparence, et ce doit être une règle, devant tout syndrome tumoral d'évolution rapide, de penser à cette possibilité et de rechercher au minimum un cancer du poumon chez l'homme, un cancer du sein chez la femme, car ce sont là les deux sièges les plus habituels du cancer primitif.
Les autres variétés de tumeurs sont plus rares, mais il faut insister sur le fait qu'un abcès ou qu'un hématome intracérébral donnent la symptomatologie d'une tumeur.
Une localisation tumorale très particulière doit être citée à part : les tumeurs de l'hypophyse associent à un syndrome d'insuffisance hypophysaire un syndrome visuel par compression du chiasma des nerfs optiques (hémianopsie bitemporale).
Étiologie infectieuse
L' étiologie infectieuse groupe, à côté des infections bactériennes, les infections virales, mais aussi les parasitoses et les mycoses.
Ces infections peuvent donner des lésions localisées à type d'abcès, de tuberculomes évoluant comme des tumeurs. Beaucoup plus souvent seront réalisés des syndromes diffus ; ce caractère diffus des syndromes, joint aux signes précurseurs lorsqu'ils existent et à un élément infectieux associé, lui aussi inconstant, constitue un argument important en faveur de cette étiologie infectieuse.
Selon que le processus infectieux est limité à l'espace sous-arachnoïdien, qu'il y prédomine, ou atteint plus ou moins profondément la substance cérébrale ou médullaire, il s'agit de méningites, d'encéphalites, de myélites, d'encéphalo-myélites ou de ganglioradiculites, mais il n'est pas rare que tous les plans soient atteints à un degré quelconque et qu'il s'agisse de méningo-encéphalo-myélite.
Méningites
Les méningites sont caractérisées par l'association d'un syndrome méningé fait de céphalées, vomissements, avec raideur et hyperesthésie, avec un syndrome infectieux plus ou moins marqué. L'importance de ce syndrome infectieux permet de distinguer :
– les méningites aiguës à germes figurés (surtout méningocoque, pneumocoque) et dont l'évolution a bénéficié de par l'introduction des sulfamides puis des antibiotiques ;
– les méningites subaiguës, comprenant la méningite tuberculeuse (dont le pronostic, jadis toujours fatal, a été transformé par l'antibiothérapie), et les méningites virales (dont les plus fréquentes sont les méningites ourlienne, poliomyélitique et aussi spirochétosique) ;
– les méningites chroniques, telles celles de certaines mycoses.
Encéphalites et méningo-encéphalites
Les encéphalites et les méningo-encéphalites, qui sont caractérisées par un état inflammatoire non suppuré de l'encéphale, réalisent les tableaux les plus divers. Elles peuvent en effet évoluer sur un mode suraigu, aigu, subaigu ou chronique, toucher électivement soit la substance grise, soit la substance blanche, soit les deux à la fois ; prédominer sur tel étage du névraxe et affecter électivement telles ou telles formations. Il est donc impossible de constituer un tableau unique d'encéphalite ; toutefois, un certain nombre d'éléments dans un tableau neurologique peuvent permettre de penser qu'il s'agit d'une encéphalite : l'existence au moins fréquente d'un syndrome infectieux, le caractère diffus du syndrome neurologique, très différent du caractère focalisé d'une tumeur ou d'un accident vasculaire, la présence de troubles de conscience (tels troubles du sommeil ou états léthargiques), de troubles psychiques avec confusion mentale, de mouvements involontaires, en particulier myoclonies ou mouvements anormaux, de troubles du tonus avec hypertonie, de paralysies oculo-motrices, de troubles de la parole et de la voix, de manifestations végétatives avec bouffées vasomotrices.
Ces encéphalites peuvent schématiquement être divisées en trois catégories :
– encéphalites des maladies infectieuses ;
– encéphalites bactériennes et parasitaires, parmi lesquelles la toxoplasmose (encéphalite fœtale) et les méningo-encéphalo-myélites syphilitiques jadis très fréquentes, actuellement beaucoup plus rares, de même que la paralysie générale (qui entraîne une démence progressive avec délire mégalomaniaque) et le tabès (dont les lésions portent essentiellement sur les racines sensitives et les cordons postérieurs de la moelle) ;
– encéphalites virales, ou présumées telles, dont le type est l'encéphalite épidémique de 1919-1920 (maladie de von Economo-Cruchet).
Parmi ces encéphalites virales, une place à part doit être faite à la poliomyélite antérieure aiguë, encéphalo-myélite due à un virus filtrant, naguère encore infiniment redoutable par sa fréquence, sa gravité et, surtout, la gravité de ses séquelles ; elle doit devenir exceptionnelle, si l'on généralise la vaccination systématique.
Caractérisée par la localisation préférentielle de ses lésions aux cornes antérieures de la moelle, la poliomyélite réalise le tableau de la paralysie infantile, mais, dans certains cas et particulièrement chez l'adulte, elle déborde la moelle ou réalise même des formes extra-spinales.
Les ganglioradiculites sont représentées essentiellement par le zona.
Étiologie toxique et étiologie métabolique
L' étiologie toxique et l'étiologie métabolique peuvent être réunies dans un même chapitre, car c'est habituellement par une accumulation massive de produits toxiques que les troubles métaboliques entraînent des lésions du système nerveux, et les manifestations des intoxications endogènes ne sont pas différentes de celles des intoxications exogènes. Il est vraisemblable d'ailleurs qu'au facteur toxique s'ajoutent, dans tous les cas, des facteurs individuels relevant d'une sensibilité particulière de l'organisme ainsi que des phénomènes d'intolérance se rattachant à l'allergie. Si toutes les régions du système nerveux peuvent être touchées par ces lésions toxiques, il faut insister sur l'importance particulière de l'atteinte du système nerveux périphérique sous forme de polynévrites ou de multinévrites.
D'une manière générale, on peut dire, d'une part, que chaque toxique a sa localisation de prédilection dans le système nerveux et que, d'autre part, les manifestations en sont habituellement bilatérales et symétriques.
Citons quelques-unes des différentes intoxications exogènes ou endogènes du système nerveux, beaucoup trop nombreuses pour les énumérer toutes ici.
– L' alcool, le plus important par sa fréquence de tous les toxiques aussi bien en pathologie neurologique qu'en pathologie psychiatrique, agit moins par une action directe (qui ne s'observe guère que dans l'intoxication aiguë) qu'indirectement par l'intermédiaire de lésions gastriques, hépatiques et endocriniennes entraînant un état carentiel portant principalement sur la vitamine B.
L' encéphalopathie alcoolique chronique est d'une très grande fréquence allant de la simple détérioration psychique jusqu'à la démence.
L' encéphalopathie de Gayet-Wernicke associe des troubles toniques, des signes cérébelleux, des paralysies oculo-motrices et des troubles neurovégétatifs. L'examen de sang montre une hyperpyruvicémie. Le pronostic en est grave et l'évolution souvent mortelle.
Le delirium tremens peut être considéré comme une encéphalopathie métabolique survenant à l'occasion d'un processus d'agression sur un fond d'éthylisme chronique. Il se manifeste par un délire associé à un tremblement, une dysarthrie et des troubles de l'équilibre.
La polynévrite alcoolique atteint habituellement les membres inférieurs, prédominant sur les nerfs (et les muscles) de la loge antéro-externe.
– Le diabète est l'une des causes les plus importantes de neuropathies périphériques : polynévrites, multinévrites ou mononévrites qui s'observent, aussi bien que dans les diabètes graves, dans des formes frustes et des états paradiabétiques.
– Les porphyries, troubles complexes du métabolisme des pyrrols, peuvent être à l'origine d'un syndrome associant une polynévrite (ou une multinévrite), des troubles psychiques et un syndrome abdominal aigu. L'émission d'urines rouge foncé est un argument très important du diagnostic, qui sera confirmé par la constatation de porphyrines dans les urines.
– Certains médicamentspeuvent être à l'origine d'intoxications. Il faut citer surtout : l'Isoniazide, la Furadoïne, la Colimycine, qui donnent essentiellement des polynévrites.
Parmi les toxiques, il en est certains qui sont susceptibles d'entraîner le coma et la mort ; devant tout coma dont la cause n'apparaît pas évidente, il faut y penser de façon systématique. Nous citerons les plus fréquents :
– le coma barbiturique est calme, avec hypotonie et abolition des réflexes ;
– le coma oxycarboné s'accompagne d'hypothermie, d'hypotension, d'une coloration rouge vif du visage, parfois de phlyctènes ;
– le coma diabétique entraîne fréquemment des vomissements, des troubles respiratoires, avec hyperventilation, des périodes d'excitation ;
– le coma hypoglycémique s'accompagne de sudations, d'agitation, de tremblements, de spasmes tétaniformes.
Étiologie dégénérative
On décrit généralement sous le nom de maladies dégénératives un certain nombre d'affections dont certaines ont un caractère familial. Elles ont en commun une évolution progressive, un caractère bilatéral et habituellement symétrique, et elles réalisent, plus ou moins rapidement, un tableau qui, pour chacune d'entre elles, est systématisé. Il n'est pas douteux qu'il s'agit là d'un regroupement provisoire et que, vraisemblablement, certaines de ces affections seront un jour considérées comme métaboliques, virales, allergiques, immunologiques (ou de tout autre origine).
Ces maladies, ou syndromes dégénératifs, peuvent toucher tous les étages du système nerveux.
Syndromes dégénératifs des hémisphères cérébraux
Les syndromes dégénératifs des hémisphères cérébraux sont des atrophies séniles et préséniles se manifestant par des troubles de la mémoire et de l'attention, une détérioration intellectuelle, des troubles du comportement qui peuvent donner lieu à une démence et à des troubles psychotiques.
Dans le groupe des atrophies préséniles, on peut distinguer la maladie d'Alzheimer (dans laquelle l'atrophie est diffuse et prédomine dans les régions pariéto-occipitales) et la maladie de Pick (où l'atrophie reste localisée aux régions fronto-temporales). Quant à la maladie de Creutzfeldt-Jakob, qui a été longtemps classée dans les affections dégénératives et qui comprend l'association d'une détérioration intellectuelle, de troubles pyramidaux et extra-pyramidaux, on sait actuellement qu'il s'agit en fait d'une maladie infectieuse (infection virale ou pseudovirale lente).
Syndromes dégénératifs des noyaux gris centraux : la maladie de Parkinson
Parmi les syndromes dégénératifs des noyaux gris centraux, plusieurs affections telles la chorée chronique et les dégénérescences hépato-lenticulaires sont des maladies familiales et seront décrites comme telles (cf. infra, Les maladies familiales) ; mais la maladie de Parkinson, par sa fréquence, par sa gravité, par l'importance des travaux qu'elle a suscités et par la découverte de l'importance de la dopamine mérite une description particulière. Caractérisée, sur le plan anatomique, par des lésions essentiellement limitées au locus niger et au système strié, et, sur le plan clinique, par l'association de tremblements, d'hypertonie et d'akinésie, la maladie débute lentement et insidieusement, pour s'aggraver progressivement de façon plus ou moins rapide, jusqu'à l'impotence grabataire.
La thérapeutique s'est longtemps limitée à des médicaments de synthèse dits antiparkinsoniens, qui n'améliorent que très modestement la symptomatologie de la maladie et n'en modifient nullement l'évolution. Une première étape dans le traitement de cette maladie avait été franchie par l'introduction d'interventions chirurgicales, à vrai dire très empiriques, consistant à créer une lésion que l'on a fait porter successivement sur les voies pallidofuges, sur le pallidum puis sur le noyau ventral latéral du thalamus. Ces lésions ont pu être réalisées en utilisant chez l'homme la technique stéréotaxique, employée depuis longtemps déjà chez l'animal pour l'étude des structures cérébrales profondes.
Ces interventions ont permis, de façon assez remarquable, de supprimer ou de diminuer le tremblement et l'hypertonie mais elles n'agissent pas sur l'akinésie et n'en empêchent pas l'aggravation progressive. Par contre la neurostimulation profonde de structures ponctuelles du cerveau basal, sous contrôle stéréotaxique permet d'obtenir la sédation des grands troubles fonctionnels chez les parkinsoniens.
Une nouvelle étape, dans le traitement de la maladie, a été franchie par l'introduction de la dopamine. À la suite des travaux de Carlsson Bertler et Rosengren qui montraient que la dopamine était essentiellement concentrée dans les noyaux gris (circuit nigro-striatal), ceux de Ehringer et Hornykiewicz qui démontraient sa diminution dans les cerveaux parkinsoniens, et ceux de Barbeau, Sourkes et Murphy qui constataient l'abaissement de son taux dans les urines de ces malades, cette substance a été à l'origine d'un traitement substitutif d'une grande efficacité.
Il s'agit là, incontestablement, d'un progrès considérable, car la dopamine agit surtout sur l'akinésie, qui constitue le syndrome le plus grave de la maladie et sur lequel les interventions stéréotaxiques sont pratiquement sans effet. Actuellement, dans les formes surtout tremblantes de la maladie, il peut être indiqué d'associer à la dopamine le traitement chirurgical, mais il est possible d'escompter, dans les années à venir, l'apparition de nouveaux médiateurs chimiques permettant sinon de guérir la maladie, du moins d'en supprimer les symptômes et d'en empêcher l'évolution.
Syndromes dégénératifs cérébelleux
Les syndromes dégénératifs cérébelleux sont les atrophies cérébelleuses, parmi lesquelles on peut distinguer : les atrophies cérébelleuses diffuses ; les atrophies à prédominance corticale avec essentiellement l'atrophie cérébelleuse tardive de P. Marie, Foix et Alajouanine ; l'atrophie olivo-ponto-cérébelleuse.
Syndromes dégénératifs médullaires
Certains syndromes dégénératifs médullaires, les hérédo-dégénérescences spino-cérébelleuses, seront étudiés avec les maladies familiales (cf. infra) ; la sclérose latérale amyotrophique est une affection d'une extrême gravité, caractérisée anatomiquement par la dégénérescence des faisceaux pyramidaux et de la corne antérieure de la moelle ainsi que des noyaux moteurs des nerfs crâniens. Elle associe, à un syndrome pyramidal des quatre membres, des paralysies avec atrophie musculaire et fibrillations, sans aucun trouble sensitif.
Syndromes dégénératifs périphériques
Les syndromes dégénératifs périphériques s'observent essentiellement dans les maladies familiales avec lesquelles ils seront étudiés (cf. infra, Les maladies familiales).
Étiologie inflammatoire
Bien plus encore que les maladies dégénératives, les maladies inflammatoires forment un cadre d'attente groupant des maladies dont certaines s'apparentent entre elles, mais dont l'étiologie véritable nous échappe encore.
Sclérose en plaques
La sclérose en plaques est, par sa fréquence et sa gravité, l'une des grandes maladies du système nerveux. Anatomiquement, elle est caractérisée par l'apparition successive d'une série de foyers de démyélinisation qui aboutissent à une prolifération gliale et réalisent un aspect de sclérose multiple ou multiloculaire. Disséminées sans ordre apparent, ces plaques ont une prédilection pour la substance blanche, et cela particulièrement au niveau de la moelle, du nerf optique et du tronc cérébral.
L'apparition de ces différentes plaques, qui se fait de façon successive et à intervalles plus ou moins éloignés, conditionne l'aspect de la maladie dont le trait essentiel est l'évolution par poussées, chaque poussée donnant une nouvelle localisation neurologique, elle-même suivie habituellement d'une régression plus ou moins importante.
Débutant chez l'adulte jeune, la sclérose en plaques aboutit après une évolution plus ou moins longue à un tableau associant un syndrome pyramidal, un syndrome cérébelleux et une névrite optique. On a montré l'existence d'une augmentation des gamma-globulines à l'électrophorèse du liquide céphalo-rachidien, ce qui constitue au début de la maladie un argument très important du diagnostic.
Maladie deSchilder
La maladie de Schilder, ou sclérose cérébrale diffuse (ou encore encéphalite périaxile diffuse), caractérisée par une démyélinisation du centre ovale, apparaît comme très proche de la sclérose en plaques. Elle se manifeste par un affaiblissement intellectuel, des troubles visuels et des troubles moteurs à type de triplégie ou de quadriplégie évoluant vers un état démentiel profond.
Étiologie malformative
Les malformations du système nerveux ou de ses annexes peuvent réaliser tous les degrés depuis les anomalies les plus monstrueuses incompatibles avec la vie jusqu'aux plus minimes restant toujours ignorées ou se manifestant à un âge plus ou moins avancé.
Les malformations évidentes apparaissent dès la naissance ou dans les premiers mois de la vie. Citons : les anencéphalies ; les encéphalocèles et les méningocèles, extrophies cérébro-méningées ou méningées à travers une fissure du crâne ; le spinabifida qui en est l'équivalent au niveau du rachis et qui consiste en une absence de soudure des deux moitiés de l'arc vertébral postérieur (ainsi est formée une fissure par où s'extériorise une tumeur formée par les méninges et la moelle).
À ces trois variétés de malformations s'ajoutent : l'hydrocéphalie, qui est une dilatation volumineuse des cavités ventriculaires par hypersécrétion ou non-résorption du liquide céphalo-rachidien qui entraîne une augmentation rapide du volume du crâne (le traitement généralement adopté aujourd'hui consiste en une dérivation du liquide ventriculaire par une valve qui le draine soit dans la cavité cardiaque, soit dans le péritoine) ; la crânio-sténose, qui se manifeste plus tardivement et résulte d'une fermeture trop rapide des sutures crâniennes, ou de certaines d'entre elles, provoquant ainsi une déformation crânienne et la possibilité d'une hypertension intracrânienne réalisant la malformation d'Arnold Chiari.
Le diagnostic de ces malformations est souvent difficile. Il est facilité lorsqu'il existe une malformation connue ; sinon, c'est la fréquence de certaines de ces malformations et leur importance en pathologie nerveuse qui doivent les faire rechercher de façon systématique.
Les maladies familiales
Il existe un nombre relativement important de maladies familiales touchant électivement le système nerveux. La plupart d'entre elles peuvent être rattachées aux affections dégénératives, d'autres font partie des malformations, d'autres enfin forment un groupe un peu particulier qu'on appelle les « dysplasies à tendance blastomateuse » en raison de la fréquence des tumeurs survenant au cours de leur évolution.
Maladies familiales dégénératives
Les maladies familiales dégénératives peuvent intéresser les différents étages du névraxe et les différents systèmes. Parmi les plus fréquentes, il faut citer :
– la chorée chronique de Huntington ;
– les dégénérescences hépato-lenticulaires, qui se manifestent par un syndrome hépatique et pigmentaire et sont dues à une erreur congénitale du métabolisme du cuivre (selon la prédominance de l'hypertonie ou des mouvements anormaux, il s'agit de la maladie de Wilson ou de la pseudo-sclérose de Westphall-Strümpell) ;
– l'atrophie cérébelleuse avec télangiectasies, qui associe à une symptomatologie cérébelleuse des télangiectasies conjonctivales ;
– les hérédo-dégénérescences spino-cérébelleuses, qui déterminent un triple syndrome : pyramidal, cérébelleux et radiculo-cordonal postérieur (selon la prédominance de l'un ou l'autre des syndromes, seront réalisés les tableaux de l'hérédo-ataxie de Pierre Marie, de la paraplégie spasmodique familiale de Strümpell-Lorrain, de la maladie de Friedreich ou de la dysplasie aréflexique héréditaire).
D'autres formes touchent assez électivement le système nerveux périphérique : l'amyotrophie spinale infantile de Werdnig-Hoffmann ; la névrite interstitielle de Déjerine-Sottas ; l'amyotrophie de Charcot-Marie ; l'acropathie ulcéro-mutilante ; la maladie de Refsum, qui a fait l'objet de travaux récents montrant qu'elle est due à un trouble du métabolisme des lipides, et principalement de l'acide phytanique, et qui associe une neuropathie périphérique, une rétinite pigmentaire et des signes cérébelleux ; les myopathies, qui sont caractérisées par une diminution progressive de la force de certains groupes musculaires accompagnée soit d'une atrophie des muscles, soit d'une pseudo-hypertrophie.
Maladies familiales à tendance blastomateuse
Les maladies familiales à tendance blastomateuse forment un groupe de dysplasies congénitales ou, plus précisément, de polydysplasies de localisations neurologiques, mais également cutanées et viscérales qu'on désigne encore comme « phacomatoses » (phacos, « tache »), et qui entraînent avec une particulière prédilection la formation de tumeurs. On décrit quatre maladies dans ce groupe :
– La neurofibromatose de Recklinghausen, à laquelle sont dues des tumeurs cutanées et des tumeurs nerveuses. Celles-ci sont de différents types, mais les plus fréquentes sont les tumeurs de nerfs (neurinomes) et, à un moindre degré, des tumeurs du nerf optique.
– La sclérose tubéreuse de Bourneville associe à un syndrome neurologique fait d'épilepsie, de retard intellectuel et de troubles mentaux (à quoi peut s'ajouter une tumeur) un syndrome cutané dont l'élément caractéristique est l'adénome sébacé de la face.
– L' angiomatose encéphalo-trigéminale de Sturge-Weber se définit, sur le plan clinique, par l'association d'un angiome plan de l'hémiface et de crises d'épilepsie apparaissant précocement (à quoi pourront s'ajouter une hémiplégie, une arriération mentale, des signes oculaires), sur le plan radiologique par des calcifications crâniennes, et, sur le plan anatomique, par un angiome méningé.
– L'angiomatose rétino-cérébelleuse de von Hippel-Lindau est décrite comme associant un angiome de la rétine, un angiome du cervelet et des angiomes ou kystes viscéraux. Il semble que dans toutes ces localisations il s'agisse d'hémangiomes.
Étiologie traumatique
L' étiologie traumatique dont la fréquence augmente sans cesse en même temps que se multiplient les accidents du trafic est évidente dans la très grande majorité des cas, et le problème qui se pose devant un syndrome neurologique traumatique est celui de la lésion qui en est responsable et de ses indications thérapeutiques.
Lésions traumatiques crâniennes : formes cliniques
– Au niveau de l'os crânien, une fracture n'est pas rare. Contrairement à une croyance très répandue, la fracture du crâne ne comporte en elle-même aucune gravité. Cependant, elle implique une surveillance particulière du blessé, car elle peut être à l'origine d'une hémorragie dans l'espace extra-dural. En revanche, lorsque existent un enfoncement osseux et, à plus forte raison, une plaie crânio-cérébrale, une intervention s'impose pour éviter la compression du cerveau et son infection.
– Au niveau du cerveau, la lésion traumatique essentielle est la contusion, ou mieux les contusions car il ne s'agit habituellement pas d'une lésion unique due à un choc direct, mais plutôt de lésions multiples, le cerveau dans la boîte crânienne s'écrasant contre les crêtes ou les arêtes osseuses et méningées.
Les contusions s'accompagnent d'un suintement hémorragique ainsi que d'un œdème ou, mieux, d'un gonflement cérébral. On comprend que de telles lésions, susceptibles d'entraîner d'emblée un coma grave, soient au-dessus de toute ressource chirurgicale et qu'une intervention ne soit justifiée que lorsque existe une lésion relativement localisée et que l'hémorragie, par son importance, joue le rôle de corps étranger.
Les espaces méningés extra-cérébraux sous-arachnoïdien, sous-dural et extra-dural peuvent, eux aussi, être le siège d'une hémorragie. Celle-ci peut être assez importante pour entraîner une compression cérébrale nécessitant une intervention. Il en est ainsi tout particulièrement au niveau de l'espace extra-dural, où un vaisseau méningé peut être déchiré par une fracture du crâne.
Ces hémorragies, et tout particulièrement celles de l'espace extra-dural, ou hématome extra-dural, font que si les indications opératoires sont rares dans les traumatismes crâniens, elles peuvent, dans quelques cas, revêtir un caractère d'extrême urgence.
Pronostic et indications opératoires
La possibilité de complications hémorragiques nécessitant une intervention montre l'importance d'une surveillance rigoureuse des traumatisés crâniens afin de déceler sans tarder une aggravation. L'élément essentiel de cette surveillance est l'état de conscience, et, un peu schématiquement, on peut dire que c'est en fonction de lui qu'est porté le pronostic et que sont posées les indications opératoires.
Un traumatisé conscient n'est pas un traumatisé inquiétant, mais il doit être surveillé afin de déceler toute altération de sa conscience. Un traumatisé inconscient, et dont le coma s'est installé d'emblée à la suite du traumatisme, est un traumatisé grave, et la gravité de son état est proportionnelle à la profondeur du coma. Les progrès de la réanimation, durant ces dernières années, et, en particulier, de la réanimation respiratoire avec la trachéotomie ont contribué à beaucoup modifier le pronostic de ces traumatismes graves, jadis très rapidement mortels. Un traumatisé qui tend à perdre conscience fait vraisemblablement une hémorragie qu'il importe d'opérer avant que ne soient constituées des lésions irréversibles.
Lésions traumatiques rachidiennes
Les lésions traumatiques rachidiennes peuvent également affecter les différents plans osseux ou nerveux. Les lésions osseuses peuvent donner lieu soit à un traitement par immobilisation plâtrée, soit à une intervention orthopédique. Les lésions médullaires sont souvent de pronostic sérieux, mais ont été améliorées par les progrès des soins médicaux cutanés et sphinctériens et par ceux de la rééducation motrice.
L’innovation en neurologie médicochirurgicale
Cette revue générale des disciplines neurologiques et neurochirurgicales nous a déjà laissé entrevoir certaines lignes de force de leur évolution qui sont par conséquent celles d’un nouvel espoir dans la prise en charge des neuropathies, mais il faut souligner certains points.
– Sur le plan diagnostique, l'apport de la physique et de l'informatique aux disciplines médicales a amené des progrès importants dans la connaissance des affections neurologiques et du fonctionnement du cerveau.
La tomographie par émission de positrons est devenue une méthode d'investigation d'importance fondamentale. Elle se fonde sur l'utilisation d'atomes radioactifs particuliers, les positrons (électrons positifs), qui s'annulent au niveau du tissu cérébral avec des électrons négatifs en émettant des photons divergents à 1800, qui sont recueillis par des détecteurs à scintillations. Les atomes les plus utilisés en médecine sont actuellement le LO15, le N13, le C11 et le F17. Employés seuls ou incorporés à des molécules organiques, les positrons permettent déjà une véritable exploration in vivo du métabolisme cérébral, de la barrière hémato-encéphalique et une meilleure compréhension des mécanismes de certaines drogues à visée cérébrale.
Puis l'utilisation du phénomène de résonance nucléaire magnétique, fondée sur l'utilisation de champs magnétiques qui font vibrer les protons « célibataires » de certains atomes, a ouvert de grandes perspectives d'exploration des maladies nerveuses. Cette technique permet de visualiser les processus pathologiques du cerveau et, sur le plan expérimental, d'explorer le métabolisme du tissu vivant. Son développement progresse très rapidement. Les recherches en biologie moléculaire sont très prometteuses : on peut mieux déchiffrer le code génétique, ce qui permet de mettre en place la trame des maladies neurologiques familiales ; précisant certains aspects du métabolisme du tissu nerveux et des agents chimiques de la transmission synaptique, et donnant de nouvelles informations sur le mécanisme de grandes fonctions physiologiques des formations supérieures et, par suite, sur la physiopathologie de leur dérèglement. La découverte de la dopamine, dans le traitement des syndromes parkinsoniens, et celle des enképhalines et des endorphines, dans le domaine du contrôle de la douleur et d'autres fonctions cérébrales, en est une illustration.
L'étude approfondie du spectre chimique du liquide céphalo-rachidien, telle qu'elle est déjà amorcée par les méthodes électro-immunophorétiques, fournira des éléments diagnostiques sur des affections encore mal situées nosologiquement.
– Sur le plan thérapeutique, une meilleure approche du mécanisme de la douleur et de ses systèmes de contrôle permet de modifier profondément l'attitude du thérapeute. Les recherches se sont orientées davantage vers le renforcement des barrages physiologiquement prévus pour filtrer la douleur que vers la destruction de ses voies ou de ses structures de projection. La découverte de substances physiologiques morphine-like, qui a ouvert de grands espoirs thérapeutiques, doit se concrétiser par la mise en évidence et la synthèse d'une molécule plus spécifique, n'ayant pas les inconvénients secondaires de la morphine (cf. opioïdes).
L'introduction de la microscopie binoculaire dans la technique neurochirurgicale, a beaucoup amélioré le traitement des malformations vasculaires, des thromboses artérielles et de certaines tumeurs bénignes, en permettant de préserver au maximum les structures ou les nerfs sous-jacents, ouvre la voie à une chirurgie plus précise et plus audacieuse cf. chirurgie).
Les progrès des techniques immunologiques et virologiques vont aboutir à la mise au point de thérapeutiques concernant des affections encore peu contrôlables, comme la sclérose en plaques.
Enfin, les techniques neuroradiologiques ont ouvert une voie importante dans le traitement des malformations vasculaires cérébrales et médullaires, inaccessibles à la chirurgie. Elles permettent les traitements de certaines d'entre elles par sonde guidée dans la lumière des vaisseaux, rendant possible leur obstruction soit par « ballonnet », soit par l'injection d'une substance plastique. Cette discipline pourra aborder éventuellement le traitement chimique in situ de néoformations malignes du cerveau inaccessibles à la thérapeutique chirurgicale.
Il est certain que les perspectives d'avenir dépendent étroitement des progrès qui seront réalisés dans la compréhension du système nerveux, tant sur le plan électrophysiologique que biochimique, dans l'essor des techniques complémentaires (microscopie électronique, ou certaines méthodes physiques) transposées à l'étude du cerveau humain.
On peut espérer que cet essor profitera non seulement aux sciences neurologiques, mais également à la connaissance de processus fondamentaux, comme celui de la mémoire et de la pensée.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Raymond HOUDART : professeur à la faculté de médecine Lariboisière-Saint-Louis, Paris
- Hubert MAMO : professeur à la faculté de médecine Lariboisière-Saint-Louis, Paris
- Jean MÉTELLUS : docteur en linguistique, neurologue, médecin des hôpitaux
- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis
Classification
Médias
Autres références
-
AMUSIE
- Écrit par Séverine SAMSON
- 327 mots
L’amusie est un trouble neurologique qui affecte à des degrés variables la perception et la production musicales. Celui-ci ne s’explique pas par une baisse de l’acuité auditive (surdité), une déficience intellectuelle ou motrice. Cette perte sélective de la fonction musicale contraste avec des...
-
CERVELET
- Écrit par Jean MASSION
- 7 768 mots
- 13 médias
Le cervelet, ou petit cerveau, est un organe situé en parallèle sur les grandes voies sensorielles et motrices. Son atteinte ne se traduit ni par une paralysie, ni par une anesthésie, mais par un ensemble de signes qui attestent de perturbations importantes dans le maintien de l'équilibre et de...
-
ÉLECTROPHYSIOLOGIE
- Écrit par Max DONDEY , Jean DUMOULIN , Alfred FESSARD , Paul LAGET et Jean LENÈGRE
- 17 363 mots
- 15 médias
Pathologie.Lors de la dégénérescence totale du nerf, on obtiendra une inexcitabilité faradique et galvanique (excepté pour les temps longs mais avec lenteur de la réponse). On peut avoir un galvanotonus avec ou sans réaction de Remak. En cas de dégénérescence partielle, on aura une hypoexcitabilité... -
HÉMISPHÈRES CÉRÉBRAUX
- Écrit par Pierre BUSER et Paul LAGET
- 12 329 mots
- 8 médias
- Afficher les 12 références
Voir aussi
- CRISE D'ÉPILEPSIE
- GRAND MAL ÉPILEPTIQUE
- PETIT MAL ÉPILEPTIQUE ou ABSENCE
- RYTHMES CÉRÉBRAUX
- SPHINCTER
- NERF PNEUMOGASTRIQUE ou NERF VAGUE
- TOMOGRAPHIE PAR ÉMISSION DE POSITONS (TEP)
- TRAUMATOLOGIE
- NEUROLOGIE CLINIQUE
- SCINTIGRAPHIE ou GAMMAGRAPHIE, médecine
- DOPAMINE
- COLONNE VERTÉBRALE
- HÉRÉDITAIRES MALADIES ou MALADIES GÉNÉTIQUES
- CATÉCHOLAMINES
- NYSTAGMUS
- ANGIOME
- WILLIS THOMAS (1621-1675)
- SCIENCES HISTOIRE DES, XVIIe et XVIIIe s.
- SCIENCES HISTOIRE DES, XIXe s.
- INFLUX NERVEUX
- INFECTION
- RADIOGRAPHIE
- NEUROCHIMIE
- VESTIBULAIRE APPAREIL
- SENSIBILITÉ TACTILE ou TOUCHER
- IMAGERIE CÉRÉBRALE
- SCIENCES HISTOIRE DES, Antiquité et Moyen Âge
- ÉLECTROENCÉPHALOGRAPHIE (EEG)
- CÉPHALO-RACHIDIEN LIQUIDE
- PYRAMIDALE VOIE
- THALAMUS
- WERNICKE CARL (1848-1905)
- BIOPSIE
- DYSGRAPHIE
- ENCÉPHALITE
- AMYOTROPHIE ou ATROPHIE MUSCULAIRE
- ARTHROPATHIE
- CORTICO-SOUS-CORTICAUX SYNDROMES
- AKINÉSIE
- DÉGÉNÉRATIVES MALADIES
- ANGIOMATOSES
- ANGIOGRAPHIE
- BROWN-SÉQUARD SYNDROME DE
- AGNOSIE
- BABINSKI SIGNE DE
- NERFS CRÂNIENS
- AGRAPHIE
- NERFS
- GALL FRANZ JOSEF (1758-1828)
- TROPHICITÉ
- STATIQUES TROUBLES
- NERF PATHÉTIQUE
- NERF TRIJUMEAU
- NERF SPINAL
- QUEUE-DE-CHEVAL SYNDROME DE LA
- SCHILDER MALADIE DE
- HYPERTONIE MUSCULAIRE
- HYPOTONIE MUSCULAIRE
- MÉNINGO-ENCÉPHALITE
- NERF FACIAL
- NERF GLOSSO-PHARYNGIEN
- NERF GRAND HYPOGLOSSE
- MÉNINGIOME
- MULTINÉVRITES
- NEUROPHYSIOLOGIE
- RADIOLOGIE
- MÉDIATEURS BIOCHIMIQUES
- SCLÉROSE LATÉRALE AMYOTROPHIQUE
- ÉTATS DE CONSCIENCE
- SCIENCES HISTOIRE DES, Renaissance
- MÉTABOLIQUES MALADIES
- PORPHYRIES
- TUMEUR BÉNIGNE
- TUMEUR MALIGNE
- GAYET-WERNICKE ENCÉPHALOPATHIE DE
- NEURONE ou CELLULE NERVEUSE
- THERMOSENSIBILITÉ
- SCOTOMES
- ALCOOLISME
- ENCÉPHALOPATHIES
- ACUITÉ VISUELLE
- ARTÉRIOGRAPHIE
- ANÉVRYSMES ou ANÉVRISMES
- ÉGYPTE, histoire : l'Antiquité
- CRÂNE HUMAIN
- NERF AUDITIF
- ANATOMO-CLINIQUE MÉTHODE
- CLINIQUES INVESTIGATIONS
- NERFS OCULO-MOTEURS
- FOND D'ŒIL
- POTENTIELS ÉVOQUÉS
- PUPILLE, anatomie
- HYDROCÉPHALIE
- NORADRÉNALINE
- SPINA BIFIDA
- CONTRACTION MUSCULAIRE
- MARCHE
- MÉNINGITE
- PARALYSIE
- DOPPLER-FIZEAU EFFET, applications médicales
- NEUROBIOLOGIE
- LANGAGE PATHOLOGIE DU
- NEUROMÉDIATEURS ou NEUROTRANSMETTEURS
- ENDORPHINES
- ENKÉPHALINES
- SCANNER, médecine
- HYPERTENSION INTERCRÂNIENNE
- MÉDECINE HISTOIRE DE LA
- POLYRADICULONÉVRITE
- NEUROCHIRURGIE
- ATLAN HENRI (1931- )
- ASYNERGIE
- PSYCHOLINGUISTIQUE
- CAMPIMÉTRIE
- HÉMIANOPSIES
- EXPLORATION FONCTIONNELLE
- ADIADOCOCINÉSIE
- HYPERMÉTRIE
- ARGYLL-ROBERTSON SIGNE D'
- ATROPHIES PRÉSÉNILES
- CÉRÉBELLEUX SYNDROME
- CLAUDE-BERNARD-HORNER SIGNE DE
- CHAMP VISUEL
- DÉGÉNÉRESCENCE HÉPATO-LENTICULAIRE
- VAISSEAUX SANGUINS
- ANATOMIE HUMAINE
- DÉBIT SANGUIN CÉRÉBRAL
- NERF OLFACTIF
- ÉLECTRODIAGNOSTIC
- MÉDECINE ARABE
- ISOTOPES, biologie
- COUCHE OPTIQUE, neurologie
- RADICULAIRE SYNDROME
- TREMBLEMENT
- NEUROTRANSMISSION
- TRONCULAIRE PATHOLOGIE
- NEUROLOGIE HISTOIRE DE LA
- ARC RÉFLEXE, neurologie
- NEUROSCIENCES
- JOUBERT LAURENT (1529-1582)
- STÉRÉOGNOSIE
- PARALYSIES DES MUSCLES OCULAIRES
- FRACTURE DU CRÂNE
- PARKINSONIEN SYNDROME
- MYOTATIQUE RÉFLEXE
- LÉSION CÉRÉBRALE
- LOBE FRONTAL
- LOBE TEMPORAL
- FRITSCH GUSTAV (1838-1927)