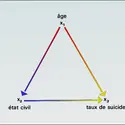MALEBRANCHE NICOLAS (1638-1715)
Article modifié le
La philosophie de Malebranche
Avec Malebranche, le point d'appui de la philosophie, ce n'est plus, comme avec Descartes, la lumière naturelle créée, ce n'est plus la réflexion de l'esprit sur soi, ce n'est plus le cogito : c'est la lumière divine elle-même, c'est le Verbe de Dieu, avec lequel notre union est si étroite qu'elle ne pourrait se rompre sans que notre être en fût détruit.
Aussi la philosophie ne connaît-elle plus de bornes : le domaine que Descartes réservait à la théologie, ou Pascal au cœur, devient celui de la plus haute philosophie. Et si, pour la créature, l'infiniment infini garde quelque chose d'incompréhensible, du moins, de cette incompréhensibilité, saisit-elle la raison.
Sans doute, depuis le péché d'Adam, qui eut pour conséquence la subordination de l'âme au corps, l'homme est incapable d'apercevoir par ses propres forces la lumière qui l'éclaire, de même que les aveugles et ceux qui ferment les yeux ne sont point éclairés par la lumière du Soleil qui, pourtant, les environne. Aussi le Verbe s'est-il incarné pour parler aux hommes charnels et grossiers un langage sensible accommodé à leur faiblesse. Mais, puisque c'est la même Raison de Dieu qui nous parle par l'évidence de la lumière et par l'autorité de la révélation, la religion peut et doit s'achever dans la philosophie, la foi doit nous conduire à l'intelligence : « La foi passera, mais l'intelligence subsistera éternellement » (Traité de morale).
Que la raison de l'homme soit le Verbe de Dieu, c'est ce que Malebranche établit par une multitude d'arguments, qu'il ne cessera de diversifier.
La Raison est universelle, puisque tous les hommes voient que 2 fois 2 font 4 et qu'il faut préférer son ami à son chien. Elle est immuable et nécessaire, puisqu'il ne peut se faire que le triangle n'ait pas la somme de ses angles égale à deux droits, ou qu'il ne faille pas préférer son ami à son chien. Elle est infinie, puisque je conçois qu'il peut y avoir un nombre infini de triangles, ou d'autres figures, puisque je conçois l'infini de l'étendue, l'infini des nombres, puisque, surtout, toute idée est infinie, l'idée du cercle, par exemple, étant, non point l'idée de tel cercle particulier, mais celle de tous les cercles possibles, ou encore l'infinité des cercles en un.
Universelle, immuable, nécessaire, infinie, donc incréée, cette Raison ne peut être que celle de Dieu, « car, écrit Malebranche, il n'y a que l'être universel et infini qui renferme en soi-même une raison universelle et infinie » (Recherche de la vérité, Xe Éclaircissement).
Des considérations psychologiques confirment la conclusion ainsi tirée de la nature de la raison. Je ne puis penser le particulier de façon claire qu'en partant de la connaissance confuse de tous les êtres, laquelle suppose la présence à notre esprit de Dieu, qui seul les renferme tous dans la simplicité de son être. Le sentiment intérieur que j'ai de moi-même m'enseigne que toutes les modifications de mon âme sont obscures, confuses, changeantes, particulières, donc radicalement hétérogènes aux idées, qui sont claires, distinctes, immuables, universelles.
Certes, la thèse du caractère divin de la lumière qui nous éclaire est fort ancienne, puisque, avant Augustin, on la trouve déjà chez des Pères qui, tels Justin ou Clément d'Alexandrie, l'avaient apprise, dit Malebranche, « dans les livres des platoniciens estimés alors ou dans ceux de Philon et des autres juifs ; et ils s'en étaient convaincus par le huitième chapitre des Proverbes de Salomon, et surtout par l'Évangile de saint Jean » (préface aux Entretiens métaphysiques). Mais elle devient, chez Malebranche, l'assise d'une doctrine tout à fait originale.
D'abord, pour tous ces penseurs, nous n'apercevons dans la Raison que les idées et les vérités intelligibles, non les choses corruptibles, qui ne peuvent trouver place dans l'Être infiniment parfait. La philosophie cartésienne, en démontrant la subjectivité des sensations, permet à Malebranche de faire de Dieu le lieu de la connaissance sensible autant que de la connaissance rationnelle. Ce qui constitue proprement la théorie de la vision en Dieu.
D'autre part, en proclamant contre Descartes, Arnauld et Bossuet que la volonté de Dieu se subordonne à la Sagesse, Malebranche met dans la Raison le principe du système entier de l'univers. Et puisque l'homme participe à la Raison souveraine, ce système lui devient intelligible, du moins dans ses principes fondamentaux.
On examinera d'abord la théorie de la vision en Dieu, ce qui conduira à préciser la nature de la connaissance de Dieu, puis le système de la Providence.
La vision en Dieu
Les songes, les hallucinations, l'illusion des amputés, les erreurs des sens, etc., montrent clairement que les sens et l'imagination ne nous représentent aucun objet distinct de nous : les sensations ne sont pas autre chose que les modifications subjectives de notre âme, destinées à assurer, « par la voie courte et incontestable du sentiment », la conservation de notre corps. D'autre part, les corps ne sont point visibles en eux-mêmes, car le corps ne peut agir sur l'âme, et ce pour deux raisons, empruntées l'une à Descartes, l'autre à saint Augustin : corps et âme sont deux substances sans commune mesure, et le corps est inférieur à l'âme. Il reste donc que, lorsque nous croyons percevoir un corps, nous percevons en réalité une idée. Cette idée ne saurait être en nous, puisque l'idée est infinie et l'âme finie, puisque la connaissance par idée est claire, distincte, nécessaire, universelle, immuable, et nos modifications subjectives, finies, obscures, confuses, changeantes. C'est donc en Dieu que nous apercevons les idées des corps, qui sont des déterminations de l'idée d'étendue, ou étendue intelligible, archétype de la matière créée. Cette solution est conforme à la simplicité des voies, et elle assure notre entière dépendance à l'égard de Dieu, puisque c'est lui-même qui nous fait voir ce que nous voyons.
Mais, objectera-t-on, c'est par une perception sensible que je saisis les corps existants. Or, les sensations sont des modifications subjectives de mon âme. Comment dire, dans ces conditions, que la perception des corps soit leur vision en Dieu ?
Il faut ici distinguer l'idée elle-même d'avec l'effet, dans mon âme, de son efficace. Toute connaissance suppose que Dieu imprime l'idée dans mon âme, ce par quoi celle-ci subit une modification. Lorsque l'impression est légère, la modification l'est aussi, et la perception est intellectuelle, telle la perception des figures géométriques ; lorsque l'impression est profonde, la modification l'est aussi, et la perception est sensible, telle la perception des corps existants. Or, les sensations que l'idée produit en elle, l'âme les projette sur l'idée qu'elle aperçoit en Dieu. C'est ainsi que la connaissance sensible elle-même est vision en Dieu.
Il résulte de là que rien ne serait changé dans notre perception du monde des corps si Dieu anéantissait la matière, mais continuait d'affecter pareillement notre âme. Comme, d'autre part, Dieu ne renferme rien qui l'oblige de créer, l'existence de la matière est radicalement indémontrable, et seules l'attestent les Écritures. Descartes, on le sait, n'allait pas aussi loin, fondant sur la véracité divine la valeur objective de l'inclination qui nous fait poser la matière comme cause de nos sensations. Mais Malebranche lui conteste le droit d'étendre au sentiment la véracité divine.
La connaissance de Dieu
Voir les corps en Dieu, ce n'est pas voir l'être même de Dieu, car les idées ne sont les perfections de Dieu qu'en tant que celles-ci représentent les imperfections des créatures. Aussi bien la preuve essentielle de l'existence de Dieu (il en est de variées) s'appuie-t-elle sur l'irréductibilité du mode de notre connaissance de Dieu au mode de notre connaissance des corps. En effet, il n'y a d'idée que du créé ; il n'y a donc pas d'idée de Dieu ; pourtant, je connais Dieu ; par conséquent, je ne le connais point par idée, d'où il s'ensuit que je perçois directement son être. Autrement dit, contrairement aux corps, dont je puis avoir l'idée sans qu'ils existent, Dieu existe du moment que j'y pense.
En démontrant ainsi que nous ne connaissons pas Dieu par son idée, mais que nous avons l'intuition immédiate de son être, Malebranche s'oppose tant à Descartes qu'à Spinoza. Cette intuition nous est toujours présente, même si elle ne se précise que lorsque, nous détournant des objets finis, nous concentrons sur elle notre capacité finie de penser. Mais, à aucun degré, elle n'opère une fusion entre Dieu et mon âme, comme c'est le cas chez un Plotin, par exemple. Dieu reste une réalité extérieure à moi, qui affecte comme du dehors mon âme, en elle-même ténébreuse et passive.
D'autre part, encore que, voyant toutes choses en Dieu, Dieu nous soit, de ce fait, plus connu que les choses que nous imaginons le mieux connaître, la connaissance que nous avons de lui demeure inéluctablement imparfaite. D'abord, l'infinité dépasse la capacité finie de notre faculté de connaître. Certes, puisque notre raison est la Raison de Dieu, ce que nous connaissons clairement et distinctement, nous le connaissons « comme Dieu le connaît ». Mais nous ne connaissons pas tout ce que renferme son Verbe. En second lieu, puisque notre raison est le Verbe, nous ne connaissons directement de Dieu que ce que renferme son Verbe, c'est-à-dire d'une part la hiérarchie de ses perfections, ou ordre, d'autre part les idées des choses créées et leurs relations ou vérités éternelles. Nous ne percevons donc pas la simplicité absolue de son être, ni non plus la volonté divine, ni la toute-puissance de son efficace, puisqu'en Dieu la volonté est distincte du Verbe.
Partant, Dieu demeure d'une certaine façon le « Dieu caché, inconnu, invisible, et qui par conséquent ne paraît point être la cause efficace des effets visibles » (Prémotion physique).
Néanmoins, ce « Dieu caché » ne se dérobe point entièrement à notre connaissance rationnelle. Et c'est ici que la philosophie de Malebranche se révèle pleinement une philosophie chrétienne. Si la raison éclaire la foi pour les vérités que renferme le Verbe, en revanche la raison s'appuie sur la foi pour s'intégrer les vérités que le Verbe ne renferme point : « Que les philosophes [...] sont obligés à la religion, car il n'y a qu'elle qui les puisse tirer de l'embarras où ils se trouvent ! » (Entretiens métaphysiques)
Sans doute, les mystères de la Trinité, de l'Incarnation, de l'eucharistie nous demeurent incompréhensibles dans leur texture propre. Mais, en comblant très exactement, si l'on peut dire, les lacunes d'intelligibilité que la raison, livrée à elle-même, laisse subsister dans l'explication rationnelle de l'univers, les données de la foi, dès lors éclairées par la lumière, parachèvent cette explication. Le « Dieu caché », qui ne peut être aperçu directement dans la clarté du Verbe, devient l'objet d'une construction rationnelle indirecte, dont le point de départ est l'« expérience » de la foi, de même que l'expérience sensible est le point de départ de la physique dans la mesure où, étant la science des corps existants, elle ne se réduit point à la mathématique, qui est la science des essences.
La raison et la foi se prêtant un mutuel concours, la connaissance du Créateur devient possible, et, du même coup, celle de son ouvrage.
Le système de l'univers
Le souci de dégager Dieu de la responsabilité du mal inspire, pour l'essentiel, la construction malebranchiste du monde. Tâche d'autant plus ardue que, d'une part, on tient Dieu pour la seule cause efficace et que, d'autre part, se refusant à réduire, avec Descartes ou Leibniz, le mal à une simple apparence, à un simple defectus, on affirme son caractère positif.
Le nœud de la solution, c'est le principe de la simplicité des voies, lui-même fondé dans l'ordre, ou hiérarchie des perfections divines, auquel se subordonne le vouloir de Dieu.
L'ordre, certes, ne commande point à Dieu de créer, car l'infinitude de l'Être divin assure son autosuffisance. C'est donc par un libre décret que Dieu décide de sortir de lui-même, pour se glorifier dans un ouvrage que la personne divine qui s'unit à lui, par l'Incarnation, hausse au niveau de l'infini. Mais, supposé la libre décision de créer, l'ordre exige que Dieu produise l'ouvrage qui exprime le mieux la hiérarchie de ses attributs, c'est-à-dire l'ouvrage le plus parfait, compte tenu, non seulement de la perfection de l'ouvrage considéré en soi, mais aussi de la perfection des voies de son exécution. De ces deux perfections, la seconde est prévalente, car la conduite de Dieu, c'est Dieu lui-même, tandis que l'ouvrage n'est que son effet extérieur. Or, contrairement à Leibniz, fidèle à l'optimisme augustinien, Malebranche démontre que la perfection des voies ne coïncide point avec la perfection de l'ouvrage, que, tout au contraire, elle la limite. D'où l'existence du mal positif.
En effet, les voies expriment le mieux la perfection de l'Ouvrier lorsqu'elles sont les plus simples, c'est-à-dire lorsque Dieu agit par des volontés générales, autrement dit lorsqu'il exécute son ouvrage selon des lois générales, ou selon le rapport immuable qu'il institue entre telle cause occasionnelle, inefficace par elle-même, et tel effet. D'où les cinq lois générales du système de l' occasionnalisme, dont trois de la nature et deux de la grâce : les lois de la communication des mouvements, dont le choc des corps est la cause occasionnelle ; la loi de l'union de l'âme et du corps, les modifications de chacune de ces substances étant causes occasionnelles des modifications de l'autre ; la loi de l'union de l'âme avec la Raison universelle, dont la cause occasionnelle est l'attention ; la loi de la distribution des grâces du Nouveau Testament, dont les désirs de Jésus-Christ sont les causes occasionnelles ; enfin la loi de la distribution des grâces temporelles de l'Ancien Testament, dont les anges sont les causes occasionnelles. Dieu ne peut se dispenser d'agir selon ces lois que dans les cas, exceptionnels, où, s'il s'y conformait, le total de perfection, constitué par la somme des perfections de l'ouvrage et des voies, s'en trouverait diminué : il agit alors par des voies pratiques particulières, qui sont les miracles.
Or, une action par des lois générales ne permettant point un ajustement précis de l'action à son effet, elle a pour conséquence inéluctable des défauts dans l'ouvrage. Au surplus, la cause occasionnelle ne devant pas se confondre avec la cause véritable et seule efficace, ou Dieu, elle est nécessairement finie, voire imparfaite ; ce par quoi, d'ailleurs, la conduite de Dieu manifeste son excellence, l'ouvrage étant d'autant plus admirable qu'il est produit par de plus petits moyens. Le choc des corps est aveugle et nécessaire, d'où les désordres du monde physique ; l'attention de l'homme, éclairée et libre, est faillible, d'où les désordres du monde moral, l'erreur et le péché ; Jésus-Christ, comme cause occasionnelle, c'est-à-dire comme homme, est éclairé, libre et infaillible, mais il est fini, d'où la disproportion entre le degré de la grâce et celui de la concupiscence, qui a pour conséquence la limitation du nombre des élus.
Dieu ne veut donc point le mal, ne voulant que la perfection de l'ouvrage. Il ne fait que le permettre, et cela parce que, pour l'empêcher ou pour le corriger, il devrait agir par des volontés particulières pratiques, ce qui aurait pour effet de diminuer la perfection totale de la création.
La solution ainsi apportée au problème général du mal enveloppe une conception très profonde de la liberté de l'homme, seule responsable de l'erreur et du péché.
Ici encore, la tâche est ardue, car la volonté, loin de s'identifier, comme chez Descartes, avec la liberté, semblerait devoir l'exclure. En effet, la volonté de l'homme, c'est la volonté même de Dieu, c'est l'amour que Dieu se porte, traversant, pour ainsi dire, la créature. Or, Dieu s'aimant d'un amour nécessaire et invincible, notre volonté est par nature amour nécessaire et invincible de Dieu. Comment, dans ces conditions, trouver place pour notre liberté ? Ce à quoi s'ajoute une autre difficulté : comment concilier l'affirmation de la liberté de l'homme avec la concentration en Dieu de toute efficace ?
Deux ordres de considérations dénouent les problèmes :
– Tandis que la lumière qui éclaire la volonté de Dieu a son siège en Dieu, c'est hors de la créature que se situe la lumière qui éclaire sa volonté. De ce fait, celle-ci n'est, considérée en soi, qu'un mouvement aveugle et indéterminé, qu'il appartient précisément à la liberté et d'éclairer par la libre attention et de déterminer par le libre consentement au bien, vrai ou faux, la liberté supérieure étant celle du consentement au vrai bien.
– Tandis que la volonté a, pour reprendre les termes de Malebranche, une « réalité physique », la liberté, au contraire, a une réalité simplement « morale » ; partant, elle n'a point à être soutenue par l'efficace de Dieu.
Mais, dira-t-on, depuis le péché, qui a subordonné l'âme au corps, l'homme est incapable d'user de sa liberté ; la délectation prévenante de la grâce est nécessaire pour qu'il se porte à l'amour du vrai bien. Comment donc parler de la liberté du pécheur ? C'est que la grâce n'a d'autre effet que de remettre la liberté dans l'équilibre, en contrebalançant, par une « sainte concupiscence », la « concupiscence criminelle ». Ainsi, la grâce n'altère point la liberté du consentement à la grâce. Et le consentement libre à la grâce rend possible une nouvelle initiative de la liberté, par laquelle l'homme, s'élevant jusqu'à la connaissance rationnelle de Dieu, passe de l'amour du simple chrétien à l'amour du chrétien philosophe.
Le problème de l'infini et du fini
On vient de voir comment, qu'il s'agisse de la théorie de la connaissance ou du système de la Providence, Malebranche, se situant au point de vue de Dieu et récusant tout anthropomorphisme, s'efforce d'expliquer cette jonction de l'infini et du fini dont Descartes ne s'était occupé qu'à propos de la preuve de Dieu par les effets, c'est-à-dire fort peu.
Mais la difficulté de l'entreprise est à la mesure de sa grandeur. Ainsi, la lumière étant en Dieu, et mon âme, considérée en soi, n'étant que ténèbres, comment la lumière illuminante peut-elle devenir lumière illuminée ? L'idée est infinie, mais l'archétype des créatures finies ne doit-il pas être déterminé ? Dieu crée librement pour se glorifier, mais comment une volonté subordonnée à l'ordre peut-elle trouver hors de l'ordre un motif de son action ? Dieu est libre dans le choix de son dessein, mais l'ordre ne lui impose-t-il pas de créer « le composé de l'ouvrage entier joint aux voies » qui renferme le plus de perfection ? Dieu ne veut pas le mal, mais ne le veut-il point lorsqu'il choisit librement de faire passer à l'existence ce meilleur des mondes possibles dont il sait qu'il le renferme ? Réussit-on à rendre Dieu plus aimable lorsque, pour rejeter hors de sa volonté, dans sa sagesse, la raison du mal, on substitue au concept de l'incompréhensibilité des fins divines le mécanisme impersonnel d'une Providence où le souci de sa gloire interdit au Créateur de se pencher avec bonté sur chacune de ses créatures ?
D'autre part, s'il faut, pour parler de Dieu, repousser tout anthropomorphisme et n'écouter que la raison, il faut, pour parler de l'homme, consulter non seulement la raison, mais aussi le sentiment intérieur, dont l'enseignement, quoique obscur et confus, est incontestable. Or, ce que m'apprend ce sentiment ne s'accorde parfois que de loin avec ce que m'apprend la raison. Par exemple, je connais par la raison que, ma volonté étant la volonté de Dieu qui me traverse, elle est par nature amour de l'ordre ; mais je sais par le sentiment intérieur que le motif de mon vouloir, c'est le désir d'être heureux : comment ajuster exactement ces deux aspects de la volonté humaine ? Corrélativement, on voit, à côté d'une morale rationnelle, se dessiner une morale de l'inclination : quels sont leurs rapports précis ?
Mais il est clair que ce que la doctrine perd en rigueur systématique, elle le gagne en richesse, annonçant quelques-unes des intuitions les plus originales des philosophies à venir : la « conscience instinct divin » de Rousseau ; le caractère mystérieux de l'impératif catégorique, les distinctions kantiennes entre la volonté objective et la volonté subjective, entre ces deux degrés de la liberté que sont le libre arbitre et l'autonomie ; l'identification fichtéenne de la liberté avec un néant d'être ; la conception schellingienne de l'acte moral comme issu d'une lumière dont la liberté est la condition ; la rupture moderne de l'identité classique de l'être et de la valeur ; la réduction humienne du lien causal entre les choses à une illusion ; l'irréductibilité bergsonienne de la qualité aux variations quantitatives de l'excitant.
Enfin, la forte puissance de rationalisation du philosophe ne cesse jamais de dominer les ressources d'une imagination métaphysique remarquablement féconde et d'un sens psychologique particulièrement averti. S'il est donc vrai que le foisonnement des découvertes philosophiques ne se laisse pas enfermer dans une unité parfaitement systématique, cependant les grands ensembles s'équilibrent harmonieusement au sein de l'une des combinatoires les plus variées qu'un génie supérieur ait jamais conçues.
N'est-ce point là une leçon bien utile en des temps où certains se proclament d'autant plus proches de la « vraie » philosophie qu'ils raillent avec plus d'impertinence le souci de coordination, glorieux qu'ils sont de substituer à l'ajustement sévère des raisons le jeu facile des phraséologies et des vaines imaginations ?
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Ginette DREYFUS : professeur émérite à l'université de Haute-Normandie
Classification
Autres références
-
DE LA RECHERCHE DE LA VÉRITÉ, Nicolas Malebranche - Fiche de lecture
- Écrit par Francis WYBRANDS
- 829 mots
Nicolas Malebranche (1638-1715) occupe dans la lignée des philosophes post-cartésiens une place particulière. D'une part, il semble tout devoir à Descartes : la lecture, en 1664, du Traité de l'Homme fut en effet à l'origine de sa vocation philosophique. D'autre part, il s'en éloigne...
-
ÂME
- Écrit par Pierre CLAIR et Henri Dominique SAFFREY
- 6 021 mots
..., il tâche de donner à l'âme (esprit, pensée) son rôle le plus objectif. C'est toujours l'« union » qui préoccupe Rohault, Cally, Regis... et Malebranche. Celui-ci, attaché à une nature spirituelle, garde à l'âme sa généralité, qui renvoie à des corrélats tels que conscience, connaissance, sentiment... -
AUGUSTINISME
- Écrit par Michel MESLIN et Jeannine QUILLET
- 5 574 mots
Ainsi s'explique la tentative deMalebranche, à la rencontre d'un cartésianisme réputé augustinisant et d'un augustinisme dont le père Charles Martin avait tenté de démontrer qu'il était, avant la lettre, cartésien (dans sa Philosophia christiana, achevée en 1671). Avec une fidélité... -
CARTÉSIANISME
- Écrit par Pierre GUENANCIA
- 1 862 mots
...inutile et incertain » lorsqu'il prétend déduire d'un petit nombre de principes la nature de tous les phénomènes du monde visible. Il en va de même pour Nicolas Malebranche (1638-1715) que la lecture du Traité de l'homme (1633) a converti au cartésianisme dont il se montre fidèle disciple tant qu'il... -
CAUSALITÉ
- Écrit par Raymond BOUDON , Marie GAUTIER et Bertrand SAINT-SERNIN
- 12 990 mots
- 3 médias
...triomphe la dynamique, à la fois sur le plan mathématique et physique, que le principe de causalité commence à se lézarder : un coup rude est porté par Malebranche, admirateur de Descartes : si Dieu est liberté et que ses volontés soient inscrutables pour la raison humaine, nos « causes » ne sont que... - Afficher les 16 références
Voir aussi