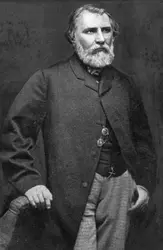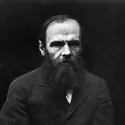NIHILISME
Article modifié le
Vers les années 1887-1888, alors que le développement de la société industrielle se poursuivait à un rythme accéléré sous l'impulsion d'une raison scientifique qui semblait garantir le progrès indéfini de la moralité et de la culture, le philosophe Nietzsche lançait ce cri d'alarme : « Ce que je raconte, c'est l'histoire des deux prochains siècles. Je décris ce qui viendra, ce qui ne peut manquer de venir : l'avènement du nihilisme » (XV, 137, éd. Kröner). Le drame annoncé par Nietzsche s'est produit. Quand Freud examine, à la lumière des découvertes psychanalytiques, « le malaise dans la civilisation », ce malaise est un symptôme du nihilisme. D'un autre côté, lorsque Husserl réfléchit sur « la crise de la conscience européenne » et s'inquiète du démantèlement de la rationalité, c'est encore le nihilisme qu'il débusque. L'audience qu'a rencontrée la philosophie dite « existentialiste », avec ses thèmes privilégiés : l'angoisse, la nausée en face de la contingence, la hantise de l'absurde, confirme que l'humanité est entrée dans l'ère des grandes convulsions.
Le mot nihilisme évoque spontanément les idées de négation, de destruction, de violence, de suicide et de désespoir. Camus a souligné les affinités entre nihilisme et révolte. On devine que cette crise nihiliste procède des événements qui ont, depuis la Réforme et la Renaissance, miné la représentation médiévale, anthropocentrique et théologique, du monde. La proclamation de Nietzsche : « Dieu est mort » traduit cette soudaine prise de conscience que la foi chrétienne a perdu son fondement et que tout notre système de valeurs s'en trouve déséquilibré. On devine également que les horreurs du dernier demi-siècle reflètent l'anxiété morbide qui ronge l'âme moderne et la volonté fanatique d'échapper à cette détresse en imposant, par la force des armes ou la contrainte idéologique, un nouveau système de valeurs capable de redonner un sens à l'existence humaine. Mais on n'arrive pas à former un concept précis du nihilisme en l'absence d'une méditation philosophique radicale. C'est ici que Nietzsche, en tant que prophète et théoricien du nihilisme, apporte à la pensée moderne une contribution d'envergure. Certes, d'autres explications ont pu, depuis, être avancées ; il n'empêche que toute analyse du nihilisme entre dans le sillage de Nietzsche. Car c'est Nietzsche qui, en prouvant l'enracinement du nihilisme dans l'Idéal métaphysique, a ouvert le chemin vers l'essence du nihilisme et donc vers la possibilité de son dépassement.
Le nihilisme, essence de la modernité
On peut aller chercher très loin, dans l'histoire et dans la légende, les précurseurs du nihilisme : citer, par exemple, Prométhée, Caïn, rappeler les doctrines d'Épicure et de Lucrèce, la gnose ; plus près de nous, évoquer Sade ou le Méphistophélès de Goethe, dégager le rôle du dandysme et du romantisme. Le mot lui-même se rencontre chez F. H. Jacobi et chez Jean-Paul, qui l'utilise pour caractériser la poésie romantique. Mais il importe surtout de voir que l'esprit de rébellion, l'immoralisme, la justification du meurtre et le défi lancé au monde ne prennent une tonalité nihiliste qu'à partir de la fin du xviiie siècle ; c'est dire que le nihilisme, dans son principe, est un phénomène moderne, un phénomène que Paul Bourget, dans ses Essais de psychologie contemporaine, décrivait déjà, en 1885, comme « une mortelle fatigue de vivre, une morne perception de la vanité de tout effort ».
Révolte et nihilisme
En fait, le nihilisme commence à prendre conscience de soi lorsque D. I. Pissarev déclare la guerre aux institutions et à la culture existantes et lorsque V. G. Biélinski a l'audace d'écrire : « La négation est mon dieu. » Il en découle le refus de toute autorité qui n'émane pas du jugement individuel. Sous l'influence de Max Stirner, le pressentiment de la catastrophe incita les esprits les plus lucides à chercher refuge dans l'exaltation du moi. Mais derrière ce narcissisme hautain et vindicatif se profile l'ombre de l'absurdité universelle. Tourgueniev, dans Père et fils (1860), imagine le personnage de Bazarov, qui laisse s'épancher une amertume proprement schopenhauerienne : « Nous n'avons à nous glorifier que de la stérile conscience de comprendre, jusqu'à un certain point, la stérilité de ce qui est. » On ne supporte plus le réel, parce que le réel est maintenant privé de justification. La contradiction s'accuse entre l'attente humaine et l'inhumanité du monde. Tout dépend alors de l'attitude que l'on adopte en face de cette découverte. On peut s'abîmer dans une méditation morose sur la vanité de toute vie. Dostoïevski, dans les « Carnets » de Crime et châtiment, note : « Le nihilisme, c'est la bassesse de la pensée. Le nihiliste, c'est le laquais de la pensée. » Mais on peut aussi joindre conscience de l'absurde et protestation : dévoilant dans l'injustice sociale la cause du nihilisme, on assume la tâche de détruire le vieux monde afin d'instaurer une nouvelle image de l'homme. Le nihilisme fait se dresser le héros révolutionnaire. Bismarck mesure bien le danger : « Le zèle nihiliste vers la destruction de tout ce qui existe trouve effectivement dans les abus du gouvernement russe une nourriture abondante. » Mikhail Bakounine aide à comprendre cette relance de la négation en affirmation quand il avertit fièrement que « la passion de la destruction est une passion créatrice ». Mais la négativité déploie ses propres conséquences, en deçà des motivations généreuses : l'utopie bakouniniste d'un monde de l'anarchie qui serait la glorification de la liberté absolue, justifie à l'avance, dans la mesure où elle requiert la médiation d'une dictature implacable, les théories d'un Sergheï Netchaïev qui, de l'absolutisation de l'idéal révolutionnaire, déduisait le « tout est permis » où le cynisme des bureaucraties totalitaires puisera une apparence de légitimité rationnelle. Tous les révolutionnaires n'éprouvent pas les scrupules des authentiques martyrs que furent Ivan Kaliaïev et Voinarovski. Déjà, chez Tkatchev, on glisse à une conception militaire du socialisme, où le nihilisme se pare des prestiges fallacieux du rendement et de l'efficacité. Le terrorisme étatique est bien fils du nihilisme.
Dieu est mort
Le fou qui, dans Le Gai Savoirde Nietzsche, apostrophe les passants, une lanterne à la main, en criant : « Je cherche Dieu ! » et qui, blessé des moqueries de ses auditeurs, leur jette au visage l'accusation : « Nous sommes tous les assassins de Dieu » est un héros nihiliste. Il proclame « la mort de Dieu », c'est-à-dire que « la croyance au dieu chrétien est tombée en discrédit » (V, 271). Certes, pour les esprits bien trempés, cet événement marque l'abolition des anciens dogmes, donc l'émancipation de l'homme, qui recouvre l'exercice de ses vertus créatrices si longtemps aliénées en Dieu. Mais puisque la mort de Dieu, représentée symboliquement, est aussi un meurtre, auquel a poussé la volonté de vengeance (on reconnaît là le drame du « plus hideux des hommes » mis en scène dans Ainsi parlait Zarathoustra), elle est hypothéquée par de dangereuses équivoques, qui ne manquent pas de développer leurs conséquences funestes : l'homme, affronté à ce vide, ne sera-t-il pas tenté, à l'exemple de Kirilov, un des « possédés » de Dostoïevski, de se déifier lui-même par un suicide de provocation et de blasphème ? Ou encore, ne se précipitera-t-il pas dans une agitation furieuse, comme celle qui mobilise autour d'une prétendue Grande Idée – en vérité simple baudruche idéologique – les membres de l'Action parallèle et son animatrice Diotime, dans le roman de Robert Musil, L'Homme sans qualités ? La surenchère morale n'est-elle pas un narcotique précieux pour se dissimuler l'inanité d'un monde déserté par le divin ? Hermann Broch a dépeint avec une rare maîtrise toute la gamme des ivresses frelatées et des capitulations plus ou moins ignominieuses que provoque l'irruption du nihilisme. Le Huguenau des Somnambules, criminel qui « achève naïvement son rêve d'enfance dans la réalité », préfigure le Marius du Tentateur chez qui le crime revêt la sauvagerie préhistorique d'un sacrifice rituel. On débouche alors inéluctablement sur la trilogie du nazisme dénoncée par Rauschning dans sa Révolution du nihilisme : « La mort de la liberté, la domination de la violence et l'esclavage de l'esprit. » Devant une telle désolation, comment ne pas se souvenir de l'avertissement de Nietzsche : « Si nous ne faisons pas de la mort de Dieu un grand renoncement et une perpétuelle victoire sur nous-mêmes, nous aurons à payer pour cette perte » (XII, 167) ?
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Jean GRANIER : agrégé de philosophie, docteur ès lettres, professeur à l'université de Rouen
Classification
Médias
Autres références
-
AINSI PARLAIT ZARATHOUSTRA, Friedrich Nietzsche - Fiche de lecture
- Écrit par Philippe GRANAROLO
- 1 270 mots
...Surhumain : preuve en est qu’aussitôt après avoir prononcé un discours enflammé sur le Surhomme, il se lance dans la peinture du « dernier homme », l’homme du nihilisme achevé, une forme d’humanité étriquée et dégénérée, dont la venue est infiniment plus vraisemblable que celle du Surhumain. -
ANTI-ART
- Écrit par Alain JOUFFROY
- 3 064 mots
- 1 média
-
LES DÉMONS, Fiodor Dostoïevski - Fiche de lecture
- Écrit par Louis ALLAIN
- 1 334 mots
- 1 média
La leçon que Dostoïevski a voulu donner dans son roman est à la fois esthétique et politique.Le refus du Christ conduit au nihilisme, qui est à son tour vecteur de chaos et de néant. Cette idée simple, Dostoïevski, ancien fouriériste des années 1840 et condamné comme tel à quatre ans de travaux... -
LE GAI SAVOIR, Friedrich Nietzsche - Fiche de lecture
- Écrit par Francis WYBRANDS
- 810 mots
...traduit la fin d'une époque dans l'histoire européenne dont Platon, pour Nietzsche, fut un des commencements, inaugurant l'ère de la métaphysique. Mort du suprasensible, mort des idées et des idéaux sur lesquels vécut toute une civilisation, commencement du « nihilisme », telle se présente la « mort... - Afficher les 18 références
Voir aussi