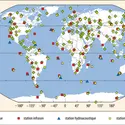NUCLÉAIRE Déchets
Article modifié le
Stockage profond des déchets
Principe de fonctionnement d'un stockage
La loi de 2006 a retenu le stockage profond réversible comme solution de référence pour la gestion des déchets HA-MA-VL. Il s'agit d'isoler les déchets des activités humaines courantes, de les mettre à l'abri des effets de l'érosion, de limiter les circulations d'eau au voisinage des colis pour ralentir leur dégradation et leur dissolution, puis retarder ou atténuer la migration des radionucléides. Un stockage profond comporte des puits verticaux ou une descenderie qui permettent d'accéder, à plusieurs centaines de mètres de profondeur, à la « couche hôte », appartenant à une formation géologique stable, et choisie parce que les circulations d'eau y sont extrêmement faibles et lentes. Un ensemble de galeries sont creusées. L'emprise horizontale de l'ouvrage peut être de plusieurs centaines d'hectares. Les galeries permettent d'accéder aux alvéoles, de plusieurs dizaines de mètres de longueur, où sont placés les colis de déchets, dits de stockage. Les vides résiduels des alvéoles sont progressivement comblés par de l'argile gonflante, l'accès des alvéoles est scellé, puis on comble les galeries d'accès et les puits. Un à quelques siècles après sa création, le stockage peut être fermé. Il est conçu pour qu'aucune surveillance ultérieure ne soit nécessaire.
Le fonctionnement du stockage repose donc sur des barrières successives : la matrice et son conteneur, produits de l'industrie humaine, susceptibles d'être caractérisés de façon détaillée, mais dont les performances à très long terme ne peuvent être prouvées par l'expérience directe ; les argiles gonflantes remaniées, mises en place pour combler les vides résiduels ; le massif rocheux, que l'on ne connaît que par sondage, mais qui a été choisi pour avoir, pendant plusieurs dizaines de millions d'années, subi l'épreuve de sollicitations mécaniques, thermiques, hydrauliques et géochimiques, dont on peut évaluer les effets. Ces barrières sont de natures différentes, ce qui est un avantage, car les moyens de les connaître et la démonstration de leurs qualités ne reposent pas sur une seule discipline scientifique ou une seule famille de techniques d'investigation.
Dans le cas du projet de stockage dans le Callovo-Oxfordien de l'est de la France, la couche hôte, qui paraît présenter une grande continuité horizontale, est composée d'environ 40 p. 100 d'argile, 30 p. 100 de calcaire et 30 p. 100 de quartz et feldspath. Elle a été étudiée au voisinage du village de Bure, à la limite de la Meuse et de la Haute-Marne, par des méthodes géophysiques de surface, plusieurs dizaines de forages profonds et des expériences conduites dans un laboratoire souterrain, à 500 mètres de profondeur, accessible depuis 2004.
La période pendant laquelle le stockage est ouvert dans une telle couche est marquée par l'introduction dans le sous-sol de matériaux exogènes qui perturbent son état naturel : colis, acier, argiles, béton et air de ventilation. Ce dernier introduit des bactéries nouvelles, engendre des conditions provisoirement oxydantes, désature la roche dans le voisinage des galeries déjà affecté par un endommagement consécutif au creusement. Certains colis dégagent de la chaleur. L'augmentation de la température déplace les équilibres physiques et chimiques, accélère la cinétique des réactions, engendre des contraintes thermiques dans le massif ou les colis.
La fermeture du stockage marque le début d'un lent retour au quasi-équilibre antérieur, pourtant durablement ralenti par la poursuite du dégagement de chaleur, dont les effets restent sensibles pendant quelques millénaires, et par la génération de gaz de corrosion (hydrogène) quand de l'eau commence à être disponible au voisinage des colis ou des parties métalliques des soutènements. Les matrices cimentaires dégradées relâchent des éléments alcalins qui créent un environnement chimique de pH élevé, et le fer des conteneurs interagit de manière complexe mais très locale avec les argiles. Toutefois pendant une période initiale de quelques milliers d'années, l'apport d'eau reste très faible, ou très inégal suivant les zones considérées, en raison de la désaturation initiale du massif. Lorsque l'eau est disponible, les argiles naturelles remaniées gonflent et assurent leur fonction de scellement ; mais l'eau permet aussi la dégradation des enveloppes des colis et la dissolution des matrices qui contiennent les déchets. On a établi, par des expériences de laboratoire, que le début de la dissolution des verres se fait avec des vitesses de quelques micromètres par an ; le verre forme ensuite avec l'eau une pellicule superficielle d'hydroxydes qui réduit de plusieurs ordres de grandeur les vitesses initiales.
La dissolution du verre rend possible la migration des radionucléides. On pense que cette migration sera extrêmement lente, la couche hôte étant très peu perméable, mais on doit analyser les effets possibles de courts-circuits : fractures naturelles conductrices ; anneau de roches derrière les parois qui court le long des galeries, mécaniquement endommagé et rendu plus perméable pendant l'excavation, dont on peut interrompre la continuité hydraulique en disposant judicieusement des scellements. La perméabilité de la couche hôte intacte paraît même être si faible (les déplacements naturels de l'eau sont inférieurs au décimètre par 100 000 ans) que le transport des radionucléides hors de la zone de stockage se ferait essentiellement par diffusion dans l'eau contenue dans les pores de l'argile. Les actinides, très peu solubles dans cette eau réductrice, ne se déplaceraient que de quelques mètres en 100 000 ans. Les feuillets d'argile, chargés électriquement, présentent une très grande surface d'échange avec l'eau et les ions qu'elle contient : des cations sont fixés sur la surface ; les anions sont repoussés de sorte qu'ils ne disposent pour diffuser que d'une fraction réduite de la porosité totale. Ainsi seuls quelques radionucléides solubles et non retenus par l'argile (239I, 36Cl, produits d'activation) atteindraient en quantité appréciable les limites de la couche, puis, à la surface du sol, les exutoires des nappes d'eau souterraines, après une durée de l'ordre de 100 000 ans.
Spécificités du problème du stockage profond
La conception d'un système de cette nature, caractérisé par l'intervention d'un grand nombre de phénomènes, éventuellement couplés, et par la coexistence au sein d'un massif naturel de matériaux exogènes variés, doit être inspirée par quelques principes généraux.
Le premier est la redondance : il est souhaitable que la même fonction puisse être remplie par plusieurs composants aussi indépendants que possible les uns des autres. Certaines fonctions toutefois sont assurées par plusieurs barrières ensemble : le caractère réducteur de la barrière géologique, par exemple, crée des conditions favorables à la pérennité des conteneurs. Le rôle des barrières évolue au cours du temps : à chacune d'elle doivent pouvoir être allouées une performance attendue et une estimation de la durée pendant laquelle cette dernière sera assurée.
Le second principe est la robustesse : le système doit être peu sensible aux perturbations. On choisit ainsi une profondeur largement suffisante pour rester à l'abri de l'érosion. De même, le stockage et son évolution sont représentés par un ensemble de relations mathématiques qui décrivent les phénomènes attendus ; ils fournissent des estimations du débit de dose aux exutoires des eaux souterraines et d'autres grandeurs intermédiaires utiles (température, contraintes, débit d'eau, vitesses de diffusion). Ce système doit être stable : les valeurs atteintes par les grandeurs les plus significatives du point de vue de la sûreté du stockage doivent être peu sensibles aux modifications des hypothèses faites, au choix des paramètres, au choix des modèles eux-mêmes et, sur un autre plan, aux techniques de résolution numérique.
Le troisième principe est la prudence : elle conduit à se doter de marges, par exemple dans l'épaisseur des matériaux ou le nombre de scellements ; à choisir pour les calculs, en cas d'incertitudes, les valeurs les plus défavorables ; et à examiner, au moins à titre de variante, les effets d'un choix systématiquement pessimiste de ces valeurs ou de scénarios extrêmes tels que l'intrusion humaine involontaire.
Le quatrième principe est la simplicité, qui facilite la démontrabilité. Ainsi des réticences ont pu être formulées à l'égard du stockage dans le granite en France, malgré les avantages génériques de cette roche, car il pourrait exiger la mise au point de techniques de reconnaissance et de modélisation non encore disponibles, ou le choix d'architectures compliquées (dans les pays scandinaves, dont le sous-sol est granitique, le système de stockage est rééquilibré par le choix d'un sur-conteneur en cuivre de très longue durée de vie). Le cinquième est la flexibilité, qui sera évoquée à propos de la réversibilité.
Le caractère exceptionnel du problème posé par le stockage des déchets radioactifs – que ceux-ci partagent avec les déchets toxiques chimiques – tient à la durée très longue pendant laquelle la protection des personnes et de l'environnement doit être assurée, et notamment, pendant laquelle la concentration en radionucléides des eaux aux exutoires doit rester nulle ou très faible. Quelque longue qu'elle soit, cette durée n'est toutefois pas indéfinie – au contraire du cas des déchets chimiques – en raison de la décroissance naturelle de l'activité. Dans la pratique, les calculs sont conduits pour une période d'un million d'années mais, après 10 000 ans, l'activité a déjà très substantiellement diminué. Ces durées n'en sont pas moins presque incommensurables avec celles qui intéressent ordinairement les activités humaines. Elles soulèvent la question de l'extrapolation. On dispose de cas d'ouvrages et de matériaux élaborés par l'homme il y a plusieurs milliers d'années et qui ont survécu malgré des conditions parfois sévères ; mais l'ingénieur n'envisage pratiquement jamais des ouvrages dont la durée de vie soit supérieure au siècle. La géologie permet d'expliquer, souvent dans le détail, la genèse et l'évolution des formations naturelles ; mais il s'agit, comme pour l'Histoire, d'une analyse à rebours. Les phénomènes qui résultent des évolutions astronomiques, comme le retour des périodes glaciaires, peuvent être prévus avec une très grande précision ; ceux qui résultent de l'activité humaine sont beaucoup plus difficiles à prédire.
Ces difficultés peuvent être abordées de diverses manières. L'une consiste à rechercher, pour évaluer les propriétés des matériaux du stockage, une qualité expérimentale exceptionnelle. Les données obtenues ne se prêtent toutefois à l'extrapolation que lorsqu'elles sont complétées par la compréhension des mécanismes qui régissent l'évolution des matériaux à l'échelle microscopique. On peut aussi tirer parti des phénomènes analogues historiques ou géologiques (un réacteur nucléaire naturel a fonctionné à grande profondeur à Oklo, au Gabon, il y a deux milliards d'années : la migration ultérieure des actinides formés a été très limitée). De plus, une connaissance parfaite de la totalité des phénomènes n'est pas toujours absolument nécessaire : on peut vérifier que certains d'entre eux ne jouent qu'un rôle mineur ; ou bien on peut en encadrer les effets d'une façon suffisamment certaine pour obtenir un majorant ou un minorant qui suffiront aux calculs. On peut aussi, lorsqu'une incertitude importante subsiste sur les performances d'un composant particulier, se doter de marges de sécurité plus grandes sur un autre composant qui remplit une fonction analogue.
L' assemblage des connaissances est assuré, à un moment donné, par l'analyse de sûreté. Il s'agit d'un exercice, conduit périodiquement, dans lequel l'ensemble des connaissances scientifiques et techniques, l'inventaire des déchets à stocker et la conception envisagée des ouvrages sont rassemblés d'une manière critique, en les accompagnant d'une estimation des incertitudes qui les affectent encore. L'analyse de sûreté comporte des calculs numériques de l'évolution du stockage et du massif dont les résultats permettent de repérer les incertitudes les plus pénalisantes et d'orienter les études ultérieures vers leur réduction. L'Andra a réalisé dans le « Dossier Argile 2005 » un exercice de ce type pour un stockage qui serait réalisé dans une couche d'argilite du Callovo-Oxfordien ; les estimations de débit de dose obtenues sont très inférieures à la valeur de 0,25 mSv/an retenue par les règles de sûreté.
La question de l'acceptabilité
En France, la question des déchets radioactifs a longtemps été discutée par les seuls experts. À la suite des réactions, dans les années 1980, des populations concernées par la recherche de sites favorables au stockage, la question a été placée dans le seul cadre adéquat pour un pays démocratique, en confiant à la représentation nationale l'organisation du débat et la responsabilité des choix majeurs. La loi du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs, dite loi Bataille du nom de l'un de ses rapporteurs, a fixé les orientations générales des recherches et un calendrier. Une seconde loi, loi de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, a été adoptée par le Parlement le 28 juin 2006, dans les délais prévus en 1991.
La fin du xxe siècle a vu des évolutions profondes des mentalités marquées par la critique radicale des fonctionnements reposant sur la seule autorité – même légitimée par la compétence – ; l'essor de l'environnementalisme ; l'aspiration des citoyens à une participation plus directe et décentralisée au débat démocratique, notamment pour les décisions qui les concernent directement. Sont posées les questions d'une juste contrepartie aux inconvénients locaux d'une décision conforme à l'intérêt collectif national ; d'une information claire, complète et objective ; et de l'étendue des marges que les projets peuvent laisser à des inflexions d'initiative locale. La loi de 2006 a veillé à apporter des réponses à ces préoccupations.
Ce sont des domaines où les démocraties du nord de l'Europe ont souvent montré l'exemple. La réversibilité du stockage pourrait être l'occasion d'une contribution française. La réversibilité prévoit que, même si le stockage doit être conçu pour être définitif, on doit ménager au cours de sa construction des étapes à l'occasion desquelles il peut être décidé de revenir en arrière, d'attendre ou au contraire de passer à l'étape suivante. Elle implique une grande flexibilité, la mise en œuvre d'une surveillance qui permette de fonder les décisions successives et une conception du stockage qui autorise un retrait des colis avec une facilité proportionnée à l'étape atteinte. La réversibilité est inscrite dans la loi de 2006. Le vote d'une loi qui en précise les conditions accompagnera le choix éventuel d'un site de stockage profond qui pourrait être mis en service en 2025. Le début de réalisation d'un stockage profond apparaîtrait alors comme la meilleure solution qu'ait trouvée notre génération au problème des déchets radioactifs les plus dangereux ; après en avoir assumé sa part de contraintes et de coûts, elle proposerait à la génération suivante, parmi d'autres, l'option de poursuivre sa mise en oeuvre.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Pierre BEREST : ingénieur général des Mines, directeur de recherche à l'École polytechnique
- Jean-Paul SCHAPIRA : directeur de recherche au C.N.R.S., codirecteur du groupement de recherche G.E.D.E.O.N. (gestion des déchets par les options innovantes) entre le C.E.A., le C.N.R.S., E.D.F. et Framatome
Classification
Médias
Autres références
-
NUCLÉAIRE (notions de base)
- Écrit par Encyclopædia Universalis
- 4 131 mots
- 18 médias
Depuis la découverte de la radioactivité en 1896 par Henri Becquerel et celle du noyau atomique par Ernest Rutherford en 1911, des progrès scientifiques importants ont été accomplis en physique nucléaire. La maîtrise des réactions nucléaires a permis en particulier, dès le milieu du xxe siècle,...
-
FRANCE - L'année politique 2021
- Écrit par Nicolas TENZER
- 6 172 mots
- 5 médias
...octobre, Emmanuel Macron présente un plan d’investissement « France 2030 » dont le but est de « faire émerger les futurs champions technologiques de demain ». Après un moment d’hésitation, il annonce en novembre un plan de relance du nucléaire, destiné à répondre aux défis de l’indépendance énergétique du pays... -
TICE (Traité d'interdiction complète des essais nucléaires) ou CTBT (Comprehensive Test Ban Treaty)
- Écrit par Dominique MONGIN
- 936 mots
- 1 média
Le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (T.I.C.E.), ou Comprehensive Test Ban Treaty (C.T.B.T.), est un traité multilatéral élaboré dans le cadre de la Conférence du désarmement de l’Organisation des Nations unies (O.N.U.). Il a été ouvert à la signature des États en...
Voir aussi
- CIBLE, physique
- SÉCURITÉ
- ACCÉLÉRATEURS DE PARTICULES
- NUCLÉAIRE CHIMIE
- NOYAU ATOMIQUE
- STOCKAGE
- RÉACTEUR À EAU PRESSURISÉE (REP) ou PWR (pressurised water reactor)
- RADIOÉLÉMENTS ou RADIONUCLÉIDES ou ISOTOPES RADIOACTIFS
- VITRIFICATION, génie nucléaire
- RECYCLAGE DES DÉCHETS ET DES MATÉRIAUX
- RÉACTEUR À NEUTRONS RAPIDES (RNR)
- ANDRA (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs)
- BURE LABORATOIRE SOUTERRAIN DE
- NUCLÉAIRES RÉACTIONS
- RADIOBIOLOGIE
- SECTION EFFICACE
- CAPTURE DE NEUTRONS
- COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE
- ACTINIDES
- FISSION NUCLÉAIRE
- FISSILES MATÉRIAUX
- PÉRIODE ou DEMI-VIE, radioactivité
- ACTIVITÉ, physique nucléaire
- DOSE, radiobiologie
- FRANCE, géologie
- ASN (Autorité de sûreté nucléaire)
- STOCKAGE GÉOLOGIQUE DES DÉCHETS NUCLÉAIRES
- ENVIRONNEMENT, droit et politique
- FRANCE, droit et institutions
- RETRAITEMENT, génie nucléaire
- RÉACTEUR NUCLÉAIRE
- NUCLÉAIRE INDUSTRIE
- FISSION PRODUITS DE
- CONDITIONNEMENT, génie nucléaire
- DÉCHETS RADIOACTIFS ou DÉCHETS NUCLÉAIRES
- CONTENEUR ou CONTAINER
- TRANSMUTATION, physique nucléaire
- DÉSINTÉGRATION, physique
- CYCLE, génie nucléaire
- SÛRETÉ NUCLÉAIRE
- RISQUES TECHNOLOGIQUES