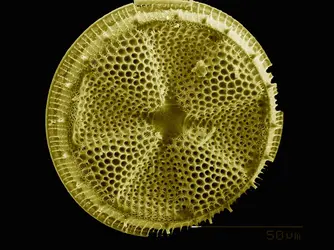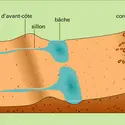OCÉAN ET MERS (Vie marine) Vie benthique
Article modifié le
Reproduction et développement larvaire
Quand une espèce benthique a résolu ces deux problèmes, trouver à « se loger » et trouver une nourriture convenable en qualité et en quantité, il lui reste à assurer son avenir, c'est-à-dire à se reproduire ; pour cela deux procédés sont possibles, la multiplication asexuée et la reproduction sexuée.
La multiplication asexuée est un processus relativement simple et, dans l'immense majorité des cas, plus rapide que la sexualité. Elle existe chez d'assez nombreuses algues unicellulaires, ou même supérieures, ainsi que chez certaines phanérogames marines. Chez les animaux, elle caractérise bien entendu toutes les formes coloniales (hydroïdes, alcyonaires, zoanthaires, bryozoaires, ascidies composées), mais aussi certaines formes dites sociales, chez lesquelles les individus sont seulement juxtaposés (diverses polychètes, phoronidiens, certaines ascidies). La multiplication asexuée, répandue surtout parmi les formes sessiles, représente un processus avantageux pour l'occupation d'une surface maximale du substrat dans le minimum de temps.
La reproduction sexuée implique des mécanismes autrement complexes et délicats. Et, tout d'abord, il faut que l'individu se trouve dans une ambiance favorable vis-à-vis de divers facteurs du milieu, notamment la température. Il y a des marges thermiques, souvent assez limitées, qui conditionnent toutes les phases de la reproduction sexuée : la maturation des produits sexuels, leur émission dans le milieu extérieur s'il n'y a pas accouplement, la fécondation, et, de façon plus stricte encore, les premiers stades du développement de l'œuf fécondé. Ainsi s'explique la distribution géographique des espèces, pas seulement benthiques du reste, dans les mers froides, chaudes, tempérées (ces dernières caractérisées par des écarts saisonniers plus ou moins importants de la température). Ainsi s'explique aussi que la plupart des espèces ne se reproduisent qu'à une période déterminée de l'année, période qui correspond justement aux températures optimales des phases initiales de la reproduction énumérées précédemment. Chez les espèces benthiques, l'hermaphrodisme est assez répandu, surtout parmi les formes fixes ; il est évident que le rendement de la reproduction sexuée s'en trouvera doublé, bien que la fécondation croisée demeure la règle.
Une fois que les œufs ont été fécondés et que l'embryon a commencé à se développer, le problème de l'avenir de l'espèce n'est pas résolu pour autant. Évidemment, chez les espèces vivipares, ou chez celles dites à développement direct, espèces dont les jeunes sont identiques, à la taille près, à leurs géniteurs, ces jeunes se trouvent ipso facto libérés dans un milieu convenant à l'espèce puisque les géniteurs ont pu y vivre et s'y reproduire. Toutefois il faut souligner que cette sécurité relative du développement a une contrepartie dans le fait que, chez ces espèces, la fécondité est toujours assez faible. La plupart du temps, les œufs ont été libérés dans le milieu, soit qu'ils flottent au voisinage de la surface, soit qu'ils soient déposés sur le fond, groupés ou non en pontes (parfois protégées par des dispositifs divers). Au cours d'une première phase de développement, l'embryon vit aux dépens des réserves de l'œuf, puis celui-ci éclôt et il en sort une larve, dont souvent la morphologie diffère profondément de celle de l'individu parfait, et qui mène pendant un temps plus ou moins long (de quelques heures à quelques mois) une vie planctonique. Fréquemment, il existe plusieurs formes larvaires au cours du développement, par exemple chez les crustacés (larves nauplius, zoé et mysis). Arrivées au terme de leur vie planctonique, les larves subissent une métamorphose, à la fois morphologique, écologique (passage de la vie pélagique à la vie benthique) et physiologique (portant en particulier, le plus souvent, sur un profond changement du régime alimentaire).
Ces larves, pour croître, se nourrissent généralement aux dépens d'autres organismes du plancton, mais il arrive aussi qu'elles se bornent à achever de consommer, au cours de leur vie pélagique, les réserves que l'organisme maternel avait accumulées dans l'œuf. Dans ce dernier cas, la durée de vie dans le plancton correspond pour l'espèce à une phase de dispersion : les larves, transportées par les courants, peuvent étendre l'aire de distribution de l'espèce, pour autant qu'elles rencontrent, au moment de leur métamorphose, les conditions de milieu favorables à la vie des individus parfaits, notamment en ce qui concerne la nature du substrat ; les œufs, qui doivent être riches en réserves, sont gros et la fécondité sera donc faible. Dans le premier cas, au contraire, le stade planctonique correspond non seulement à des possibilités de dispersion de l'espèce beaucoup plus importantes, puisque le stade planctonique est plus long, mais encore à un accroissement de taille de la larve ; les œufs peuvent donc être petits puisque la larve, pour atteindre la taille correspondant à la métamorphose, tire sa nourriture du milieu extérieur, et non plus seulement des réserves de l'œuf ; l'ovaire peut donc introduire un plus grand nombre d'œufs ; la fécondité est élevée.
Ce type de développement – larves séjournant longuement dans le plancton et s'y nourrissant – est évidemment plein de dangers, car plus les larves restent longtemps dans le plancton, plus elles risquent d'y rencontrer des conditions de milieu défavorables (variations de température, de salinité), plus elles risquent aussi d'être entraînées par les courants loin des fonds propices à leur métamorphose et plus elles risquent d'être victimes d'autres animaux vivant dans le plancton, ou encore de ne pas trouver dans ce plancton, à un moment ou à un autre, la nourriture qui leur convient. Malgré tous ces inconvénients, qui entraînent parfois une « mortalité infantile » absolument extravagante et qui justifie le nombre prodigieux d'œufs produits par certaines espèces, le type de développement avec stade pélagique prolongé offre des avantages tels, du point de vue de la dispersion et de l'accroissement individuel des larves, qu'il est le plus répandu ; dans les mers tempérées, les espèces à larves séjournant longtemps dans le plancton et s'y nourrissant représentent environ les quatre cinquièmes de l'ensemble de la faune benthique, et la proportion est plus forte encore dans les mers tropicales ; c'est seulement dans les mers polaires, où la pullulation du plancton est brève, que ces espèces sont minoritaires par rapport aux formes à développement direct ou incubatrices.
On connaît même des gastéropodes abyssaux qui ont un stade larvaire de longue durée : les œufs et les jeunes larves parcourent plusieurs kilomètres à la verticale pour venir mener une vie pélagique aux dépens du plancton de surface, où elles se nourrissent et grandissent pendant quelques semaines, avant de regagner les profondeurs abyssales et de s'y métamorphoser.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Lucien LAUBIER : professeur émérite à l'université de la Méditerranée, Marseille
- Jean-Marie PÉRÈS : membre de l'Institut de France, commandeur de la Légion d'honneur, professeur émérite de l'université de la méditerranée Aix-Marseille-II
Classification
Médias
Autres références
-
ACCUMULATIONS (géologie) - Accumulations marines
- Écrit par Jean-Pierre PINOT
- 7 917 mots
- 26 médias
Les accumulations marines résultent soit de la sédimentation, soit de la construction biologique (cf. récifs).
La sédimentation est l'abandon de matériaux meubles en cours de transport. L'agent de transport, s'il s’exerce de manière temporaire, donne lieu à des accumulations...
-
ACIDIFICATION DES OCÉANS
- Écrit par Paul TRÉGUER
- 2 202 mots
- 5 médias
Par sa capacité à dissoudre les gaz atmosphériques responsables de l'effet de serre, l'océan joue un rôle essentiel dans la régulation du climat. Toutefois, l'absorption de l'excès de dioxyde de carbone (CO2) rejeté par les activités humaines (anthropiques) depuis 1850...
-
ADRIATIQUE MER
- Écrit par Encyclopædia Universalis
- 692 mots
La mer Adriatique est un bras de la mer Méditerranée situé entre les péninsules italienne et balkanique. À son extrémité sud-est, le canal d'Otrante la relie à la mer Ionienne. Elle mesure environ 800 kilomètres de longueur, avec une largeur moyenne de 160 kilomètres, une profondeur maximale de...
-
AMÉRIQUE (Structure et milieu) - Géologie
- Écrit par Jean AUBOUIN , René BLANCHET , Jacques BOURGOIS , Jean-Louis MANSY , Bernard MERCIER DE LÉPINAY , Jean-François STEPHAN , Marc TARDY et Jean-Claude VICENTE
- 24 173 mots
- 23 médias
Les plaines côtières de l'Atlantique et du golfe du Mexique se suivent du New Jersey au Yucatán. Leur genèse est étroitement liée à l'évolution de l'Atlantique et aux transgressions et régressions marines qui se sont succédé depuis le Jurassique. - Afficher les 130 références
Voir aussi
- ÉPIBIONTES
- ÉPIBIOSE
- POLYCHÈTES
- PÉLAGIQUE VIE
- ÉTOILES DE MER
- LIMIVORES
- FAUNE
- PROFONDEURS OCÉANIQUES, biologie
- ÉPONGE
- REPRODUCTION SEXUÉE
- REPRODUCTION ASEXUÉE
- ASCIDIES
- DÉCAPODES
- MARINE BIOLOGIE
- MACROPHAGIE, biologie
- MICROPHAGIE, biologie
- CORAIL
- LARVE
- OPISTHOBRANCHES
- POPULATIONS ANIMALES & VÉGÉTALES
- AQUATIQUE VIE
- FOUISSEURS, zoologie
- BENTHIQUE VIE
- ANATIFES ou LEPAS
- SIPHON, zoologie