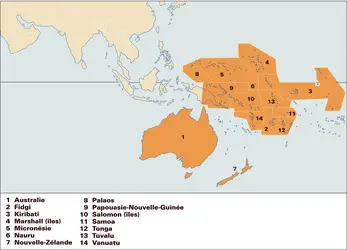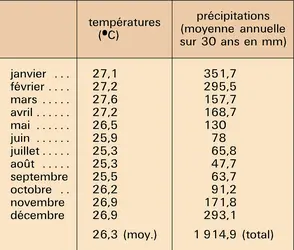OCÉANIE Géographie physique
Article modifié le
Végétation et faune
À l'origine, les îles océaniennes n'avaient pas une flore et une faune très riches, et leur pauvreté a tendance à s'accentuer progressivement en allant de l'ouest vers le cœur de l'océan : les grandes îles mélanésiennes, proches du continent asiatique et de l'Australie, ont une flore beaucoup plus variée que certains atolls ou îlots perdus de la Polynésie.
La majeure partie des espèces végétales et animales des mondes insulaires du Pacifique était, avant les transferts opérés par les hommes, endémique, c'est-à-dire qu'elles n'existaient que dans l'île ou l'archipel considéré. Cet endémisme, fruit d'une longue évolution en vase clos à partir des quelques espèces apportées par les vents, les oiseaux ou les courants marins, était particulièrement accentué dans des archipels comme la Nouvelle-Calédonie ou plus encore les Hawaii, où plus de 90 p. 100 des plantes à fleurs et des insectes étaient endémiques.
Dans le Pacifique sud, il faut souligner l'importance des conifères qui forment le plus souvent les boisements les plus importants de la Nouvelle-Zélande à la Nouvelle-Guinée, en passant par la Nouvelle-Calédonie dont les pins colonnaires (autrement dit les araucarias de Cook) sont célèbres.
La répartition actuelle des types de végétation dépend pour une large part des conditions climatiques et de la nature du sol. Sur les terrains sableux des rivages et des atolls, on trouve surtout des filaos (arbres de fer), des pandanus et, naturellement, des cocotiers qui ont été le plus souvent introduits ou développés par les Polynésiens. Une bonne partie des marécages de la Nouvelle-Guinée sont couverts de boisements de palmiers-sagoutiers.
Les îles montagneuses présentent un étagement de la végétation, particulièrement remarquable en Nouvelle-Guinée ; jusqu'aux environs de 1 000 mètres, c'est la forêt dense humide équatoriale aux espèces très variées, mais, vers 1 200 mètres, la rain forest change d'aspect : à côté de vastes boisements de conifères (Podocarpus), on trouve des chênes (Castanopsis) et des hêtres à feuilles persistantes (Nothofagus) analogues à ceux de la Nouvelle-Zélande, de la Tasmanie ou de la Patagonie chilienne ; le sous-bois est très dense, avec de magnifiques fougères arborescentes. Au-dessus de 3 000 mètres, sur des pentes qui baignent perpétuellement dans le brouillard, la forêt devient très rabougrie et les arbres sont couverts de mousses (« forêt des nuages »). Vient ensuite un étage de buissons de rhododendrons et, entre 3 700 et 4 200 mètres selon l'exposition et la nature du sol, commence la prairie de haute montagne.
Les vigoureux contrastes pluviométriques entre les côtes au vent et les côtes sous le vent retentissent évidemment sur la végétation : à la forêt dense des versants orientaux fortement arrosés s'oppose souvent une forêt claire ou même une savane plus ou moins arborée sur les pentes abritées. L'action humaine a accentué ces différences : en Nouvelle-Calédonie, la savane à niaouli, un petit arbre du genre Melaleuca, qui ressemble à certains eucalyptus australiens, a été largement étendue grâce aux feux de brousse pratiqués par les éleveurs européens. L'exploitation de certaines espèces telles que le santal a provoqué leur recul, parfois même leur disparition.
Inversement, les Européens ont introduit de nombreuses plantes : ils ont enrichi considérablement le stock des plantes cultivées par les Océaniens, qui comportait essentiellement des tubercules (taro, igname) et le cocotier, et ils ont développé de nouvelles cultures : caféier, cacaoyer, agrumes, etc. Ils ont sélectionné des variétés de canne à sucre jusqu'alors négligées. Mais ils ont aussi introduit, volontairement ou non, des plantes qui sont dans certains cas devenues de véritables plaies végétales, tels le goyavier et le lantanier. Plus récemment, c'est une très belle plante ornementale à larges feuilles à revers pourpre, le Miconia, originaire d'Amérique centrale qui a envahi les forêts de Tahiti, Moorea et Raiatea, mettant en péril la survie d'un grand nombre d'espèces endémiques.
L'action de l'homme a été tout aussi profonde sur la faune océanienne. Il n'y avait pas de mammifères dans les îles avant l'installation humaine. Les Mélanésiens et les Polynésiens ont apporté avec eux quelques animaux : le porc, important en Nouvelle-Guinée et aux Nouvelles-Hébrides, le chien, le rat, seul mammifère néo-calédonien avec la chauve-souris venue par elle-même. Les Européens ont introduit les animaux les plus variés ; certains sont redevenus sauvages (cerfs de Nouvelle-Calédonie). La faune avicole des archipels a dû subir la concurrence de nouveaux venus : les merles des Moluques imprudemment introduits dans certaines îles pullulent aujourd'hui.
En tout cas, les spécificités de la biogéographie insulaire suscitent un très grand intérêt de la communauté scientifique : c'est ainsi que cent soixante chercheurs français ont réalisé en 2006, en cinq mois, un inventaire exhaustif de la biodiversité végétale et animale sur l'île de Santo, la plus vaste de l'archipel du Vanuatu (4 000 km2). D'autres scientifiques, autour de Jean Louis Étienne, avaient, en 2004 effectué une étude complète de l'atoll isolé de Clipperton. L'intérêt pour la faune marine des atolls vient du contraste entre sa grande richesse et sa diversité, d'un côté, et de la pauvreté globale des eaux de l'océan tropical qui les entoure, de l'autre. Cela semble lié à des remontées d'éléments nutritifs des profondeurs à travers la masse des matériaux volcaniques et coralliens (endo-upwelling géothermique).
Enfin, il faut souligner l'avantage considérable né de l'isolement insulaire que représente l'absence dans les îles du Pacifique de bon nombre des grandes endémies caractéristiques du monde tropical continental : en particulier, le paludisme, présent dans les terres basses de Nouvelle-Guinée, en pleine recrudescence aux Salomon, ne va pas au-delà du Vanuatu. On comprend les mesures de protection que prennent les insulaires pour éviter toute introduction accidentelle de nouveaux parasites ou maladies, une menace réelle étant donné le développement des échanges avec le monde extérieur.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Alain HUETZ DE LEMPS : professeur à l'université de Bordeaux-III
- Christian HUETZ DE LEMPS : professeur, directeur de l'UFR de géographie, université de Paris-IV-Sorbonne
Classification
Médias
Autres références
-
ASIE (Géographie humaine et régionale) - Espaces et sociétés
- Écrit par Philippe PELLETIER
- 23 143 mots
- 4 médias
...d'archipels qui ourlent la façade pacifique des terres continentales asiatiques. Mais elle n'est pas sans complexités car l'Asie est en contact avec les pays de l'Océanie, dont les possessions américaines (les Mariannes par exemple). Le peuplement historique de la Micronésie, de la Mélanésie et de la Polynésie... -
AUSTRALIE
- Écrit par Benoît ANTHEAUME , Jean BOISSIÈRE , Bastien BOSA , Vanessa CASTEJON , Encyclopædia Universalis , Harold James FRITH , Yves FUCHS , Alain HUETZ DE LEMPS , Isabelle MERLE et Xavier PONS
- 27 359 mots
- 29 médias
Pays massif, l'Australie oscille entre deux qualificatifs : est-elle la plus grande île de la planète ou son plus petit continent ? Elle représente 85 % des terres émergées de l'Océanie, immense continent maritime. -
AUSTRONÉSIENS
- Écrit par Jean-Paul LATOUCHE
- 919 mots
Pris dans un sens strict, les Austronésiens forment un groupe ethnolinguistique considérable dispersé de Madagascar aux îlesHawaii et recouvrant la totalité de l'Indonésie, de la Malaisie et des Philippines, la quasi-totalité de la Mélanésie et de Formose, et enfin la Micronésie...
-
CHEFFERIE
- Écrit par Henri LAVONDÈS et Jean-Claude PENRAD
- 2 930 mots
Laréflexion sur les systèmes politiques océaniens reste dominée par un retentissant article de Marshall Sahlins (1963), qui, plusieurs fois republié et devenu un classique, oppose le système dit du big man, caractéristique de la Mélanésie, où le statut de chef s'acquiert par des efforts personnels,... - Afficher les 33 références
Voir aussi
- ONDE DE CHOC
- TAHITI
- SANTA ISABEL ou ÎLE ISABEL
- CHOISEUL ÎLE
- NOUVELLE-GÉORGIE ÎLE DE LA
- KWAJALEIN ÎLE
- BORA BORA
- SAMOA ARCHIPEL DES
- CONVERGENCE INTERTROPICALE
- ALIZÉS
- VOLCANIQUES ÎLES
- COURANTS & CONTRE-COURANTS ÉQUATORIAUX
- NOUVELLE-GUINÉE
- RÉCIF-BARRIÈRE
- ÉQUATORIALE FORÊT ou FORÊT TROPICALE HUMIDE
- VOLCANISME ACTUEL
- NOUVELLE-BRETAGNE
- CEINTURES OROGÉNIQUES PÉRIPACIFIQUES ou CERCLE DE FEU DU PACIFIQUE
- CAROLINES ARCHIPEL DES
- ATOLL
- RÉPARTITION DES FLORES & DES FAUNES
- TREMBLEMENT DE TERRE
- LAGON
- CORAIL
- RÉCIFS
- CLIPPERTON ÎLOT DE
- SOUS-LE-VENT ÎLES, Polynésie
- MALAITA ÎLE DE
- ÉTAGE DE VÉGÉTATION
- GUADALCANAL ÎLE DE
- MAKIRA ou SAN CRISTOBAL ÎLE DE
- RÉCIF FRANGEANT