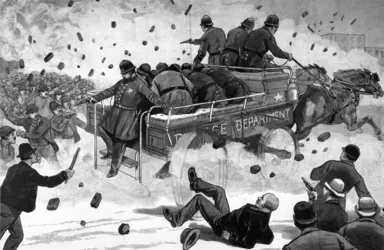OPINION PUBLIQUE
Article modifié le
Les usages contemporains de l'opinion publique
L'opinion publique fabriquée par les sondeurs
L'introduction de la pratique des sondages d'opinion, après la Seconde Guerre mondiale en France – pratique qui se généralise en fait en 1965 à partir de l'élection du président de la République au suffrage universel – va mettre bon ordre en quelque sorte à cette situation où chacun peut dire et même croire qu'il sait ce que pense et ce que veut l'« opinion publique », compte tenu de l'idée qu'il s'en fait. Les sondeurs vont être les agents de la troisième transformation qui est au principe du nouvel état de la notion, celui qui tend à s'imposer aujourd'hui. Ces derniers affirment très pragmatiquement que « l'opinion publique est ce que mesurent leurs enquêtes d'opinion ». Et, de fait, en dépit de critiques formulées ponctuellement, les instituts de sondages sont parvenus à imposer leur définition de l'opinion publique parce qu'elle se présente à la fois comme plus « démocratique » et plus « scientifique ».
En liaison avec l'apparition des nouvelles techniques qui ont été inventées par les sciences sociales (échantillon par sondage, questionnaire fermé, traitement automatique et rapide des réponses par ordinateur), la notion d'opinion publique, bien que l'existence de son référent objectif soit toujours aussi incertaine, va en effet trouver sa pleine réalisation contemporaine dans la mesure où elle va inclure l'opinion de tous, y compris de ceux qui ne s'expriment pas publiquement. La technologie du sondage d'opinion a tout ce qu'il faut pour donner à la notion d'opinion publique un fondement à la fois « démocratique » puisque tout le monde est, par échantillon représentatif interposé, censé être interrogé, et « scientifique » puisque les opinions de chacun sont méthodiquement recueillies et comptabilisées.
La croyance en la fiabilité de telles enquêtes repose pourtant sur une confusion, celle qui s'est d'emblée instaurée entre la saisie du comportement électoral et celle des opinions. En effet, les instituts de sondage doivent leur notoriété, auprès des responsables politiques et des journalistes, à leurs enquêtes dans le domaine strictement électoral, les sondeurs s'étant d'abord proposé de saisir les intentions de vote des électeurs. Les données fournies par ces enquêtes, surtout lorsqu'elles sont effectuées à la veille d'un scrutin, sont à la fois spectaculaires dans leur pouvoir prédictif et scientifiquement peu discutables, leur précision et leur fiabilité étant de surcroît vérifiées par l'élection elle-même. Mais ces sondages préélectoraux appréhendent moins des « opinions » au sens propre que des intentions de comportement électoral (désignation des personnalités politiques ou des partis), et cela dans un domaine, celui de la politique, où la situation d'enquête reproduit de manière assez exacte la situation créée par la consultation électorale.
Il en va tout autrement lorsque, à la demande des autorités politiques, et plus récemment des grands organes de presse, les instituts de sondage réalisent des enquêtes visant à déterminer ce qu'est l'« opinion publique » entendue, selon la définition politiquement dominante, comme opinion majoritaire sur des problèmes extrêmement variés et parfois très complexes – comme par exemple des questions de politique internationale ou de politique économique – sur lesquels la plupart des personnes interrogées n'ont pas nécessairement de jugement constitué et, pour nombre d'entre elles, ne se posaient même pas les questions qui leur sont soumises. Bien que fortement minorées, notamment en raison des techniques de constitution des échantillons d'enquêtés et de l'usage quasi exclusif des questions précodées et fermées qui conduisent à recueillir moins des « opinions » que des « réponses » à des questions d'opinion, les non-réponses explicitement déclarées et leur distribution non aléatoire par sexe, niveau d'instruction et catégorie sociale suffisent à rappeler que la probabilité d'avoir une opinion personnelle est très inégalement répartie dans la population. S'ils ne prennent pas au sérieux cette donnée de fait, les instituts de sondage, loin de se borner à recueillir des opinions préexistantes à l'enquête, produisent de toutes pièces une « opinion publique » qui est en réalité un pur artefact obtenu par l'enregistrement et l'agrégation statistique des réactions d'approbation ou de refus à des opinions déjà formulées, souvent en des termes incertains et ambigus, que leurs enquêtes soumettent à des échantillons de population en âge de voter. La publication de ces résultats par les journaux d'opinion qui, très souvent, en ont commandé la production est ainsi, en beaucoup de cas, un « coup politique » paré de toutes les apparences de la légitimité de la science et de la démocratie par lequel un groupe de pression, public ou privé, doté des moyens économiques d'assumer les coûts d'une enquête par sondage peut donner à son opinion particulière les apparences de l'universalité qui sont associées à l'idée d'« opinion publique ».
Une justification plus politique que scientifique
Contre les responsables politiques qui refusèrent initialement la pratique des sondages d'opinion, ou, pour le moins considérèrent avec une certaine réticence la prétention de cette nouvelle technologie sociale à mesurer l'état de l'opinion publique réellement active, les politologues firent valoir le caractère « scientifique » des enquêtes par sondage. Mais inversement, contre les analyses critiques des sociologues qui déconstruisaient ce qui, en fait, était un véritable fétiche du jeu politique, les défenseurs de la pratique des sondages d'opinion en politique déplacèrent le débat sur le terrain politique. Ils invoquèrent l'idée que l'enquête par sondage, parce qu'elle repose en définitive sur les mêmes présupposés que le suffrage universel – tous les citoyens ont le droit de voter sans que l'on pèse les raisons de leur choix ou leurs intentions – serait, à ce titre, une pratique aussi intouchable que le suffrage universel lui-même. Ils firent valoir que, dans nos sociétés, le sondage politique permettrait une sorte de démocratie directe : chaque aspect de la politique gouvernementale – aussi bien la réforme des régimes de retraite que la décision de participer ou non à telle coalition militaire – pourrait, et même devrait, faire l'objet de petits référendums auprès d'échantillons représentatifs des électeurs.
Or, cet argument purement politique est également contestable d'un point de vue strictement politique. En effet, la consultation référendaire, pratique politique qui est la plus proche du sondage d'opinion, demeure, dans les démocraties, un événement exceptionnel parce que la politique ne se fait pas au jour le jour par acclamation ou rejet des mesures politiques par l'ensemble des électeurs mais s'élabore dans les enceintes parlementaires et dans les cabinets ministériels, après consultation des représentants politiques et syndicaux, par les personnalités élues ou nommées qui ont en charge d'étudier et de discuter les programmes et les décisions politiques. Quant aux rares consultations référendaires qui sont organisées, elles donnent lieu à des campagnes électorales actives de plusieurs mois et à l'élaboration de prises de position qui sont destinées à mobiliser les électeurs pour faire en sorte qu'ils se prononcent en connaissance de cause, ce qui n'empêche pas cependant que, en bien des cas, nombre d'électeurs ne répondent pas vraiment à la question qui leur est posée. Il reste que l'enquête d'opinion par sondage n'est pas réellement assimilable à un référendum : il lui manque l'essentiel, à savoir la mobilisation des citoyens, l'explicitation des enjeux, la campagne électorale et le positionnement des partis politiques dans une consultation qui ne soit pas fictive mais bien réelle. Et de fait, on a pu observer les décalages importants qui existent entre les distributions statistiques des sondages obtenues hors campagne électorale et les résultats des consultations référendaires au terme du débat public qui précède le vote.
Entre artifice et indicateur pratique
Au terme de ce parcours historique, on voit que la notion d'« opinion publique » que les sondeurs ont réussi à imposer dans le jeu politique démocratique n'a plus le même sens ni le même contenu que celle qu'elle avait initialement. À l'origine, elle désignait en effet les opinions actives, celles des individus et des groupes qui voulaient que leurs opinions soient prises en compte et qui, à cette fin, les rendaient publiques et les mettaient en quelque sorte en discussion.
L'« opinion publique » construite par les sondeurs est obtenue en mobilisant une armée d'enquêteurs qui va interroger des enquêtés le plus souvent en majorité non mobilisés (ce que les sondeurs ont conceptualisé par la notion de « majorité silencieuse », entité qu'ils se chargeraient de faire parler) ; ils recueillent non des « opinions » mais des « réponses » exprimées dans le cadre privé de l'enquête en face-à-face ou par téléphone, les baptisent « opinions », les additionnent et nomment la distribution majoritaire des réponses ainsi obtenues « opinion publique », le vocable exprimant à la fois qu'on veut voir là l'opinion du public et que les résultats de ces enquêtes sont publiés dans les médias et commentés par les acteurs du jeu politique.
Notion à géométrie variable, il suffit en effet de définir la population interrogée pour produire à la demande l'opinion publique qui est appelée par la lutte politique. Il est possible de construire des opinions publiques sectorielles, celle des cadres, des jeunes, des vacanciers, etc. On ne voit jamais aussi bien le caractère artefactuel de cette notion construite par les sondeurs que dans ces enquêtes censées mesurer l'« opinion publique européenne », à partir des réponses obtenues par des enquêtes standards menées dans différents pays, qui sont formellement identiques et mécaniquement additionnées bien qu'elles renvoient à des contextes sociaux et politiques différents et qu'elles aient par là des significations également très différentes.
Est-ce à dire que ces enquêtes livrent des données dépourvues de toute utilité pratique pour les acteurs du jeu politique ? Si c'était le cas, on ne comprendrait pas que cette pratique, qui a un coût financier non négligeable, se soit développée et fasse désormais partie intégrante de la lutte politique. Si tous les hommes politiques les consultent et les prennent plus ou moins en compte, c'est que les sondages, parce qu'ils reposent précisément sur les mêmes présupposés que le suffrage universel, fournissent à court terme des indications utiles s'agissant de prévoir les réactions de la population à telle ou telle décision et les conséquences en termes de prévision électorale.
Quoique très imparfaits et bien que parfois mal interprétés, les sondages jouent le rôle de boussole dans une activité soumise à la logique de l'élection et où la réélection n'est jamais acquise. Ils sont moins hasardeux que la pure intuition ou les indices inévitablement biaisés par lesquels les hommes politiques cherchent à prendre le « pouls de l'opinion » ou à connaître le niveau de leur popularité. Ils sont utilisés comme éléments parmi d'autres pour construire un tableau de bord politique censé appréhender, sinon l'opinion publique elle-même, du moins ses variations.
L'opinion publique comme nouvel enjeu politique
On voit ainsi que, en définitive, ce qui existe, c'est moins une « opinion publique » en soi que la croyance en l'existence de l'opinion publique telle que les sondeurs et les hommes politiques la construisent. Il reste que, en se diffusant, la pratique des sondages d'opinion et la croyance qui la soutient ont profondément modifié le fonctionnement du jeu politique : les hommes politiques doivent maintenant compter avec cette nouvelle instance, largement contrôlée par les politologues, qui est censée dire, mieux que les représentants du peuple, ce que veut et pense le peuple. Les instituts de sondage interviennent désormais à tous les niveaux de la vie politique : ils effectuent des sondages confidentiels pour les formations politiques afin de déterminer, dans une logique qui est celle du marketing, les thèmes de campagne électorale qui seront censés être les plus porteurs, voire les candidats les plus faciles à « promouvoir » ; ils sont aussi au cœur de la plupart des émissions que les grands médias consacrent à la politique et tendent à transformer les téléspectateurs en juges-arbitres des « prestations » des hommes politiques ; la presse nationale commande en permanence des sondages sur les questions politiques à l'ordre du jour pour en publier les résultats et les invoquer à l'appui de telle ou telle ligne éditoriale.
À mesure que se multiplient les dispositifs d'apparence scientifique qui prétendent mesurer l'influence que peut exercer la politique de communication des principaux leaders politiques sur l'« opinion publique », on voit se redéfinir ce qu'on appelle « la politique » : l'action politique apparaît de plus en plus comme l'art d'utiliser un ensemble de techniques élaborées par des spécialistes de la « communication politique » pour « faire bouger l'opinion publique ». Ainsi, dans tous les cas, l'enquête d'opinion dans le domaine politique produit le même effet, qui est de faire apparaître comme résolu, par la vertu combinée de l'imposition d'une problématique et de l'agrégation des réponses isolées, un des problèmes majeurs de toute action politique, à savoir de constituer comme telle d'un côté l'opinion individuelle, celle de l'individu singulier avec ses intérêts particuliers et de l'autre, ce qui peut être présenté, notamment au travers de la délégation, comme une opinion collective, c'est-à-dire une opinion qui est censée exprimer le vouloir d'une société entière.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Patrick CHAMPAGNE : sociologue à l'Institut national de la recherche agronomique et au Centre de sociologie européenne, École des hautes études en sciences sociales
Classification
Médias
Autres références
-
ACTION HUMANITAIRE INTERNATIONALE
- Écrit par Encyclopædia Universalis et Pierre GARRIGUE
- 7 244 mots
- 1 média
...de l'action humanitaire ne répondait pas seulement aux impératifs de la mode et de l'actualité, mais traduisait également une exigence intellectuelle : transformer ce qu'on appelait autrefois des faits divers, événements secondaires parce qu'ils se produisent loin de nous et n'ont pas d'... -
ADAPTATION - Adaptation sociale
- Écrit par Raymond BOUDON
- 2 258 mots
- 1 média
...obscur donne l'impression de se déplacer. L'évaluation des distances de déplacement est donc subjective ; la réalité ne fournit pas de base solide à l' opinion. Sherif a montré que, dans un cas comme celui-là, l'opinion individuelle était largement déterminée par l'opinion collective. En effet, lorsqu'il... -
AGENDA POLITIQUE, sociologie
- Écrit par Nicolas HUBÉ
- 548 mots
La « mise à l’agenda » concerne la question des « effets » des médias sur le débat public et sur les électeurs, et en particulier lors des moments de « surchauffe symbolique » que sont les élections. Maxwell McCombs et Donald Shaw ont formulé en 1972 le principe suivant : il se peut que la presse...
-
AGNOTOLOGIE
- Écrit par Mathias GIREL
- 4 993 mots
- 2 médias
Même si, d’emblée, pour Proctor, la notion d’agnotologie avait bien pour but de couvrir les trois sens mentionnés, elle s’est vite retrouvée identifiée à l’ignorance « produite ». Il s’agirait alors de considérer l’ignorance non pas seulement comme un état, mais aussi comme un effet, et de la relier... - Afficher les 55 références
Voir aussi
- VOLONTÉ GÉNÉRALE
- ÉLECTORALE SOCIOLOGIE
- SONDAGES MÉTHODES DE
- OUVRIÈRE CLASSE
- SYSTÈME POLITIQUE
- POUVOIR POLITIQUE
- PRESSE QUOTIDIENNE
- OPINION PRESSE D'
- VOTE
- ENQUÊTES & SONDAGES
- COMMUNICATION POLITIQUE
- JOURNALISME
- FRANCE, histoire, de 1715 à 1789
- FRANCE, histoire, de 1789 à 1815
- FRANCE, histoire, de 1815 à 1871
- FRANCE, histoire, de 1871 à 1939
- ÉLITES
- POLITIQUES MOUVEMENTS