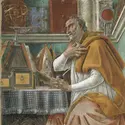ORIGÈNE (185-253/54) & ORIGÉNISME
Article modifié le
L'origénisme
L'origénisme en Orient aux IIIe et IVe siècles
Au iiie siècle, beaucoup de penseurs chrétiens, à Alexandrie et à Césarée, se situent dans la tradition d'Origène (Denys d'Alexandrie, Théognoste, Grégoire le Thaumaturge, Pamphile), tandis qu'en revanche une forte réaction, notamment contre la théorie origénienne de la préexistence des âmes, commence à se dessiner, surtout à Antioche.
Au ive siècle, la théologie trinitaire origéniste, soutenue en particulier par Eusèbe de Césarée, sera suspectée d'arianisme par les partisans de la consubstantialité entre le Père et le Fils proclamée au concile de Nicée. Sur ce point, l'enseignement d'Origène sera rapidement dépassé par l'évolution du dogme, et les plus fervents origénistes l'abandonneront. Mais l'œuvre exégétique du maître resta extraordinairement vivante ; elle fut abondamment utilisée par Eusèbe de Césarée, Didyme d'Alexandrie et les Cappadociens : Grégoire de Nazianze, Basile de Césarée et Grégoire de Nysse.
Surtout la cosmologie du traité Sur les principes est loin d'avoir été oubliée. Dans certains milieux monastiques égyptiens, à Nitrie et aux Cellules entre autres, elle est encore en honneur aux environs de 374. À Jérusalem, au monastère du mont des Oliviers, fondé par Mélanie l'Ancienne et Rufin, on ne cache pas l'enthousiasme qu'on éprouve pour l'ensemble de cette œuvre. C'est en contact avec ces milieux favorables à Origène que va se développer la pensée d'Évagre le Pontique (346-399), qui représente indiscutablement une véritable renaissance de l'origénisme. Contre ces tendances se manifestera d'ailleurs une réaction violente de la part d'Épiphane de Salamine (chap. lxiv de son Panarion composé en 374-377), de la part aussi de Jérôme, notamment dans son traité Contre Jean de Jérusalem (396), enfin de la part de Théophile d'Alexandrie, dans ses « lettres festales » de 400-404. Comme l'a bien montré A. Guillaumont, les thèses visées dans ces différents documents sont bien celles d'Évagre le Pontique, dont il est tout à fait intéressant de présenter brièvement la doctrine, pour exposer la manière dont la pensée origénienne a été systématisée par le disciple.
Évagre le Pontique
L'œuvre dans laquelle s'exprime le plus clairement l'origénisme d'Évagre, ses Centuries gnostiques, ne nous est pas parvenue en grec. A. Guillaumont en a découvert une version syriaque intégrale, non expurgée des passages origénisants, et il a pu ainsi reconstruire les grandes thèses origénistes d'Évagre.
La première création ne comprend qu'un monde spirituel d' intelligences que Dieu – Trinité et unité – a produites afin d'être connu par elles. Ces intelligences, unies au Verbe de Dieu, sont toutes égales entre elles et forment une unité parfaite. La rupture de cette unité se produit par la faute des intelligences : elles se lassent, relâchent leur contemplation. C'est le « premier mouvement » qui sépare les intelligences, non seulement de l'unité originelle, mais aussi les unes des autres. Seul de tous, le Christ, intellect originellement égal aux autres, n'a pas relâché sa contemplation et est resté uni au Verbe divin, sans se laisser entraîner par le mouvement premier.
La seconde création, celle des mondes matériels, est l'œuvre du Christ. Elle est destinée à fournir aux êtres spirituels déchus un moyen de salut. Les esprits deviennent des anges, des démons, des âmes humaines : ils reçoivent, en vertu d'un premier jugement, des corps qui correspondent à leur degré de chute, c'est-à-dire à leur capacité de connaissance. Aux différents degrés de contemplation correspondent des états corporels différents. Le salut des intelligences se fait en passant d'une contemplation à une autre, jusqu'à la « contemplation naturelle première », qui correspond à l'état angélique. C'est donc la qualité de la contemplation qui détermine la situation ontologique. Dans cette histoire des esprits, il peut y avoir des montées et des descentes, des passages successifs dans des corps supérieurs ou inférieurs jusqu'à la libération finale.
Grâce à la série de purifications qui les fait passer par une suite de mondes, les êtres intelligents s'élèvent peu à peu à l'état angélique, c'est-à-dire qu'ils acquièrent tous un corps spirituel. Après le « vendredi » du mode sensible, c'est le septième jour, celui du règne du Christ sur les intelligences. Mais ce règne prendra fin. Les intelligences redeviendront égales au Christ ; le corps et la matière disparaîtront, l'unité originelle sera restaurée, ce sera le dimanche, le huitième jour, la réintégration de tous dans l'unité originelle.
On retrouve sans peine dans ce système les grandes lignes de la pensée d'Origène. La systématisation effectuée par Évagre se reconnaît tout spécialement aux dénominations qu'il a données aux différentes phases du processus cosmique : « mouvement premier », pour désigner la rupture de l'unité ; « contemplation naturelle première », pour l'état angélique des esprits parvenus à l'impassibilité ; « contemplation naturelle seconde », pour l'état des âmes humaines travaillant encore à se libérer de leur passion ; « septième jour », pour le règne du Christ sur les êtres raisonnables ; « huitième jour », pour la restauration de l'unité première.
Les querelles en Orient au VIe siècle
Dans certains milieux monastiques, l'origénisme resta en honneur. On retrouve des moines fervents origénistes à la Nouvelle Laure, fondée en 507 à une vingtaine de kilomètres de Jérusalem. Les réactions contre cette tendance doctrinale et les luttes qui agitèrent les milieux monastiques à partir de 514 eurent pour conséquence un édit de l'empereur Justinien promulgué en 543 et condamnant l'origénisme. Malgré cet édit, les querelles provoquées par l'existence du parti origéniste de la Nouvelle Laure ne cessèrent pas. C'est pourquoi, au Ve Concile œcuménique, convoqué à Constantinople pour régler l'affaire des « Trois Chapitres », en l'année 553, l'origénisme fut à nouveau condamné et les noms d'Origène et d'Évagre anathématisés. Comme l'a montré A. Guillaumont, la doctrine d'Évagre fournit la clef qui permet de comprendre comment, parmi les thèses origénistes condamnées en 553, plusieurs ne se retrouvent pas dans le traité Sur les principes : c'est en fait la doctrine d'Évagre qui a été condamnée sous le nom d'origénisme. Tout spécialement, c'est sa christologie qui est visée dans les anathématismes de 553. En systématisant la doctrine origénienne, Évagre avait été conduit en effet à considérer le Christ comme un intellect, ou nature raisonnable, égal, dans l'unité première, aux autres intellects ou natures raisonnables. Mais, à la différence de celles-ci, le Christ était resté uni au Verbe, c'est-à-dire à la science de l'unité. D'où son rôle dans le salut des autres intellects : c'est le Christ (et non pas Dieu lui-même) qui avait créé les mondes sensibles, lieu d'épreuves pour les autres intellects. C'est le Christ (et non pas le Verbe, mais le Christ ayant en lui le Verbe) qui s'était incarné pour secourir les intellects tombés. De telles affirmations ne se trouvaient pas chez Origène, mais elles découlaient de la systématisation par Évagre des idées origéniennes concernant l'égalité originelle des esprits.
L'origénisme en Occident
L'influence d'Origène s'est exercée en Occident d'une manière surtout anonyme. Pendant tout le ive siècle, la plupart des Pères latins ont littéralement pillé l'œuvre exégétique d'Origène ; c'est notamment le cas d'Hilaire, pour son commentaire sur les Psaumes, d'Ambroise et de Jérôme pour presque toute leur œuvre homilétique ou exégétique. À la fin du ive siècle, Rufin d'Aquilée, dont on a déjà parlé à propos des tendances origénistes du monastère du mont des Oliviers, traduisit en latin (et sauva ainsi de la destruction) de nombreuses homélies sur l'Ancien Testament, une partie du commentaire sur le Cantique des cantiques et surtout le traité Sur les principes.
Grâce à Hilaire, à Ambroise de Milan et à Jérôme lui-même, la méthode exégétique origénienne a été introduite en Occident et a marqué toute l'exégèse médiévale. Surtout, grâce aux nombreuses pages d'Ambroise consacrées à commenter le Cantique des cantiques à l'aide d'Origène, la piété médiévale sera profondément influencée par la mystique origénienne. L'épouse du Cantique sera l'âme désireuse de recevoir le baiser du Verbe de Dieu et de pénétrer dans les mystères de sa sagesse et de sa science, comme dans la chambre nuptiale de l'Époux céleste. La doctrine des noces mystiques de l'âme et du Verbe, la théorie des sens spirituels, notamment du goût et du toucher mystiques de Dieu, domineront toute la spiritualité occidentale, qu'il s'agisse de Bernard de Clairvaux ou de Thérèse d'Avila.
La pensée origénienne et l'essence de l'origénisme ont été interprétées dans des sens extrêmement différents. Pour les uns (H. Koch, H. Jonas, E. de Faye), il s'agit purement et simplement d'un système néo-platonicien ; pour d'autres, le christianisme d'Origène ne fait pas de doute, mais il y a conflit entre la foi traditionnelle et le système philosophique (G. L. Prestige). Certains (H. Crouzel) voient surtout chez Origène une sagesse mystique. D'autres interprètes (M. Harl) décèlent une évolution dans la pensée d'Origène, l'effort de systématisation étant plus grand dans la jeunesse, les préoccupations spirituelles plus intenses dans la vieillesse. D'autres enfin (J. Daniélou) insistent sur la grande diversité d'aspects de l'origénisme, en reconnaissant un certain manque de cohérence entre le système cosmologique et l'exégèse biblique.
Peut-être faut-il insister en terminant sur le fait que les systématisations d'Origène ou de son disciple Évagre n'ont jamais eu pour but d'édifier un corps de doctrine définitif et figé. Elles furent avant tout des appels à l'esprit de libre recherche, des exercices spirituels destinés à élever l'esprit à un point de vue supérieur, des exhortations à l'audace intellectuelle.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Pierre HADOT : professeur au Collège de France
Classification
Autres références
-
ALEXANDRIE ÉCOLE PHILOSOPHIQUE D'
- Écrit par Jean PÉPIN
- 2 186 mots
La figured'Origène est assez différente. Sa fidélité à la philosophie grecque porte moins sur le matériel expressif (comme c'était le cas de Clément) que sur les doctrines mêmes ; il applique à la Bible les méthodes de l'exégèse allégorique qui avaient cours dans les écoles... -
ALLÉGORISTES CHRÉTIENS
- Écrit par Richard GOULET
- 668 mots
À la suite des philosophes païens qui interprétaient les mythes traditionnels de l'hellénisme en dévoilant la signification philosophique cachée (morale ou physique) qu'ils contenaient, les Juifs (Aristobule et Philon d'Alexandrie) puis les chrétiens ont dégagé des saintes Écritures des sens...
-
ANTIOCHE
- Écrit par Pierre Thomas CAMELOT
- 2 578 mots
Tous prennent vigoureusement parti contre l'allégorie, dontOrigène est le représentant le plus célèbre. Entendons par ce mot, malgré les imprécisions d'un vocabulaire assez fluent, le procédé littéraire qui dans les faits racontés par l'histoire ne veut voir qu'une parabole à travers laquelle il... -
BIBLE - L'inspiration biblique
- Écrit par André PAUL
- 4 566 mots
- 1 média
...les auteurs inspirés quand il écrit : « Vous nous procurez joie et allégresse si vous obéissez à ce que nous avons écrit par le Saint-Esprit. » Pour Origène, l'inspiration divine (théou épipnoia) est nécessaire aussi au philosophe pour que puisse lui être « manifestée la nature du mal... - Afficher les 23 références
Voir aussi