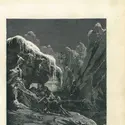ORIGINE
Article modifié le
Le geste inaugural
Une seconde confusion à éviter consiste à assimiler le recours à l'origine à une revendication du retour. Même lorsqu'elle sert à dénoncer comme illégitime un état actuel, la démarche originaire n'est pas un « primitivisme », car vouloir revenir à un temps premier serait encore accorder du prix au temps. La source de cette confusion, souvent exploitée par les adversaires d'une telle méthode de raisonnement – il suffit de songer, précisément, à ce que l'on a pu attribuer à Rousseau comme rêve de retour à la sauvagerie et à l'état animal –, tient à ce que le procédé, lorsqu'il sert à critiquer la société existante, permet de le faire dans un style radical puisque rien de ce que la tradition a ajouté aux éléments fondamentaux ne parvient à se justifier, aux yeux de qui l'interroge, par la seule force des siècles. Ce qui ne parvient pas à se découvrir une racine dans l'individu originaire est alors vite rejeté comme abus, préjugé, exception irrationnelle.
Mais on ne saurait réduire ce type d'analyse à sa version critique : elle peut tout aussi bien donner lieu à des versions conservatrices. C'est ce que Rousseau reproche à Grotius, et, au xixe siècle encore, le livre d'Adolphe Thiers, De la propriété, utilisera le même recours à l'individu lockien pour assurer sur ses bases la société ébranlée par les journées de juin 1848 et refuser pêle-mêle le socialisme, les ateliers nationaux et l'impôt proportionnel. Tout dépend de ce qu'on place dans l'état originaire, et il est caractéristique qu'aucun des auteurs n'y place exactement la même chose. Ces différences initiales se répercutent donc dans l'état dont l'origine doit rendre compte. Ainsi, dans le cas de la société civile, ceux qui, comme Hobbes, assimilent l'état de nature à un état de guerre rendent nécessaire un abandon total de l'individu à la souveraineté qui sera créée par le pacte social ; au contraire, ceux qui imaginent l'état originaire comme susceptible déjà d'un certain développement pacifique rendent l'urgence du pacte moins pressante, et plus libéral le souverain qui en est issu.
Il faut noter qu'on peut lire dans les deux sens le rapport de l'origine à l'histoire : si cette dernière a davantage la valeur d'une condition de possibilité que d'un commencement, et si son temps n'est pas un passé parce que, au fond, ce n'est pas un temps du tout, réciproquement, le temps réel, celui qui rythme le cours des choses, se voit dans une telle conception refuser toute valeur. Simple réceptacle de principes qui le dépassent, il laisse se dérouler une histoire vide sans y rien modifier. Pour les philosophes des Lumières, parler d'une histoire qui n'est pas celle de l'esprit humain, c'est aligner massacres, guerres et disputes qui n'ont d'autre sens que de réaffirmer quelques principes déjà connus : méfaits de l'ignorance et de la superstition, universalité de la propriété, conséquences détestables de la tyrannie. Si l'origine est ce qui explique, donc ce qui norme, l'histoire réelle n'explique rien, car tout ce qui y a sens y relève d'autre chose qu'elle ; elle ne conserve en propre que l'anecdote.
Il demeure cependant une troisième sorte de temps : celui qui s'ordonne au geste inaugural du Sujet. Car c'est à cette figure que se noue celle de l'origine quand on la pousse dans ses derniers retranchements. En effet, puisque l'origine rassemble, par un geste du Sujet, ce qui était déjà là, dispersé mais somme toute prêt à être rassemblé, il y a donc un avant et un après distribués autour de cet acte fondateur. Bien loin que ce soit l'histoire qui fonde l'origine, c'est donc l'origine qui fait apparaître ce substitut d'histoire très simple – car de l'avant à l'après, rien n'a changé de ce qui était dans les choses ; simplement, le Sujet a porté sur elles un regard constituant. Il suffit de délayer un peu dans la durée ce qui est ainsi inauguré pour découvrir la notion de progrès. Cette dernière, en effet, ne fait guère qu'étaler sur plusieurs instants les conséquences de l'acte subjectif, mais elle demeure dans le même registre puisque ces instants divers s'unissent dans une direction unique, sans régression ni divergence. Seule une hésitation tenant au manque de lumières peut retarder le progrès. Mais on ne découvre ainsi aucun des parcours réels qui font la trame de l'histoire réelle. Finalement, une telle histoire tend à être surtout celle des progrès de l'esprit humain.
L'attaque principale contre les théories de l'origine et leurs corollaires viendra des traditionalistes du xviiie et du xixe siècle, à qui une doctrine substituant la réalisation du doit-être à la pesanteur des faits est impensable. C'est au fond l'idée principale de Burke, lorsqu'il part en guerre contre l'illusion qu'un remaniement moderne, décidé par la seule raison naturelle, a juridiction sur ce que le poids des siècles a accumulé de sagesse et d'équilibre concret dans une institution. Pour lui, un tel équilibre n'est nullement un artifice que l'on devrait retrancher pour lire à nu la forme pure d'un gouvernement, il est au contraire le résultat du lent procès de constitution d'un phénomène qui doit être minutieusement soupesé plutôt qu'analysé par une raison géométrique.
Une autre critique viendra de Marx : lorsque celui-ci s'en prend aux « robinsonnades » des économistes, il leur reproche d'isoler en en cherchant la source dans un individu unique des faits qui ne peuvent se comprendre que comme produits de rapports sociaux déterminés. Le procédé servirait donc à inscrire dans une prétendue nature ce qui est en réalité le résultat de circonstances définies et transformables.
Parmi tous les exemples du recours tenace à l'origine comme révélation, il en est un qu'il faut citer à part, car il déborde largement le xviiie siècle, bien qu'il y trouve sa meilleure justification théorique : c'est la tentation d'une expérience directe de l'originaire, soit par l'observation d'individus par hasard tenus à l'écart de la civilisation (les « enfants sauvages »), soit par l'expérimentation qui consiste à isoler des enfants pour juger de leurs premières réactions, voir s'ils parleront (et en quel langage ? car on tiendrait peut-être là la langue archaïque de l'humanité), savoir enfin comment ils deviendront humains. C'est l'initiative qu'on attribue au pharaon Psammétique, et que Volney commentera pour en tirer des conclusions condillaciennes, ou à Frédéric II de Hohenstaufen. Dans les deux cas, il s'agit de lire, s'il se peut, l'émergence de l'humain dans la lumière de sa nature même hors de toutes les circonstances qui d'habitude l'obscurcissent. Exigence fascinante promise à une belle fortune littéraire, comme en témoignent le Frankenstein de Mary Shelley et le Gaspard Hauser de Wasserman.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Pierre-François MOREAU : professeur des Universités à l'École normale supérieure des lettres et sciences humaines
Classification
Autres références
-
ADAM
- Écrit par André-Marie DUBARLE
- 1 758 mots
Dans la Genèse, un récit plus ancien, bien que placé en second lieu (Gen., ii, 4-25), décrit laformation de l'homme, modelé avec la glaise du sol, puis animé par le souffle de Dieu, qui en fait un être vivant, placé alors dans un jardin divin planté d'arbres fruitiers luxuriants. Dieu lui... -
ÂGE DE LA TERRE
- Écrit par Pascal RICHET
- 5 145 mots
- 5 médias
...(~428-347), Aristote (~385-~322), Épicure (~341-~270) ou Zénon de Cittium (~335-~264), le premier stoïcien. La question la plus importante, celle de l’origine du monde, ne fut bien sûr pas laissée de côté. Dans la grandiose cosmologie de son dialogue le Timée, Platon affirma que le monde avait... -
ANTHROPOMORPHISME
- Écrit par Françoise ARMENGAUD
- 7 544 mots
- 1 média
...Plante vénéneuse à l'épaisse racine velue dont la forme apparaît vaguement humaine, la mandragore fut mêlée à maintes croyances et pratiques. Le mythe de l'origine chtonienne de l'homme y trouve quelque appui : selon Eliphas Lévi, les premiers hommes auraient été « de gigantesques mandragores... -
BOUTANG PIERRE (1916-1998)
- Écrit par Jean-François DUVERNOY
- 710 mots
Né à Saint-Étienne le 20 septembre 1916, Pierre Boutang avait quarante-huit ans de moins que le maître qu'il s'était choisi dès son adolescence : Charles Maurras. En politique, domaine dans lequel l'adhésion implique une appartenance, c'est beaucoup ; d'autant plus que celle-ci...
- Afficher les 22 références
Voir aussi