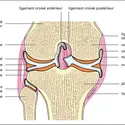OS
Article modifié le
Le métabolisme phosphocalcique
Leurs fonctions extra-osseuses se déroulent distinctement pour le calcium et le phosphore, qui se juxtaposent seulement au niveau du cristal osseux ; en dehors de cette structure parfaitement définie, le calcium et le phosphore suivent des voies métaboliques très différentes qu'il faut étudier séparément, avant d'envisager leur participation à la constitution du cristal, élément mécanique essentiel du squelette, mais aussi réserve calcique.
Métabolisme du calcium
État et répartition dans l'organisme
Dans le squelette de l'homme adulte, on trouve 99 p. 100 du calcium de l'organisme, soit de 1 000 à 1 300 g. Chez le nouveau-né, 30 g de calcium sont contenus dans les os. Au cours de la croissance, le squelette emmagasine plus d'un kilogramme de calcium, constituant ainsi une réserve dans laquelle les systèmes régulateurs vont puiser grâce aux mécanismes que l'on verra plus loin. Dans l'os, le calcium apparaît sous forme d'un cristal complexe, très proche de l'hydroxyapatite, dont la composition varie au cours de la vie.
Dans les tissus mous, on trouve chez l'adulte environ 10 g de calcium, dont une grande partie est intracellulaire et une fraction contenue dans les calcifications viscérales qui augmentent avec l'âge.
Dans les liquides extracellulaires, on dose un gramme de calcium, dont 700 mg sont répartis dans le liquide interstitiel. Ce secteur, pauvre en albumine, contient surtout du calcium ionisé.
Dans le plasma, le taux du calcium total est remarquablement fixe : de 95 à 105 mg par litre, dosé par les méthodes complexométriques classiques, de 86 à 96 mg par la méthode moderne d'absorption atomique. Le taux de la calcémie est réglé par un mécanisme de rétroaction tel que sa diminution entraîne une sécrétion accrue de parathormone et que l'hypercalcémie supprime cette sécrétion et suscite la production de calcitonine. Cette régulation est habituellement si précise que le taux de la calcémie est une des constantes les plus fixes de l'organisme. Pourtant, le calcium plasmatique ne constitue pas un secteur homogène. En effet, 40 p. 100 sont liés aux protéines (surtout les albumines) sous forme de protéinate de calcium ; cette fraction constitue la partie non ultrafiltrable du calcium plasmatique ; le reste se répartit en une fraction ionisée (55 p. 100) et une fraction ultrafiltrable, mais dissimulée aux échanges métaboliques grâce à une chélation par les acides citrique et lactique (5 p. 100).
Pertes de calcium par l'organisme
C'est à partir du calcium plasmatique que se font les pertes de calcium ; les urines, les fèces, la sueur éliminent chaque jour une quantité de calcium que l'alimentation doit compenser.
Le glomérule rénal laisse passer le calcium ultrafiltrable du plasma qui n'est pas réabsorbé entièrement par le système tubulaire, et l'urine définitive en contient, par 24 heures, de 100 à 300 mg. La calciurie dépend peu du régime alimentaire ; lorsque celui-ci est très riche en calcium, l' intestin n'absorbe pas de calcium en excès ; un régime sans calcium abaisse peu la calciurie ; par contre, lorsque l' absorption intestinale est majorée par la vitamine D, la calciurie augmente si le squelette n'a pas besoin de ce calcium excédentaire.
Certaines affections rénales peuvent se traduire par une hypercalciurie (acidose tubulaire, « hypercalcémie idiopathique »), d'autres par une hypocalciurie (insuffisance rénale globale).
L'ostéolyse libère le calcium osseux et augmente la calciurie (hyperparathyroïdisme).
L'intestin constitue une voie de déperdition calcique obligatoire, car les sécrétions digestives (pancréatique, biliaire, gastrique et iléale) contiennent du calcium « endogène », qui se mélange au calcium alimentaire et n'est réabsorbé qu'en partie. Normalement, la perte quotidienne représentée par le « calcium endogène fécal » est de 140 mg. Les techniques utilisant le calcium isotopique permettent de le mesurer avec une précision suffisante. Le calcium endogène fécal est augmenté dans les entéropathies ; il diminue lorsque l'absorption intestinale augmente.
La sueur est aussi une cause de perte calcique, souvent négligée dans les bilans. On l'estime à 50 mg par jour, mais elle pourrait atteindre 300 mg.
Besoins alimentaires
L'organisme adulte normal perd ainsi chaque jour une quantité de calcium de l'ordre de 400 mg, que l'alimentation doit remplacer. Compte tenu de l'absorption digestive qui ne concerne qu'à peine la moitié du calcium ingéré, les besoins alimentaires sont donc en moyenne de 800 mg. Chez l'enfant, qui doit non seulement équilibrer les pertes, mais aussi construire son squelette, les besoins sont doublés. Chez la femme enceinte et au cours de l'allaitement, les besoins sont triplés.
Les aliments riches en calcium sont : les fromages (de 100 à 500 mg pour 100 g), le lait (100 mg), les choux (50 mg), les légumes secs (100 mg) et les fruits secs (200 mg).
Absorption
L'absorption du calcium est assurée par deux mécanismes distincts : l'un est passif, par simple diffusion (son importance est mal connue) ; l'autre est un processus actif, situé dans la dernière portion du duodénum et les 30 cm initiaux de l'iléon.
L'ion calcium est transporté du pôle muqueux au pôle séreux de la cellule intestinale par la protéine vectrice de Wassermann. La synthèse ou la mise en jeu de cette protéine demande la présence de vitamine D sous sa forme hydroxylée. La fraction active de la vitamine D semble être, non pas le 25-OH cholécalciférol, mais le 1.25-OH cholécalciférol. Une bonne absorption calcique demande une muqueuse intacte, une ionisation du calcium alimentaire, une absorption du calcium alimentaire, une absorption normale de vitamine D et une bonne hydroxylation hépatique de celle-ci.
L'absorption intestinale du calcium concerne de 20 à 60 p. 100 de calcium alimentaire. Il existe probablement une adaptation aux besoins de l'organisme, mais le mécanisme de celle-ci est peu connu. On sait que la parathormone et les œstrogènes favorisent l'absorption, alors que le cortisol la déprime.
Échanges internes
Lorsque l'organisme adulte paraît en équilibre calcique, rien ne permet extérieurement de soupçonner l'ampleur et même l'existence d'un va-et-vient permanent du calcium entre le squelette et les liquides extracellulaires.
À chaque instant, les cellules osseuses libèrent ou fixent du calcium en des points différents du squelette. Celui-ci apparaît comme un organe en constant remaniement, équilibré lorsque l'ostéolyse et l'accrétion sont égales ; les chiffres donnés par les méthodes au radiocalcium sont de l'ordre de 500 mg/jour pour chacun de ces phénomènes.
Cela montre bien que les cellules osseuses sont en fonction de façon permanente, les ostéoblastes édifiant la matrice protéique et assurant la nucléation du cristal osseux, les ostéoclastes et les ostéocytes détruisant une quantité équivalente de tissu osseux. C'est par l'intermédiaire de ces cellules que se fait une partie de la régulation, parfois même aux dépens de l'intégrité du squelette.
Régulation
L'organisme est équipé pour maintenir la calcémie à un niveau constant : l'efficacité physiologique fondamentale de cette régulation repose sur l'action du couple hormonal parathormone- calcitonine. Lorsque la calcémie baisse, le taux de parathormone augmente immédiatement dans le plasma. Lorsque la calcémie augmente, le taux de parathormone tend vers zéro et la calcitonine est sécrétée. La parathormone produite par les parathyroïdes rétablit la calcémie, d'une part, en augmentant l'ostéolyse et l'absorption calcique, d'autre part, en diminuant la calciurie. La calcitonine que sécrète la thyroïde abaisse la calcémie en freinant l'ostéolyse. On sait, depuis 2007, que la thyrotropine d'origine hypophysaire contribue aussi à inhiber l'activité des ostéoclastes (application thérapeutique : empêcher l'ostéoporose).
D'autres hormones ont une influence sur le métabolisme du calcium. Leur participation directe à un système de régulation n'est pas établie. Il s'agit : des hormones sexuelles qui stimulent l'absorption et l'activité ostéoblastique du cortisol qui les déprime, de la thyroxine, de l'hormone somatotrope et du glucagon par leur action sur le développement individuel. Outre son action primordiale sur l'absorption, la vitamine D facilite l'action de la parathormone.
Métabolisme du phosphore
Moins bien connu que celui du calcium, le métabolisme du phosphore est beaucoup plus complexe, car il est lié à de nombreux phénomènes métaboliques extra-osseux.
État et répartition dans l'organisme
L'organisme adulte contient environ 650 g de phosphore, dont 500 g sont combinés au calcium dans le cristal osseux. Le reste se retrouve dans les tissus mous, notamment les muscles et le foie, lié aux lipides, aux protéines et aux systèmes enzymatiques. Dans le plasma, on distingue le phosphore organique, lié aux lipides et aux protéines, et le phosphore minéral, ionisé sous forme de radicaux phosphoriques monovalents et divalents. Les phosphates minéraux non seulement concourent à la minéralisation du squelette, mais constituent également un important système tampon pour la régulation du pH plasmatique. En pratique, on ne dose pas le phosphore total du plasma (130 mg/l en moyenne), mais seulement le phosphore minéral.
La phosphorémie est susceptible de varier en fonction de nombreux facteurs. Son taux n'est pas maintenu à un niveau fixe comme celui de la calcémie, faute d'un système régulateur précis. Au cours de la vie, la phosphorémie tend à s'abaisser : de 60 mg/l dans l'enfance, elle passe à la fin de la croissance à son taux définitif de 35 ± 8 mg/l. La présence de phosphore dans les hématies explique que l'hémolyse soit une cause d'erreurs de dosage. La phosphorémie, comme la phosphaturie, suit un rythme circadien. Les liquides extracellulaires contiennent environ 2 g de phosphore.
Pertes de phosphore par l'organisme
Les pertes de phosphore se produisent au niveau du rein et de l'intestin.
Le phosphore fécal est composé à la fois de phosphore alimentaire non absorbé et de phosphore « endogène » lipidique. Les épreuves d'absorption au phosphore isotopique, beaucoup moins étudiées que celles qui concernent le calcium, ne permettent pas encore d'avoir une estimation précise de ce phénomène.
Le glomérule rénal laisse passer le phosphore minéral. Celui-ci est ensuite réabsorbé par le tube proximal et sécrété dans le tube distal. La traversée rénale du phosphore minéral peut s'exprimer en terme de clearance : celle-ci est de 8,5 mais ses limites de variations sont assez larges (de 5 à 15). La « réabsorption tubulaire » est de 90 p. 100.
La phosphaturie par 24 heures se situe autour de 600 mg, mais peut varier en fonction de l'apport alimentaire. Lorsque l'intestin n'absorbe pas de phosphore, lors du jeûne ou des traitements par l'alumine, la phosphaturie s'effondre et tend vers zéro.
La clearance rénale du phosphore est influencée par la parathormone et la calcitonine, qui l'augmentent. Il ne s'agit pas d'une régulation, car la sécrétion de ces deux hormones ne dépend pas de la phosphorémie, mais seulement de la calcémie. D'importantes pertes de phosphore par le rein peuvent se produire lorsque la parathormone est sécrétée en excès, ou lorsque le tube proximal a perdu ses possibilités normales de réabsorption (syndrome de Fanconi).
Besoins
Les besoins en phosphore sont chiffrés à 800 mg/jour chez l'adulte, au double chez l'enfant et au triple au cours de la grossesse et de l'allaitement, et surtout pendant les années qui suivent la ménopause (cf. Les maladies des os : déminéralisations). Le rapport alimentaire optimal Ca/P est de 1. Les carences spontanées en phosphore n'existent pas chez l'homme, car presque tous les aliments en contiennent d'appréciables quantités.
Absorption
L'absorption du phosphore a lieu dans l'iléon, indépendamment de celle du calcium, et connaît son maximum dans une zone située plus bas que celle-ci. Elle semble facilitée par la vitamine D, dont la présence n'est pourtant pas indispensable. Les phosphatases du milieu intestinal et de la cellule joueraient un rôle important. Les possibilités d'absorption semblent supérieures à l'apport alimentaire, et le phosphore non utilisé apparaît dans les urines.
Échanges internes et régulation
Le nombre (qui dépasse la dizaine) et la diversité des compartiments phosphorés dans l'organisme ne permettent pas encore d'avoir la moindre information sur l'importance des phénomènes d'échanges. Leur existence est cependant hautement vraisemblable.
La régulation du métabolisme du phosphore ne vise pas à maintenir, comme pour le calcium, une homéostasie extracellulaire. Les seules relations apparentes concernent l'absorption et l'élimination rénales, celle-ci variant en fonction directe de celle-là. Il est probable qu'à l'échelon intracellulaire existe un mécanisme de stockage mitochondrial, mais cette notion est encore très imprécise. Quant aux actions hormonales, elles ne sont pas directement liées aux variations du phosphore extracellulaire, seul connu aujourd'hui. Elles apparaissent secondaires aux modifications de la calcémie.
Bien des obscurités persistent sur de nombreux stades importants du métabolisme du phosphore, qui apparaît très différent du métabolisme calcique. Leur seul point commun est le cristal osseux, à l'édification duquel ils participent conjointement.
Le cristal osseux
Le cristal osseux est un phosphocarbonate de calcium très proche d'un phosphate de calcium naturel appelé hydroxyapatite. Sa composition exacte varie avec l'âge et avec l'équilibre acidobasique du milieu. Deux phases s'y succèdent dans l'espace : au centre, un noyau ne prenant pas part aux phénomènes métaboliques journaliers ; à la périphérie, une couronne dans laquelle on trouve des oligo-éléments (zinc, magnésium), des carbonates, du sodium, des acides organiques doués d'un pouvoir de chélation vis-à-vis du calcium (citrates surtout) et des pyrophosphates. Cette zone périphérique du cristal est labile ; elle participe aux échanges minéraux par l'intermédiaire du liquide extracellulaire, qui l'environne, et des cellules osseuses, qui interviennent dans son édification et sa dissolution.
Le cristal osseux est enfermé dans une matrice conjonctive faite de collagène fibrillaire à structure périodique (64 nanomètres). Les ostéoblastes sont responsables de l'édification de ce tissu ; ils assurent également le processus initial de formation du cristal : la nucléation. À partir de cet élément, dont la formation demande une notable consommation d'énergie, le cristal va s'achever passivement en fonction de la concentration en calcium et en phosphore du milieu péricristallin. Dans les conditions normales, ce milieu contiendrait une concentration en phosphate de calcium supérieure au point de saturation (Neuman) et la cristallisation est automatique. Lorsque ce milieu manque de calcium ou de phosphore, l'apposition automatique est suspendue et l'os ne se minéralise pas.
Le produit calcémie par phosphorémie donne de la nucléation un reflet, très éloigné certes de la réalité tissulaire, mais suffisant en pratique : lorsqu'il est inférieur à 3 000, l'édification du cristal est compromise ; cela peut être dû à une baisse du calcium ou du phosphore, aboutissant dans les deux cas à une ostéomalacie (cf. chap. 3 Les maladies des os).
L'édification de tissu osseux nouveau est, chez l'adulte, contrebalancée par la destruction d'une quantité équivalente d'os ancien, travail assuré en plusieurs temps par les ostéoclastes : dissolution du cristal par sécrétion d'acides citrique, lactique et tartrique, qui emportent le calcium par chélation ; destruction de la trame conjonctive par protéolyse.
Lorsque la calcémie s'abaisse, le taux de parathormone augmente, et les processus d'ostéolyse libèrent de l'os la quantité de calcium nécessaire à l'homéostasie. En cas d'hypercalcémie, la calcitonine supprime l'ostéolyse et l'apport calcique qu'elle représente, l'homéostasie calcique extracellulaire étant toujours prioritaire sur la teneur en calcium du squelette. Cette donnée fondamentale du métabolisme calcique n'a pas d'équivalent connu pour le phosphore, dont le rôle dans l'édification du squelette est cependant d'une égale importance.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Jean-Paul CAMUS : professeur de rhumatologie à l'université de Paris-VI-Pierre-et Marie-Curie
- Armand de RICQLÈS : professeur au Collège de France, chaire de biologie historique et évolutionnisme
- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis
Classification
Médias
Autres références
-
ALGODYSTROPHIE
- Écrit par Didier LAVERGNE
- 136 mots
Syndrome douloureux ostéoarticulaire accompagnant un remaniement du tissu osseux provoqué par des causes diverses : traumatisme violent (fracture), microtraumatismes (exercice de certaines professions), immobilisation d'un membre pour des raisons thérapeutiques (traitement d'une entorse) ou dans...
-
ARTICULATIONS
- Écrit par Claude GILLOT et André-Paul PELTIER
- 6 074 mots
- 4 médias
Lesextrémités osseuses juxta-articulaires ou épiphyses, situées de part et d'autre de l'articulation, sont recouvertes d'un cartilage dit cartilage articulaire ou cartilage d'encroûtement. La zone osseuse située immédiatement sous le cartilage, ou « couche osseuse sous-chondrale », est renforcée par... -
AUTRUCHES FOSSILES
- Écrit par Eric BUFFETAUT
- 1 896 mots
- 2 médias
L’autruche, dont les individus mâles peuvent atteindre un poids de 150 kilogrammes et une hauteur de 2,75 mètres, est le plus grand des oiseaux contemporains. Elle est représentée par le genre Struthio, avec deux espèces actuelles : Struthio camelus(l’autruche commune) et Struthio molybdophanes...
-
COLLAGÈNE
- Écrit par Ladislas ROBERT
- 3 435 mots
- 4 médias
Comme le collagène de type I forme la majeure partie (∼ 80 p. 100) de la trame fibreuse des tissus calcifiables tels que l'os, les modifications de sa biosynthèse à ce niveau donnent des malformations congénitales, difficilement compatibles avec la survie des individus, comme les ostéogenèses... - Afficher les 36 références
Voir aussi
- CLEARANCE
- INTESTIN
- HISTOLOGIE ANIMALE
- RÉGULATION MÉTABOLIQUE
- PARATHORMONE
- PHOSPHOCALCIQUE MÉTABOLISME
- OSTÉOPOROSE
- OSTÉOMALACIE
- OSTÉOCLASTE
- STRUCTURE, biologie
- OSTÉOSARCOME
- OSTÉOBLASTE
- OSTÉOCYTE
- PÉRIOSTE
- FLUOROSE
- CALCITONINE ou THYROCALCITONINE
- DIAPHYSE
- PLASMA SANGUIN
- CHONDROCYTE
- OSTÉOPATHIES DYSTROPHIQUES
- ABSORPTION INTESTINALE
- ADIPOCYTE
- MÉTABOLIQUES MALADIES
- RECKLINGHAUSEN MALADIE DE
- VITAMINES D ou CALCIFÉROLS
- BIOMÉCANIQUE
- ÉPIPHYSE OSSEUSE
- BESOINS NUTRITIONNELS ou BESOINS ALIMENTAIRES, physiologie
- OSTÉOCALCINE
- ADINOPECTINE
- ACHONDROPLASIE
- OSSIFICATION ou OSTÉOGENÈSE
- MINÉRALISATION CELLULAIRE & TISSULAIRE
- PAGET MALADIE DE
- HYDROXYAPATITE
- DÉMINÉRALISATION, médecine
- McCUNE-ALBRIGHT SYNDROME DE
- GLOMÉRULE RÉNAL
- OSTÉOPÉTROSE
- HÉMOPATHIES
- MALABSORPTION
- SQUELETTE HUMAIN
- HISTIOCYTOSE X
- OSTÉITE
- RÉABSORPTION, physiologie
- ALIMENTATION, physiologie humaine
- HYPERPARATHYROÏDIE
- BIOLOGIE HISTOIRE DE LA