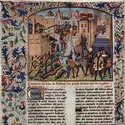PALÉOGRAPHIE
Article modifié le
Paléographie latine
La paléographie latine est née une trentaine d'années avant la paléographie grecque et dans des conditions très différentes : c'est en effet à la suite d'une polémique avec le bollandiste Daniel Papebroch sur l'authenticité des actes mérovingiens que dom Jean Mabillon, bénédictin de la congrégation de Saint-Maur, fut amené à publier en 1681 son De re diplomatica : la paléographie n'y occupait que les quatre derniers chapitres. Comme les premiers naturalistes dont il est le contemporain, Mabillon a cherché à classer les écritures d'après leurs formes extérieures : « Par la structure des plantes, on entend la composition et l'assemblage des pièces qui en forment le corps », écrivait Joseph Pitton de Tournefort dans ses Éléments de botanique (1694). Mabillon distingue donc trois types d'écritures romaines : uncialis ou capitalis, minuta ou minuscula, minuta forensis, et quatre types d'écritures « nationales » qu'il considère comme des créations originales : gothique, lombarde, franque, anglo-saxonne.
Cette classification fut réfutée par Scipion Maffei dans son Istoria diplomatica (1727). Maffei soutint le premier la thèse, universellement adoptée aujourd'hui, de l'unité originelle de l'écriture latine, les prétendues écritures « nationales » n'étant que des « dégénérescences » des écritures romaines.
Le chef-d'œuvre de l'école des « nomenclateurs » se trouve dans les six volumes du Nouveau Traité de diplomatique des deux bénédictins de la congrégation de Saint-Maur, dom Tassin et dom Toustain (1750-1765). La partie paléographique de leur traité est « une histoire abécédaire » où les auteurs s'efforçaient d'enseigner « l'art de déterminer l'âge et la patrie des caractères par la variété de la figure et des traits qu'ils ont contractés depuis leur origine jusqu'au xvie siècle » (t. II, p. 2). Classer ainsi les lettres d'après leur forme extérieure ne pouvait aboutir qu'à une classification arbitraire d'une complication extrême. De fait, celle des mauristes est à l'heure actuelle tout à fait inadéquate et souvent même incompréhensible.
L'étude du ductus
C'est à la fin du xixe siècle, dans l'Anleitung zur lateinischen Paläographie de W. Wattenbach (1866) et dans les travaux de Léopold Delisle, que de nouvelles tendances plus fructueuses s'affirmèrent : elles participent un peu du même esprit que celui qui depuis Cuvier anime les recherches du naturaliste. Ce n'est plus d'après leur forme que le paléographe étudie les lettres : il cherche à restituer le ductus, c'est-à-dire le mouvement de la plume qui les engendre ; il devient, comme disent les botanistes, un « généticien ».
Au début du xxe siècle, en Angleterre et en Autriche, deux calligraphes, Edward Johnston et Rudolph von Larisch, s'inspirent dans leurs recherches des manuscrits latins. Ils sont ainsi amenés à approfondir l'étude de la technique, à retrouver la forme et la tenue de la plume les mieux adaptées aux tracés des caractères anciens, à en préciser le ductus.
En France, et bien qu'ils ignorent alors les travaux de Johnston et de Larisch, des paléographes, vers 1938, conduisent leurs études suivant des méthodes analogues.
D'autre part, dès la fin du xixe siècle, Ludwig Traube assignait à la paléographie sa véritable place parmi les sciences historiques en considérant l'écriture comme l'expression d'une civilisation.
Mais les efforts des paléographes latinistes ont été longtemps entravés par l'ignorance où ils étaient des écritures latines antérieures au ve siècle.
Les premiers graffitipompéiens, source essentielle de la connaissance des écritures usuelles au ier siècle de notre ère, ont été mis au jour en 1765 ; leur première publication, en 1792, passa inaperçue. Il fallut attendre la publication par C. Zangemeister du tome IV du Corpus inscriptionum latinarum. Inscriptiones parietariae pompeianae, à Berlin, en 1871, pour que les paléographes s'y intéressent, d'ailleurs modérément.
Dès 1730, à Herculanum, à côté des papyrus de Philodème, on avait découvert des papyrus latins carbonisés en très mauvais état : un seul, le Carmen de bello actiaco, fut dessiné et gravé en 1793 ; deux autres furent partiellement reproduits par Zangemeister et Wattenbach dans leurs Exempla codicum latinorum litteris maiusculis scriptorum. Enfin, les découvertes des papyrus égyptiens n'eurent pas pour la paléographie latine la même importance que pour la grecque : de 1895 à 1914, on n'en avait découvert que deux cents environ, dont la moitié étaient alors publiés et une cinquantaine reproduits. C'est seulement en 1921 que Luigi Schiaparelli annexa définitivement à la paléographie latine l'étude de toutes les écritures antérieures au ve siècle.
D'autre part, les paléographes n'ont su utiliser rationnellement la photographie qu'assez tard. En 1952, on continuait encore à croire, comme en 1871, que les graffiti pompéiens et les papyrus carbonisés d'Herculanum (à l'exception de trois d'entre eux, mieux conservés) ne pouvaient être photographiés. Depuis 1858, on a publié d'assez nombreux recueils de fac-similés des manuscrits médiévaux, mais sans aucun plan méthodique. Ce n'est qu'en 1934 que E. A. Lowe a eu l'idée et l'énergie de réaliser un répertoire photographique intégral de tous les manuscrits antérieurs à l'an 800 ; A. Bruckner et R. Marichal ont suivi, mutatis mutandis, à partir de 1954, l'exemple de Lowe pour les « documents ». Un colloque international a décidé, en 1953, d'entreprendre un catalogue photographique de tous les manuscrits datés.
Bien que les paléographes n'aient pas encore pu exploiter ces collections qui demeurent inachevées, les grandes lignes de l'évolution de l'écriture latine sont, dès maintenant, assez bien connues.
Les écritures latines antiques
L'alphabet latin est un alphabet grec occidental emprunté par l'intermédiaire des Étrusques. La plus ancienne inscription latine connue est la loi découverte sous le Niger Lapis du Forum romain et attribuée à la fin du vie siècle. C'est une capitale très fruste ; elle a pris sa forme définitive à la fin de la République. Les premiers livres romains connus, les papyrus d'Herculanum, antérieurs donc à l'éruption du Vésuve qui ensevelit la ville en 79, sont écrits dans une capitale que l'on appelle « rustique » ; elle est également utilisée dans les affiches peintes sur les murs et dans certains documents ; elle se caractérise par des lignes horizontales très grosses, des lignes verticales très maigres correspondant à une position du bec du calame faisant avec la ligne sur laquelle repose l'écriture un angle d'environ 60o, et par le dépassement en haut et à gauche des traits obliques de gauche à droite. L'usage de cette capitale s'est prolongé, au moins pour les livres de grande qualité, jusqu'à la chute de l'Empire.
Dans l'usage courant, elle a donné naissance à une cursive devenue tout à fait autonome dès les débuts du Principat et dont les graffiti et les tablettes de cire les plus soignés de Pompéi nous fournissent de nombreux exemples ; elle fut utilisée, plus ou moins évoluée, dans tous les documents jusqu'au iiie siècle de notre ère ; on l'appelle cursive ancienne ou majuscule cursive .
Aux iiie et ive siècles apparaissent trois nouvelles écritures : dans les livres la minuscule primitive, qu'on appelle parfois semi-onciale, dénomination qu'il est préférable de réserver à la forme canonisée qu'elle a reçue vers le ve siècle, et l'onciale ; la première, comme le nom qu'on lui a donné l'indique, annonce déjà la minuscule caroline ; la seconde est encore une capitale, sans empattement et où prédominent les formes rondes ; toutes deux ont des traits horizontaux maigres, des traits verticaux gras – le contraire donc de la capitale – et ont dû être écrites avec un calame dont le bec ne formait qu'un angle de 15o avec la ligne de base de l'écriture. Comme l'onciale biblique grecque, onciale et semi-onciale seront par excellence les écritures des livres chrétiens : elles ont été employées usuellement, plus ou moins correctement, jusqu'au viiie siècle et ont fourni aux manuscrits médiévaux des initiales et des majuscules.
La troisième écriture nouvelle est cette cursive documentaire dont on a dit plus haut qu'elle s'était pour ainsi dire confondue avec la cursive grecque contemporaine : on l'appelle cursive récente ou minuscule cursive .
L'origine de ces trois écritures est controversée : pour les uns, c'est la cursive qui a donné naissance aux écritures livresques ; pour les autres, c'est l'écriture livresque qui s'est transformée en cursive.
La chute de l'Empire et la fondation des royaumes barbares rompent l'unité de l'écriture latine ; de là, les écritures dites « nationales », les documentaires dérivant de la cursive récente, les livresques de la semi-onciale dans laquelle s'introduisent des formes cursives. On donne souvent aujourd'hui aux écritures livresques le nom de précarolines .
L'héritage de la renaissance carolingienne
Avec la renaissance carolingienne du viiie siècle se crée une nouvelle écriture livresque, la minuscule caroline : le plus ancien manuscrit datable en minuscule caroline est la Bible écrite à Corbie sous l'abbatiat de l'abbé Maurdramne (772-780). La minuscule caroline a pour base la semi-onciale : le format en a été réduit, on lui a enlevé ainsi son caractère « monumental », on lui a donné plus de souplesse, de rapidité, une densité qui permettait une grande économie de parchemin, tandis que, par l'introduction de quelques lettres précarolines bien formées, on lui conférait une lisibilité telle que, depuis que les humanistes du xive siècle l'ont remise en honneur et fait adopter par les imprimeurs, il ne lui a été apporté jusqu'à nos jours aucune modification structurale.
La caroline s'est étendue à toutes les régions de l'Europe où s'écrivait le latin : la conquête normande en Angleterre, la Reconquista en Espagne ont expulsé les écritures insulaires et les écritures wisigothiques ; c'est pacifiquement, et lorsque les hautes études émigrèrent des couvents dans les universités, qu'elle supplanta, dans le sud de l'Italie, sa grande rivale culturelle, la bénéventine ou écriture du Mont-Cassin, à la fin du xiiie siècle.
Mais, à cette date, la caroline a pris un nouvel aspect dont le trait le plus apparent est la décomposition des arcatures courbes en angles aigus – ce que les paléographes appellent la « brisure » ; cette évolution, qui n'altère point la structure, a commencé en Angleterre dès le xie siècle ; elle tient probablement à une modification technique : la taille en biseau du bec de la plume. Les humanistes, qui méprisaient cette écriture comme les textes qu'elle transcrivait, l'ont traitée de gothique, comme les cathédrales dont elle est contemporaine, et sans d'ailleurs établir entre son caractère anguleux et les arcs brisés le rapprochement assez superficiel que l'on est tenté de faire. L'écriture gothique est, sous sa forme la plus usuelle, l'écriture des universités ; sous ses formes solennelles, celle des grands livres liturgiques.
Dans les documents, la caroline est d'usage courant dès la fin du ixe siècle ; elle devient de plus en plus cursive à mesure que l'usage de l'écriture se développe, au moins dans les milieux urbains.
À partir du xive siècle, la cursive donne naissance à une nouvelle écriture livresque nommée bâtarde .
Enfin à Florence, au début du xve siècle, les humanistes, admirant l'écriture des manuscrits du xe et du xie siècle qu'ils recherchent avidement pour y retrouver les textes classiques plus ou moins délaissés par les scolastiques, l'imitent tout en la perfectionnant par une plus grande régularité, l'addition de petits empattements aux bases des traits verticaux, une refonte de certaines lettres comme le g. On lui donne le nom d'humanistique, ou plus précisément d'humanistique ronde. À côté, mais provenant cette fois de la cursive gothique florentine influencée par la nouvelle livresque, apparaît dans l'usage courant l'humanistique cursive .
Les premiers imprimeurs utilisent la gothique sous ses formes les plus solennelles bientôt réservées comme dans les manuscrits aux livres liturgiques, une lettre de somme, plus simple, pour les ouvrages scolastiques, la bâtarde pour les œuvres en langue vernaculaire, l'humanistique ronde (le romain, que K. Sweynheym et A. Pannartz employèrent les premiers à Subiaco en 1465) et l'humanistique cursive (l'italique, qui fut inventée par Alde Manuce en 1500) pour les classiques.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Robert MARICHAL : directeur d'étude à l'École pratique des hautes études (sciences historiques et philologiques)
Classification
Autres références
-
CHAMPOLLION JEAN-FRANÇOIS (1790-1832)
- Écrit par Annie FORGEAU
- 1 686 mots
- 2 médias
Un peu avant midi, le 14 septembre 1822, Jean-François Champollion fait irruption dans le bureau de son frère Jacques-Joseph dans la bibliothèque de l'Institut de France et déclare triomphant : « Je tiens l'affaire. » La tradition veut que le déchiffreur de la langue égyptienne tombe sans connaissance,...
-
ÉCRITURE (notions de base)
- Écrit par Encyclopædia Universalis
- 2 598 mots
- 7 médias
L’invention de l’écriture a permis aux hommes de fixer leur histoire. Elle coïncide avec la formation des premières civilisations. L’histoire de l’écriture, des transformations de l’image figurée en symbole graphique, se déroule sur plusieurs millénaires. Le passage des systèmes idéographiques aux systèmes...
-
ERLANDE-BRANDENBURG ALAIN (1937-2020)
- Écrit par Jean-Michel LENIAUD
- 946 mots
Alain Brandenburg, dit Alain Erlande-Brandenburg, naquit le 2 août 1937 à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), où son grand-père maternel était médecin. Son autre grand-père, Albert-Jacques Brandenburg, avait pris le pseudonyme d’Albert Erlande pour la publication de son œuvre littéraire. Il comptait...
-
MANUSCRITS - Histoire
- Écrit par Emmanuèle BAUMGARTNER , Geneviève HASENOHR et Jean VEZIN
- 7 309 mots
- 9 médias
...les noms de Philippe et d'Antiochus y figurent, on a pris l'habitude de le désigner sous le titre de De bellis Macedonicis (British Library, Pap. 745). Les premiers savants qui ont étudié ce fragment n'ont pas osé le dater plus haut que le iiie siècle de notre ère, précisément parce qu'il provenait...
Voir aussi