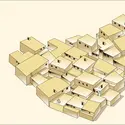PALÉOLITHIQUE
Article modifié le
L'homme moderne. Paléolithique supérieur
En comparaison des centaines de milliers d'années que constitue le passé de l'humanité au Paléolithique inférieur et moyen, les quelques dizaines de milliers d'années que recouvrent les cultures du Paléolithique supérieur paraissent infimes. Cette dernière étape se situe, pour l'Europe, où elle est connue avec le plus de détails, dans la deuxième partie de la dernière glaciation de Würm. Elle débute environ 35 000 ans avant notre ère pour s'achever environ 26 000 ans plus tard avec les temps glaciaires. L'environnement n'est guère différent de ce qu'il était au Paléolithique moyen, du moins en Europe : le climat est encore plus rigoureux.
Cette période d'environ 25 millénaires est marquée par des événements majeurs : une nouvelle technologie et l'élargissement de l'œkoumène, le développement de l'art. Il est tentant de mettre en relation ces innovations ou leur développement avec le nouvel aspect physique de l'homme désormais anthropologiquement sapiens. Mais il est peu certain que ces événements soient autre chose que des coïncidences chronologiques. À l'hypothèse de la révolution du Paléolithique supérieur, d'un homme nouveau, armé d'outils plus complexes, heureux conquérant de territoires jusque-là inconnus de lui, qui porte l'espèce au niveau de la création artistique, se substituent des explications plus nuancées, car certaines découvertes démontrent que ces divers événements étaient en germe dans les périodes antérieures, même les plus reculées.
Une nouvelle technologie
En France
C'est en France que les diverses cultures sont les mieux connues, grâce aux subdivisions établies par H. Breuil de façon détaillée, et que les caractères d'une nouvelle technologie ont été mis en évidence. Presque inconnu jusqu'à cette époque, le travail de l'os, du bois de cervidés et de l'ivoire s'y développe remarquablement : des outils aussi complexes que des sagaies à biseau, des harpons, des redresseurs de flèches et des propulseurs, des aiguilles à chas sont produits, ainsi que d'étonnantes œuvres d'art. L'usage de la lame ne fait pas, comme on l'a cru, l'originalité exclusive du Paléolithique supérieur dans le domaine de l'outillage lithique. C'est en fait l'invention de types d'outils sans cesse renouvelés qui individualise véritablement cette période. Les burins, les grattoirs et les perçoirs, déjà présents en faible proportion au Paléolithique moyen et même ancien, sont désormais utilisés sous des formes extrêmement variées ; les outils doubles et les outils composites qui associent des types d'outils différents sur une même pièce se multiplient. Bien que les proportions numériques de ces divers types varient fortement d'une culture à l'autre, ce fonds commun donne au Paléolithique supérieur une réelle unité typologique. Mais des outils nouveaux propres à une seule industrie sont constamment inventés. La classification des industries a été établie en France sur des bases stratigraphiques plus fermes que nulle part ailleurs en Europe, et l'évolution des industries françaises a servi de référence pour la classification des industries dans les autres pays d'Europe.
Le début du Paléolithique supérieur est occupé par le cycle des industries aurignaco-périgordiennes. H. Breuil y voyait le déroulement linéaire d'une seule culture, l'Aurignacien, qu'il subdivisait en niveaux à pointes de Châtelperron dans l'Allier (pointes de silex à dos courbe) ; puis en niveaux à pointes en os à base fendue ; enfin en niveaux à pointes de La Gravette en Dordogne (pointes de silex élancées à dos rectiligne). D. Peyrony a distingué dans cet ensemble les niveaux à pointes de silex à dos abattu, et l'Aurignacien sensu stricto, les niveaux à pointes en os.
Dans son stade ancien, le Périgordien a un outillage de facture médiocre, encore chargé de types moustériens, mais, dans son stade évolué, il se distingue par l'excellence de son débitage, l'abondance des burins souvent multiples, l'invention de nombreux outils spéciaux (pièces tronquées, petits burins multiples, pointes à soie), et par l'apparition des lamelles à dos. Son outillage en os est peu varié et peu abondant.
L'Aurignacien (site d'Aurignac dans la Haute-Garonne) se caractérise par son bel outillage en os et par un outillage lithique qui comprend des pièces à fortes retouches écailleuses, des grattoirs épais, carénés et à museau, des burins busqués et des lamelles à retouches semi-abruptes.
Partout, les industries du Périgordien et de l'Aurignacien sont totalement indépendantes l'une de l'autre et ne montrent dans leur composition aucune trace d'influence réciproque, bien que les séquences stratigraphiques démontrent qu'elles ont évolué parallèlement et se sont interstratifiées.
Le Solutréen (site de Solutré en Saône-et-Loire) est caractérisé par l'usage de la retouche plate, à bords parallèles, aussi bien sur les outils communs que sur les pièces typiques, les pointes à face plane, les feuilles de laurier, les feuilles de saule et les pointes à cran. Son outillage en os est médiocre et assez peu varié.
L'outillage en os est au Magdalénien (site de La Madeleine, Dordogne) particulièrement abondant et très élaboré, les sagaies distinguant les niveaux inférieurs et les harpons les stades supérieurs. L'outillage lithique se caractérise par sa composition statistique très homogène, avec, dans les stades les plus anciens, des raclettes, petits outils à retouches abruptes, et des triangles sur lamelles, et, dans le stade final, des burins en bec de perroquet, des pointes à cran, des pièces foliacées et, parfois, des microlithes géométriques qui seront développés ultérieurement au Mésolithique. Les œuvres d'art abondent.
Avec l' Azilien (grotte du Mas-d'Azil, Ariège) s'achève le Paléolithique supérieur : l'outillage lithique est appauvri ; il comprend de petites pointes à dos courbe et de petits grattoirs, accompagnés de harpons plats en bois de cerf et parfois aussi de galets gravés de signes géométriques ou peints en rouge et noir.
Hors de France
Par rapport à la France, les lacunes archéologiques sont importantes dans l'Europe de l'Ouest : le Périgordien inférieur est rare et limité aux régions situées au sud de la Loire ; il s'étend peu au-delà des Pyrénées, quoiqu'il y en ait quelques traces en Catalogne et que son existence soit révélée dans la région de Santander ; le Solutréen est absent sous sa forme classique, en dehors de la région franco-cantabrique ; les fouilles n'ont rien livré entre l'Aurignacien et le Magdalénien en Belgique, en Angleterre et en Allemagne, alors que les sites de l'ex-Tchécoslovaquie et ceux de l'Autriche révèlent le développement d'industries voisines du Périgordien de l'Ouest. Cependant, la Russie est très riche en Paléolithique supérieur, en particulier dans la région de Kostenki-Borčevo sur le Don, où se trouvent des industries originales.
Il n'existe pas de ressemblances rigoureuses entre les industries de la fin du Paléolithique en Asie et en Afrique et celles de l'Europe. En Asie, le Paléolithique supérieur évolue différemment selon les régions. Ainsi, en Asie Mineure, au Liban, en Syrie et en Israël se développe une forme orientale de l'Aurignacien, que précèdent des industries encore mal connues que les fouilles de Ksar-Akil (Liban) vont permettre de caractériser. Cet Aurignacien est suivi d'industries qui en sont peut-être une dérivation et qui se transforment au Natoufien, rattaché au Mésolithique. Le Paléolithique supérieur commence juste à être reconnu en Iran, en Afghanistan et dans l'Inde péninsulaire. En Sibérie, le Paléolithique supérieur contient des formes moustériennes associées à des outils plus évolués. En Chine, il est connu dans les régions lœssiques et aussi dans la grotte supérieure de Chou-k'ou-tien.
L'existence du Paléolithique au Japon n'a été reconnue que vers 1945 : il s'agit de Paléolithique peut-être ancien ou moyen et de Paléolithique supérieur. À Bornéo, la grotte de Niah a livré une industrie qui se rapproche du Soanien supérieur de l'Inde, mais qui est d'âge paléolithique supérieur. En Australie, des recherches ont amené la découverte de documents qui remontent à plus de 20 000 ans, époque où le polissage de la pierre pour fabriquer des haches est déjà attesté.
En Afrique du Nord, des recherches en Égypte ont amené la découverte, à côté du Sébilien, industrie dérivée du Paléolithique moyen, d'industries qui ressemblent au Paléolithique supérieur européen, le Silsilien et le Sbékien, qui datent d'environ 12 000 à 13 000 ans avant notre ère. En Cyrénaïque, le Dabbien remonterait à plus de 30 000 ans (C. B. Mac Burney), mais cette date n'est pas unanimement acceptée. Au Maghreb, faisant probablement suite à l'Atérien, se place l'Ibéro-Maurusien à nombreuses lamelles à dos, puis le Capsien typique que sa ressemblance typologique avec le Périgordien d'Europe avait fait autrefois dater trop anciennement. Au sud du Sahara, le problème est complexe et des industries d'âge paléolithique supérieur semblent dériver directement du Paléolithique moyen (Stillbayen en Afrique du Sud), pour passer ensuite à des industries microlithiques.
Le peuplement de l' Amérique est peut-être plus ancien qu'on ne l'a longtemps cru : des dates de 20 000 à 30 000 ans ont été obtenues pour diverses trouvailles et des dates plus anciennes seraient peut-être possibles. Le peuplement de l'Amérique a dû s'effectuer par la traversée du détroit de Béring et s'est peut-être produit en plusieurs étapes. L'homme était parvenu à l'extrême pointe de l'Amérique du Sud au moins 8 000 ans avant notre ère. Le Paléolithique supérieur classique commencerait vers 10 000 ou 11 000 avant notre ère avec l'industrie de Clovis (Nouveau-Mexique), à pointes de projectiles cannelées, suivie de l'industrie de Folsom (Nouveau-Mexique), avec également des pointes de projectiles cannelées, très finement retouchées par pression. En Amérique centrale et en Amérique du Sud, des industries de type paléolithique supérieur comportent curieusement des types d'outil analogues à certains types de l'Ancien Monde : il s'agit de convergence.
Le développement de l'art
Après les débuts de l'art attestés par quelques signes gravés et l'usage de la couleur au Paléolithique moyen, la dernière période du Paléolithique, le Paléolithique supérieur, connaît un vaste développement artistique ; du point de vue géographique, ce développement est limité à l'Europe, qu'il s'agisse de figurations mobilières, c'est-à-dire d'objets de petites dimensions gravés, peints ou sculptés, ou de figurations pariétales, disposées sur les parois des abris de plein air ou des grottes plus ou moins profondes. À l'abbé Breuil (1877-1961) revient le mérite d'avoir exploré tous les aspects de l'art paléolithique : techniques de relevé, attribution chronologique, interprétation et signification. Les travaux de A. Leroi-Gourhan ont renouvelé l'approche de ces problèmes.
La répartition de l' art mobilier ne coïncide pas avec celle de l'art pariétal ou rupestre, qui est confiné, à quelques exceptions près, dans la région franco-cantabrique, entre la Loire, la rive gauche du Rhône et les Pyrénées cantabriques ; même si l'on a découvert à Kapova (Oural) une grotte où sont peints des mammouths, il n'existe aucun relais attesté entre ce point et la zone franco-cantabrique. En revanche, l'art mobilier est connu de l'Espagne jusqu'à l'Ukraine, avec même une extension en Sibérie dans la région du lac Baïkal, en particulier à Malta.
P. Ucko et A. Rosenfeld, en 1967, ont exposé et discuté toutes les interprétations auxquelles a donné lieu la signification de l'art paléolithique. À la théorie classique de l'art magique compris comme un procédé utilitaire de mainmise sur le gibier, qu'appuient les figurations d'animaux fléchés et peut-être pris dans des pièges, A. Laming et A. Leroi-Gourhan ont opposé une nouvelle interprétation ; elle a été établie sur la topographie des figurations pariétales, tant les unes par rapport aux autres sur les parois que d'après leur position à l'intérieur de la grotte ornée qui est comprise comme un sanctuaire systématiquement aménagé. Des méthodes statistiques ont permis d'étudier la fréquence des catégories représentées, animaux, anthropomorphes et signes énigmatiques, ainsi que leurs groupements préférentiels, leurs superpositions et leurs associations. A. Leroi-Gourhan a supposé que la totalité de l'art paléolithique exprimait une mythologie et une cosmologie fondées sur la conscience de la nature opposée et complémentaire des deux sexes, mais P. Ucko et A. Rosenfeld ont fait valoir que la variété et la richesse de l'art paléolithique ne pouvaient donner lieu à une explication unique, qu'il s'agisse des interprétations classiques ou récentes. Probablement s'y mêlent les procédés magiques de capture du gibier et de fécondité, et peut-être une notion du monde fondée sur les deux types mâle et femelle.
Pêche, chasse et cueillette
Comme leurs prédécesseurs, les hommes du Paléolithique supérieur vivent de chasse et de pêche, sans doute aussi de cueillette, peut-être avec une exploitation plus importante des rivières, car les sites livrent à la fois d'abondantes vertèbres de poissons et de nouveaux objets en os (hameçons), faciles à interpréter par référence aux peuples pêcheurs actuels (les Esquimaux par exemple) et du Magdalénien (harpons et foënes). À la même époque abondent les représentations de poissons, non seulement figuratives comme la truite gravée sur le sol de la caverne de Niaux (Ariège) et les nombreux petits objets gravés, sculptés ou découpés des sites du Périgord et des Pyrénées, mais aussi schématiques et stylisées comme les gravures qui se multiplient sur les armes et les outils à la fin du Magdalénien.
À ce genre de vie de chasseurs-pêcheurs, on a supposé que les Magdaléniens avaient ajouté au moins des tentatives de domestication animale. E. Piette attribuait aux chevêtres, licol, courroies et harnachement les traits qui surchargent la tête et le cou de nombreuses figurations animales. La « querelle du chevêtre » a animé les discussions au début du xxe siècle : pour R. de Saint-Perier, il s'agit seulement de la figuration ornementale de détails du pelage, de la musculature et de l'ossature de l'animal vivant ; pour H. Breuil, de traits adventices, stylisation secondaire, signal de la dégénérescence qui frappe le décor au déclin du Magdalénien ; selon L. Pales, ces traits, gravés postérieurement aux contours de la tête dans certains cas, peuvent représenter le début des relations de l'homme avec l'animal sans qu'il s'agisse encore de domestication proprement dite (capture occasionnelle).
Il est probable que l'homme a occupé les grottes et abris plus longtemps qu'on ne le croyait au début du xxe siècle. Il a aussi vécu en plein air, de façon plus ou moins permanente, dans des demeures construites, ou bien creusées dans les plaines de lœss de l'Europe centrale et orientale et consolidées avec les grands ossements de mammouth pour se protéger contre le froid et le vent. Les foyers construits ou creusés sont souvent délimités par des galets de rivière, peut-être pour restituer la chaleur qu'ils ont emmagasinée ou pour chauffer des liquides enfermés dans des récipients de cuir ou de pierre comme le font les Esquimaux. L'homme possède désormais l'aiguille à chas attestée à la fin du Solutréen et la lampe de pierre, trouvée parfois en abondance dans les couloirs des grottes ornées. D'après H.-V. Vallois, la vie est remarquablement brève, les femmes meurent plus tôt que les hommes, et les vieillards, peu nombreux, ne dépassent pratiquement pas l'âge de soixante ans.
Dès le stade le plus ancien de l'Aurignacien, il existe des os et bois présentant des lignes d'incision répétées, de dimensions, profondeurs, écartements et dispositions générales variables, et on trouve des objets de ce genre tout au long du Paléolithique supérieur et surtout au Solutréen et au Magdalénien. On les désigne sous le terme de « marques de chasse », mais, s'il s'agit bien d'un procédé mnémotechnique de dénombrement, on est dans l'incapacité de déterminer ce qui était ainsi dénombré : le gibier, les ennemis ou, si l'on retient une autre hypothèse, les jours avec lune et sans lune dans le laps d'une lunaison. Il existe au Magdalénien supérieur des représentations rares de petites scènes qui sont peut-être un langage pictographique. Quant aux galets coloriés de l'Azilien, ils ont même été interprétés par E. Piette comme les éléments d'une écriture.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Denise de SONNEVILLE-BORDES : maître de recherche à la faculté des sciences de Bordeaux
Classification
Autres références
-
ACHEULÉEN
- Écrit par Michèle JULIEN
- 123 mots
L’Acheuléen est une civilisation de la préhistoire ; son nom vient du gisement de Saint-Acheul, faubourg d'Amiens, où fut découvert un outillage du Paléolithique inférieur dont la pièce caractéristique est le biface. Cette culture apparaît en France vers — 700 000, mais en Afrique...
-
AFRIQUE (Histoire) - Préhistoire
- Écrit par Augustin HOLL
- 6 328 mots
- 3 médias
La transition de l'Acheuléenau Paléolithique moyen s'étale sur près de 200000 ans, de 400000 à 200000 BP, quand les processus de régionalisation se déclenchent dans plusieurs parties du continent. Les hommes modernes apparaissent durant cette même période, suggérant une seconde migration hors d'Afrique.... -
ÂGE ET PÉRIODE
- Écrit par Jean-Paul DEMOULE
- 1 958 mots
...outre un stade de développement de l'humanité. Ce système est progressivement perfectionné. En 1865, dans Prehistoric Times, l'Anglais John Lubbock subdivise l'Âge de la pierre en un « Âge de la pierre ancienne » ou « Paléolithique » et un « Âge de la pierre nouvelle » ou « Néolithique ». Ami de... -
ANATOLIENNE PRÉHISTOIRE
- Écrit par Jacques CAUVIN et Marie-Claire CAUVIN
- 2 351 mots
- 3 médias
...et Nizip (près de Gaziantep), celui de Bozova (près d'Urfa), enfin celui de Keysun (région d'Adyaman). Si on y ajoute quelques trouvailles éparses au nord-est de la Turquie, le long du Caucase, on peut conclure à une occupation assez homogène de l'Anatolie au Paléolithique inférieur récent. - Afficher les 68 références
Voir aussi
- LEAKEY LOUIS SEYMOUR BAZETT (1903-1972)
- VÉRTESSZÖLLOS SITE PRÉHISTORIQUE DE
- CLACTONIEN
- KRAPINA SITE PRÉHISTORIQUE DE
- FERRASSIE LA, Dordogne
- INHUMATION
- ASIE DU SUD-EST
- GALETS, industrie lithique
- ASIE MINEURE
- PARIÉTAL ART
- POINTE, outillage préhistorique
- MAGDALÉNIEN
- PIERRE TAILLÉE ÂGE DE LA
- PIERRE POLIE ÂGE DE LA
- MOUSTÉRIEN
- MAS-D'AZIL SITE PRÉHISTORIQUE DU, Ariège
- FEU TECHNIQUES DU
- HOMINISATION
- PERCUTEUR, outillage préhistorique
- AFRIQUE, préhistoire
- MOBILIER ART, préhistoire
- PEINTURE, art préhistorique
- PITHÉCANTHROPE
- SINANTHROPE
- AUSTRALOPITHÈQUES
- RACLOIR, outillage lithique
- EXTRÊME-ORIENT, préhistoire et archéologie
- AURIGNACIEN
- FOYER, préhistoire
- PRESSION RETOUCHE PAR, industrie lithique
- OLDUVAI ou OLDOWAY SITE PRÉHISTORIQUE D', Tanzanie
- HABITAT PRÉHISTORIQUE
- TECHNIQUES HISTOIRE DES, préhistoire
- FOSSE, sépulture
- ABBEVILLIEN
- PÉRIGORDIEN
- ÉCLATS INDUSTRIES SUR, préhistoire
- OS INDUSTRIE DE L', préhistoire