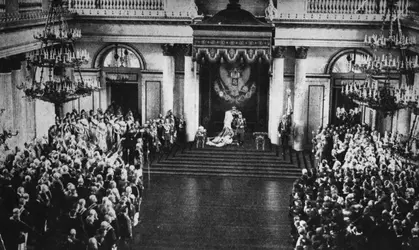PARLEMENT
Article modifié le
La fonction du Parlement
Un certain nombre de parlements jouissent du pouvoir constituant, c'est-à-dire du droit de modifier la constitution. Mais on admet généralement qu'il est nécessaire qu'ils aient été élus pour cet objet, ou qu'ils statuent à des majorités déterminées ou difficiles à réunir, ou enfin qu'ils partagent ce pouvoir avec le peuple consulté par voie de référendum. La fonction essentielle du Parlement, c'est l'exercice du pouvoir législatif, issu du droit de consentir l'impôt, et avec son corollaire, le contrôle de l'action gouvernementale. À ce double titre, le Parlement se distingue du pouvoir judiciaire, encore que quelques constitutions lui confient le jugement des procès de grande politique, notamment du crime de haute trahison, lorsqu'il est commis par le chef de l'État ou par un ministre. À l'égard du pouvoir exécutif, la séparation est beaucoup moins précise.
La publicité des débats est une règle absolue ; elle ne souffre que de rares exceptions pour les délibérations qui mettent en cause en temps de guerre la sécurité de la nation. La publicité est assurée par l'assistance des citoyens qui le désirent aux séances plénières dans des tribunes qui leur sont réservées, et par une large diffusion des comptes rendus des débats par la voie de la presse, de la radio et, dans quelques pays, de la télévision.
Les assemblées ne siègent pas en permanence. La durée de leurs sessions va de quelques jours à plusieurs mois par an, suivant l'importance des travaux que les constitutions leur confient.
Élaboration de la loi
Il convient de distinguer tout d'abord le domaine de la loi de celui du règlement. Le parlement définit les grandes règles de la législation, celles pour lesquelles il paraît indispensable que la représentation nationale s'exprime elle-même en engageant sa responsabilité. Telles sont celles qui ont trait aux garanties fondamentales, à l'organisation de la défense nationale, aux impositions, au droit de propriété, à la nationalité, à la définition des infractions pénales et des peines, etc. Des lois-cadres ou des lois de programme fixent des principes ou déterminent des directions qui serviront de base à l'action ultérieure de l'exécutif. La Constitution française de 1958 est la seule qui délimite dans un texte les matières dont la connaissance est réservée au Parlement.
Suivant les idées des constituants du moment, le Parlement peut ou ne peut pas déléguer son pouvoir législatif : la Constitution française de 1946 l'interdisait (toutefois l'interdiction ne fut pas respectée), celle de 1958 l'autorise. Mais dans tous les pays, la charge de mettre en œuvre la loi telle qu'on l'a décrite, c'est-à-dire de concevoir et de promulguer la réglementation de tous les jours, incombe au pouvoir exécutif. Partout, le domaine du règlement tend à augmenter sous prétexte de technicité ou d'efficacité. En Grande-Bretagne, comme en France, il est considérable, cependant que des règles restrictives ou des pratiques de fait tendent à réduire le rôle des parlements.
De ces errements, c'est l'initiative parlementaire qui souffre le plus. Dans les pays de stricte séparation des pouvoirs, c'est là une prérogative exclusive du Parlement : tel est le cas aux États-Unis où l'administration gouvernementale est obligée de faire déposer ses projets par un membre du Parlement. Dans les États à régime parlementaire, l'initiative est partagée : les membres des assemblées ont, comme le gouvernement, le droit de proposer une législation nouvelle, ou des amendements aux textes en discussion quelle qu'en soit l'origine. Dans les démocraties populaires, l'initiative est même partagée, en principe, avec tous les citoyens rassemblés dans leurs diverses organisations. Mais dans les faits, ce sont les projets élaborés, déposés et soutenus par le pouvoir exécutif qui sont inscrits à l'ordre du jour, discutés et votés dans une proportion considérable. Là encore, on met en avant le prétexte de la technicité, mais l'expérience montre, cependant, que la discussion parlementaire améliore les textes, évite les erreurs, et humanise en les assouplissant ou en les rendant plus acceptables pour les citoyens les nouvelles dispositions légales. Et, cependant, l'initiative parlementaire subit partout des limitations de droit ou de fait, dont les principales sont l'interdiction de proposer des dépenses nouvelles, ou des réductions d'impôts et la quasi-impossibilité d'obtenir, sans l'accord du gouvernement la mise en discussion d'une proposition d'origine parlementaire.
La discussion législative se déroule suivant une procédure qui a pour objet la sincérité et la loyauté des débats. Elle tend à éviter toute décision de surprise en donnant aux opposants des moyens d'expression suffisants ou même ceux de retarder l'adoption d'un texte. Elle permet au gouvernement de guider les débats, quand même elle ne lui assure pas le dernier mot en toutes circonstances, et à la majorité de faire prévaloir sa volonté. Après la discussion générale qui est un échange de vues sur les principes de la législation proposée, les assemblées délibèrent sur les motions tendant à ajourner ou à faire rejeter le texte, puis sur les amendements que leurs membres souhaitent y apporter. Une décision intervient ensuite sur l'ensemble.
Dans les parlements bicaméristes, la discussion est reprise dans l'autre assemblée et la « navette » se poursuit jusqu'à ce que les deux chambres se soient accordées sur un texte unique, à moins que les dispositions constitutionnelles ne donnent à l'une d'elles le droit d'en terminer, droit dont l'exercice est facilité parfois (États-Unis, France) par des compromis préparés par des commissions mixtes. Dans les dernières années, la procédure parlementaire a été très simplifiée et les moyens d' obstruction presque supprimés : même le Congrès américain n'utilise plus guère le filibusting. En fin de discussion intervient le vote, moyen par lequel une assemblée prend sa décision. Selon la qualité des affaires, les modalités en sont différentes. Pour les unes on se contente d'un vote à main levée ou par assis et debout, c'est-à-dire anonyme. Mais pour les choses importantes la règle est le scrutin public par appel nominal, par bulletins, par division (Grande-Bretagne) ou par l'intermédiaire d'une machine à voter (Finlande, Suède, Belgique, France). Dans tous ces systèmes, le nom et le sens du vote de chaque parlementaire sont relevés et publiés afin que chaque citoyen sache ce que chaque représentant a voté et quelle responsabilité il a assumée.
Contrôle de l'activité gouvernementale
Le pouvoir exécutif conduit la vie de la nation. Il est responsable d'une politique tant à l'extérieur à l'égard des pays étrangers qu'à l'intérieur quant aux garanties des citoyens, à la vie économique, aux rapports sociaux, etc. Il dispose à cet effet d'une armée dont il nomme les chefs, et d'administrations, en plus ou moins grand nombre, dont il nomme les fonctionnaires. C'est de l'ensemble de ces activités que le Parlement entend assurer le contrôle dans les limites qui lui sont accordées (ou imparties) par la Loi fondamentale. Il s'ensuit nécessairement des interférences entre les deux pouvoirs surtout dans les pays à régime parlementaire.
En Allemagne et en Italie (et en France de 1870 à 1958) le Parlement intervient tout d'abord par la création du chef de l'État : il élit le président de la République. Dans ces deux premiers pays, il collabore étroitement aussi à la création du chef du gouvernement (chancelier ou président du Conseil). Ces régimes placent l'exécutif sous une dépendance étroite du Parlement qui peut aller jusqu'à la confusion des pouvoirs dans le « gouvernement d'assemblée ». Dans les systèmes monarchiques (Grande-Bretagne, Belgique, États scandinaves, Pays-Bas) et dans les républiques où le président est élu au suffrage universel (États-Unis, France depuis 1962), la séparation est plus effective. Cependant, à l'exception des États-Unis, les gouvernements désignés par le chef de l'État ne vivent qu'autant qu'ils conservent la confiance du Parlement qui peut la leur refuser par le vote d'une motion de censure. C'est là une mesure grave dont la prise est assortie de garanties de scrutin, de majorité et de délais. Elle peut avoir pour contrepartie la dissolution du Parlement (Italie) ou au moins de sa Chambre basse (France) renvoyée devant les électeurs chargés d'arbitrer le conflit.
Il est évident que l'existence d'un gouvernement n'est pas en jeu à l'occasion de chacune de ses démarches. Dans la vie quotidienne, le Parlement dispose de moyens divers d'information, d'investigation, de pression qui lui permettent avec plus ou moins de succès d'être tenu au courant de l'activité des ministres et des administrations publiques pour vérifier qu'elle s'exerce conformément aux lois et que les garanties des justiciables sont respectées.
Les commissions parlementaires jouent un rôle important dans cette action de contrôle par la connaissance qu'elles ont de l'exécution des lois. La plupart des parlements peuvent créer des commissions spéciales d'enquête pour l'examen, par exemple, des responsabilités encourues dans une affaire scandaleuse ou à l'occasion d'événements graves. On trouve aussi des commissions de contrôle de l'activité d'entreprises publiques ou du fonctionnement d'une administration. Ces commissions spéciales jouissent parfois de pouvoirs judiciaires, peuvent siéger en public, entendre des témoins, et faire connaître par tous les moyens de diffusion l'état et le résultat de leurs travaux. Elles sont fréquemment utilisées par le Congrès américain et leur action empiète souvent sur le domaine de la Justice.
La nécessité de faire connaître les mesures qu'il a prises dans une conjoncture particulière qui a ému l'opinion publique amène d'autre part le gouvernement à faire devant une assemblée une déclaration qui ouvre un débat permettant au Parlement de faire entendre son avis et de tenter de redresser une politique qu'il estime insuffisante ou dangereuse.
Faute d'initiative prise par le ministère, les parlementaires disposent de plusieurs procédures de questions : la question écrite, publiée avec les comptes rendus des séances suscite une réponse, écrite également, adressée individuellement par le ministre intéressé au membre de l'Assemblée qui l'a posée, et qui sera aussi publiée. Ce genre d'interrogation a généralement pour but d'obtenir d'une administration des éclaircissements sur l'application d'un texte légal ou réglementaire. Plus politiques sont les questions orales qui, inscrites à l'ordre du jour suivant des procédures variables selon les assemblées, obligent le ministre à répondre en séance publique et sont l'occasion d'une discussion plus ou moins étendue. On envisagera plus bas les raisons pour lesquelles la mission de contrôle du parlement tend à se restreindre comme sa fonction législative ; ce qui explique sans doute pourquoi on assiste, depuis quelques années, à l'extension d'une nouvelle forme d'activité parlementaire.
L'information
Au fur et à mesure de l'évolution de la conduite des affaires publiques, devenues plus techniques que juridiques, plus économiques que politiques, les parlementaires ont ressenti davantage la nécessité d'une connaissance plus approfondie des problèmes, d'une information plus complète qui les mettent en état de comprendre le détail et d'apprécier mieux la nature et les effets prévisibles des législations qui leur sont proposées par un exécutif solidement appuyé sur des administrations habituées à gouverner et des experts armés de théories et de statistiques. Une partie de leur temps est donc consacrée à des réunions de travail organisées par les groupes politiques, à des colloques, des séminaires sur des sujets différents. Ils cherchent des « contacts » dans la capitale avec des dirigeants d'organismes économiques ou syndicaux et se tournent résolument vers l'information extérieure. À cet égard, les réunions des assemblées européennes (Conseil de l'Europe, Parlement européen, Union de l'Europe occidentale) ou, dans d'autres parties du monde, des organismes régionaux, celles de l'Union interparlementaire jouent un rôle important. Il en va de même des missions envoyées par les commissions dans les pays étrangers, ainsi que des voyages des groupes d'amitié établis entre deux ou plusieurs parlements. Cette information recueillie circule dans les deux sens : les membres de la majorité s'en servent pour expliquer à leurs électeurs l'action du gouvernement, ceux de l'opposition pour leur exposer les raisons de la combattre. Réciproquement, les parlementaires rapportent à leurs collègues, aux ministres et aux fonctionnaires des administrations centrales l'opinion des citoyens, qu'ils connaissent par leur contact avec leur circonscription d'une manière plus directe que les délégués du pouvoir central. Mais cette fonction d'information a un caractère individuel, alors que l'action d'un Parlement est essentiellement collective, et elle a aussi des limites.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Émile BLAMONT : docteur en droit, diplômé de l'École des sciences politiques, secrétaire général de l'Assemblée nationale
Classification
Médias
Autres références
-
ALLEMAGNE (Politique et économie depuis 1949) - République fédérale d'Allemagne jusqu'à la réunification
- Écrit par Alfred GROSSER et Henri MÉNUDIER
- 16 395 mots
- 10 médias
Pour empêcher le renversement des gouvernements par des oppositions conjuguées incapables de former une majorité de rechange, comme sous Weimar, les constituants ont rédigé l'article 67 : « L'Assemblée ne peut exprimer sa défiance envers le chancelier qu'en élisant un successeur à la majorité absolue... -
ALLEMAGNE - Les institutions
- Écrit par Stéphane SCHOTT
- 4 250 mots
La Loi fondamentale allemande du 23 mai 1949 institue unParlement bicaméral composé du Bundestag – la Diète fédérale représentant le peuple allemand – et du Bundesrat – le Conseil fédéral représentant les États fédérés. Le bicamérisme de la république fédérale d’Allemagne peut... -
AMENDEMENT
- Écrit par Charles EISENMANN et Daniel GAXIE
- 1 214 mots
Au sens juridique du terme, un amendement est une tentative de modification d'un texte par une assemblée délibérante. On retrouve donc dans le vocabulaire juridique le sens de correction, d'amélioration, que le mot revêt dans la langue courante. La notion juridique a un contenu précis et n'est...
-
ARTICLE 16 (Constitution française de 1958)
- Écrit par Annie GRUBER
- 1 028 mots
Dans la Constitution française du 4 octobre 1958, l'article 16 autorise, en cas de nécessité, le président de la République à exercer une dictature temporaire, au sens romain du terme. Il introduit dans la Constitution un régime d'exception prévu pour faire face à une crise institutionnelle...
- Afficher les 39 références
Voir aussi