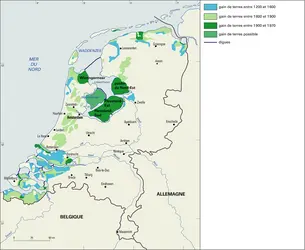- 1. Géographie
- 2. Des Romains aux Carolingiens
- 3. Les vicissitudes politiques du xie au xvie siècle
- 4. Le soulèvement contre l'Espagne
- 5. La République ou les sept mini-républiques (xvie-xviiie s.)
- 6. L'empire colonial hollandais
- 7. Révolution et restauration 1780-1830
- 8. Le roi et le Parlement au xixe siècle
- 9. La Première Guerre mondiale
- 10. D'une guerre à l'autre (1919-1940)
- 11. Guerre et occupation, 1940-1945
- 12. Évolution politique et économique depuis 1945
- 13. Chronologie contemporaine
- 14. Bibliographie
- 15. Site internet
PAYS-BAS
| Nom officiel | Royaume des Pays-Bas |
| Chef de l'État | Le roi Willem-Alexander - depuis le 30 avril 2013 |
| Chef du gouvernement | Dick Schoof - depuis le 2 juillet 2024 |
| Capitale | La Haye (Siège du gouvernement) , Amsterdam |
| Langue officielle | Néerlandais (Le frison est reconnu comme seconde langue officielle dans la province de la Frise depuis 2013.) |
| Population |
17 877 117 habitants
(2023) |
| Superficie |
41 540 km²
|
Article modifié le
Guerre et occupation, 1940-1945
Le 10 mai 1940, les troupes allemandes faisaient irruption aux Pays-Bas. En cinq jours, la majeure partie du pays était occupée et l'armée néerlandaise capitulait (14 mai). Le gouvernement néerlandais avait réussi à quitter le pays ; il dirigeait à partir de Londres la résistance néerlandaise qui continuait en dehors du territoire occupé, il conservait la haute main sur les territoires d'outre-mer – dont le plus important, les Indes néerlandaises, serait ultérieurement conquis par les Japonais (chute de Java le 9 mars 1942) – et préparait la libération des Pays-Bas. Un nouveau cabinet sous la direction de Pierre Gerbrandy (à partir du 3 septembre 1940) s'efforça de réaliser ces objectifs, puissamment soutenu par la reine Wilhelmine. Pour les Pays-Bas s'ouvrait une période noire. L'occupant allemand – depuis le 28 mai 1940, A. Seyss-Inquart était devenu Reichskommissar – ne se contentait pas de considérer le pays comme une prise de guerre qu'il convenait de pressurer et d'exploiter au profit de la poursuite de la guerre par l'Allemagne : quelque 400 000 ouvriers néerlandais furent contraints d'aller travailler en Allemagne ; mais il fallait aussi de gré ou de force y introduire et y imposer l'idéologie nazie. Afin d'y parvenir, on accorda un large soutien au NSB (Alliance national-socialiste), qui s'érigea hâtivement en acolyte de l'Allemagne ; on créa toutes sortes de nouvelles institutions et organisations national-socialistes (par exemple, la SS-Pays-Bas). Sur le plan social, les conséquences furent plus graves, lorsque l'occupant se mit à faire la chasse aux juifs néerlandais et réussit à éliminer une grande partie de la population juive des Pays-Bas en les envoyant en déportation ; ce fut un véritable génocide : 104 000 morts sur un total de 140 000. Anne Frank (1929-1945), une jeune juive allemande réfugiée aux Pays-Bas avec sa famille depuis 1933, a donné dans son Journal, rédigé entre 1942 et 1944, un témoignage sur ces persécutions. Elle est morte à Bergen-Belsen, peu de temps avant la libération du camp. L'occupant ne réussit pas à gagner beaucoup de partisans au national-socialisme. Au cours de la guerre éclatèrent trois grands mouvements de protestation : la grève de février qui eut lieu à Amsterdam en 1941 pour s'opposer à la déportation des juifs, les grèves d'avril-mai 1943 contre le plan allemand de renvoyer en captivité les soldats néerlandais et la grève des chemins de fer de septembre 1944 appuyant l'opération alliée Market Garden. Une minorité, qui se savait il est vrai soutenue par une partie croissante de l'opinion publique, se livrait à une résistance active, qui se manifestait de multiples façons : aide aux juifs et autres victimes du régime, organisation du passage dans la clandestinité, presse clandestine, espionnage et sabotage, préparation de l'aide militaire à la libération. Du point de vue politique, il était important que ce mouvement clandestin élaborât des plans pour l'avenir et les répandît parmi un large public grâce à la presse clandestine. Il s'agissait de plans le plus souvent radicaux, qui, forts des expériences de l’avant-guerre, préconisaient des mesures comme l'accroissement de l'autorité du gouvernement, la rénovation du système des partis (avec une préférence pour le bipartisme), la suppression des partis confessionnels (ce qu'on appelait le tournant doorbraak), l'abandon de la notion de lutte des classes et, sur le plan international, la participation à un système international de sécurité, qui rendrait impossible tout retour à l'ancienne politique de neutralité.
Libération du joug allemand et conséquences de la guerre (1944-1945)
Une série de facteurs géographiques et militaires a fortement retardé la libération des Pays-Bas et a inutilement exposé la population à de sérieuses privations. Après la rapide libération de la Belgique (début sept. 1944), les grands fleuves des Pays-Bas (Meuse, Waal et Rhin) et le Rhin en Allemagne furent un obstacle qui empêcha Montgomery d'atteindre rapidement la Ruhr.
Pendant l'opération Market Garden (17-26 sept.), les Alliés purent traverser la Meuse (à Grave) et le Waal (à Nimègue), mais non pas le Rhin à Arnhem. Seul le sud du pays put être libéré. Afin de rendre possible la libre navigation vers Anvers, les Canadiens et les Français durent livrer de durs combats pour pénétrer dans les bouches de l'Escaut, ce qui provoqua l'inondation totale de l'île de Walcheren (nov.). En outre, l'offensive des Ardennes (16 déc. 1944-janv. 1945) retint toute l'attention des Alliés et retarda à nouveau la libération des Pays-Bas. Pendant ce temps, la population néerlandaise au nord des fleuves mourait pour ainsi dire de faim. La dureté de l'attitude des Allemands s'explique en partie par la grève générale des chemins de fer, qui avait été annoncée à partir de Londres le 17 septembre, et qui devait aider les Alliés dans leurs offensives. Après la débâcle d'Arnhem, cette grève fit le jeu des Allemands qui arrêtèrent les transports de vivres par bateau en provenance de l'Allemagne. Dans la Randstad (qui abritait 4,5 millions d'habitants), les rigueurs de l'hiver coûtèrent la vie à quelques dizaines de milliers de personnes qui périrent de faim et de misère. Ce n'est qu'au mois de mars que les Alliés traversèrent le Rhin, à Clèves, et que l'est du pays put être libéré.
Après des pourparlers avec les Allemands, les Alliés purent, à la mi-avril, parachuter des vivres pour la population civile, grâce à des couloirs aériens. L'armée allemande ne capitula que le 5 mai à Wageningen. Jamais dans son histoire la population et la civilisation des Pays-Bas n'avaient été si proches de l'anéantissement. Les conséquences de la Seconde Guerre mondiale furent catastrophiques et laissèrent durant plus d'un quart de siècle des traces profondes dans la population. Plus de 30 % du patrimoine national avait été détruit ; des dizaines de milliers de Néerlandais (dont la quasi-totalité de la population juive) avaient péri dans la résistance ou dans des camps de concentration.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Christophe DE VOOGD : docteur en histoire, professeur agrégé à l'Institut d'études politiques de Paris
- Frédéric MAURO : professeur d'histoire à l'université de Nanterre et à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine
- Guido PEETERS : docteur en droit, licencié en sciences politiques et diplomatiques
- Christian VANDERMOTTEN : docteur en sciences géographiques, professeur émérite à l'Université libre de Bruxelles, membre de la classe des lettres de l'Académie royale de Belgique, président de la Société royale belge de géographie
- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis
Classification
Médias
Voir aussi
- ÉNERGIE ÉOLIENNE
- OTTON Ier LE GRAND (912-973) roi de Germanie (936-973) et premier empereur du Saint Empire (962-973)
- DENSITÉ DE POPULATION
- NEUTRALISME
- CONTESTATION
- EUROPE, histoire
- EUROPE, géographie et géologie
- RÉSISTANCE EN EUROPE (1940-1945)
- COMPAGNIES DE COMMERCE MARITIME
- ATLANTIQUE ALLIANCE
- PACIFISME
- GUILLAUME III (1650-1702) stathouder de Hollande (1674-1702) et roi d'Angleterre (1689-1702)
- ISLAMISME
- CEE (Communauté économique européenne)
- VOTE DROIT DE
- FLOTTE DE COMMERCE
- LIBERTÉ RELIGIEUSE
- TRAVAIL DES ENFANTS
- ZUIDERZEE
- TOURBE
- HOLLANDAIS EMPIRE COLONIAL
- INDES ORIENTALES COMPAGNIE HOLLANDAISE DES
- NAVIGATION FLUVIALE
- CONFESSIONNELLES FORMATIONS SOCIO-POLITIQUES
- ESCAUT
- CONURBATION
- GAND PACIFICATION DE (1576)
- SABLE
- AMÉNAGEMENT FLUVIAL
- RÉSERVES NATURELLES
- PERSÉCUTIONS RELIGIEUSES
- AMÉNAGEMENT DU LITTORAL
- ASSURANCES SOCIALES
- TRAVAILLEURS ÉTRANGERS
- VAN DEN BOSCH JOHANNES (1780-1844)
- INDES NÉERLANDAISES
- HATTA MOHAMMED (1902-1980)
- COMMERCE, histoire
- ENDETTEMENT
- DIGUES
- FORTUYN PIM (1948-2002)
- HOLLANDE GUERRE DE (1672-1679)
- GUILLAUME IV (1711-1751) stathouder de Hollande (1747-1751)
- GUILLAUME V (1748-1806) stathouder de Hollande (1751-1795)
- BATAVE RÉPUBLIQUE (1795-1806)
- INDÉPENDANCE BELGE (1830)
- GUILLAUME III NASSAU (1817-1890) roi des Pays-Bas et grand-duc de Luxembourg (1849-1890)
- WILHELMINE (1880-1962) reine des Pays-Bas (1890-1948)
- DREES WILLEM (1886-1974)
- MUTINERIE
- GUILLAUME II D'ORANGE (1626-1650) stathouder de Hollande (1647-1650)
- EUROPE, politique et économie
- UTRECHT UNION D' (1579)
- BALKENENDE JAN PETER (1956- )
- CONSTITUTION EUROPÉENNE PROJET DE
- SÉDIMENTATION MARINE
- TRANSGRESSIONS & RÉGRESSIONS MARINES
- DÉTENTE, politique internationale
- BELGIQUE, histoire, des origines à 1830
- BELGIQUE, histoire, de 1830 à 1945
- BELGIQUE, histoire, de 1945 à nos jours
- BRÉSIL, histoire jusqu'en 1950
- STUPÉFIANTS
- ESPAGNE, histoire : XVIe et XVIIe s.
- ENSEIGNEMENT PUBLIC
- ENSEIGNEMENT PRIVÉ
- TERTIAIRE SECTEUR
- POLITIQUE ÉCONOMIQUE
- SOCIAL-DÉMOCRATIE
- SERVICE PUBLIC
- CROISSANCE ÉCONOMIQUE
- EXPORTATIONS
- JAPON, histoire, de l'ère Meiji à 1946
- POPULATION ACTIVE
- URBANISATION
- GERMANIE ROYAUME DE (IXe-XIe s.)
- PAYS-BAS, géographie et géologie
- PAYS-BAS, économie
- PAYS-BAS, histoire, des origines à 1579
- PAYS-BAS, histoire, de 1579 à 1830
- PAYS-BAS, histoire, de 1830 à nos jours
- DÉPENSES PUBLIQUES
- ESPÉRANCE DE VIE
- IMMIGRATION
- INDES OCCIDENTALES COMPAGNIE HOLLANDAISE DES
- JUIF HISTOIRE DU PEUPLE
- ROME, l'Empire romain
- FRANCE, histoire, du XVIe s. à 1715
- FRANCE, histoire, de 1789 à 1815
- ÉGLISE HISTOIRE DE L', du concile de Trente à nos jours
- LUNS JOSEPH (1911-2002)
- ÉTAT-PROVIDENCE
- NÉERLANDAIS, langue
- REVENUS POLITIQUE DES
- POLITIQUE INDUSTRIELLE
- POLITIQUE SOCIALE
- FRISONS
- SOCIALISTES MOUVEMENTS
- SECTEUR AGRICOLE
- TRAVAIL À TEMPS PARTIEL
- CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE
- MAASTRICHT ou MAËSTRICHT TRAITÉ DE (1992)
- QUATRE-VINGTS ANS GUERRE DE
- THORBECKE JOHAN RUDOLF (1798-1872)
- PARTI ANTIRÉVOLUTIONNAIRE, Pays-Bas
- TROELSTRA PIETER JELLES (1860-1930)
- PHILIPS GROUPE
- SHELL
- UNILEVER GROUPE
- FOKKER ANTHONY (1890-1939)
- LUBBERS RUUD (1939-2018)
- EXPLOITATION PÉTROLIÈRE
- WILDERS GEERT (1963- )