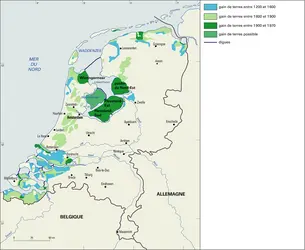- 1. Géographie
- 2. Des Romains aux Carolingiens
- 3. Les vicissitudes politiques du xie au xvie siècle
- 4. Le soulèvement contre l'Espagne
- 5. La République ou les sept mini-républiques (xvie-xviiie s.)
- 6. L'empire colonial hollandais
- 7. Révolution et restauration 1780-1830
- 8. Le roi et le Parlement au xixe siècle
- 9. La Première Guerre mondiale
- 10. D'une guerre à l'autre (1919-1940)
- 11. Guerre et occupation, 1940-1945
- 12. Évolution politique et économique depuis 1945
- 13. Chronologie contemporaine
- 14. Bibliographie
- 15. Site internet
PAYS-BAS
| Nom officiel | Royaume des Pays-Bas |
| Chef de l'État | Le roi Willem-Alexander - depuis le 30 avril 2013 |
| Chef du gouvernement | Dick Schoof - depuis le 2 juillet 2024 |
| Capitale | La Haye (Siège du gouvernement) , Amsterdam |
| Langue officielle | Néerlandais (Le frison est reconnu comme seconde langue officielle dans la province de la Frise depuis 2013.) |
| Population |
17 877 117 habitants
(2023) |
| Superficie |
41 540 km²
|
Article modifié le
Le soulèvement contre l'Espagne
Généralités
Le soulèvement des Pays-Bas contre l'Espagne, appelé aussi guerre de Quatre-Vingts Ans, a déchaîné aux Pays-Bas des polémiques qui ne s'éteindront sans doute jamais et provoqué plus de controverses qu'aucun autre épisode de l'histoire de ce pays. Il y a même eu des historiens étrangers pour se risquer à en traiter, ce qu'ils ont souvent fait avec bonheur. Pour les historiens marxistes-léninistes, ce soulèvement est la première grande révolution bourgeoise de l'histoire. Ce qui frappe dans cet intérêt passionné, c'est la propension des historiens à projeter dans le xvie siècle les phénomènes actuels ou leur vision du monde de leur époque. Ce qui précède prouve que, jusqu'en 1609, le soulèvement n'était certainement pas une guerre entre deux nations, l'Espagne et les Pays-Bas. Le soulèvement était davantage un amalgame de mécontentements, une sorte de monstrueuse alliance, qu'une lutte organisée et cohérente ; il s'agissait d'une guerre entre bourgeois plutôt que d'une guerre entre États. Il n'était en rien inévitable que tout cela aboutisse à une offensive concertée de plusieurs groupes et régions contre l'ennemi commun : ce n'était pas évident à l'époque. Beaucoup d'historiens ont prouvé que la révolte était en fait de nature conservatrice, les classes privilégiées se dressant contre le phénomène de l'État absolutiste. Reste l'importante question de savoir quelle était la part de la religion dans le soulèvement ? Plus tard, la République, auréolée par sa victoire et considérée comme une Mecque des protestants, revendiquera le caractère religieux du soulèvement, prétendant qu'une nation protestante avait lutté contre l'Antéchrist, le roi d'Espagne et le pape. Le soulèvement pouvait paraître confirmer cette thèse : le conflit engendrait la naissance d'un Sud catholique et d'un Nord protestant, séparés par une sorte d'État tampon, les pays de la Généralité. Mais dans la réalité quotidienne le déroulement du scénario fut quelque peu différent. Au moment de la scission, les Pays-Bas du Nord n'avaient rien d'un État protestant : tout au contraire, c'était du Sud que venaient les protestants (calvinistes) les plus fougueux. Des historiens modernes ont souligné l'importance des classes de la petite et moyenne bourgeoisie : des gens qui pouvaient basculer à volonté dans l'un ou l'autre camp pour des motifs politiques ou économiques. Une autre approche constate que les armées espagnoles partaient du Luxembourg, du sud, pour attaquer le nord, ce qui rend manifeste le caractère militaire du conflit. Il se pourrait bien que la frontière entre le Nord et le Sud ne soit qu'une fortuite ligne de front marquant l'avance ou le recul des chefs militaires au moment où les hommes politiques tirèrent les conclusions d'une situation de fait (rebus sic stantibus). Dans les années 1960, l'historien américain Parker a émis une nouvelle hypothèse : Farnèse n'aurait guère eu de peine à contrôler le Sud parce que des oppositions exacerbées dans les domaines économique, politique et religieux y divisaient la population, la mauvaise situation économique suscitant des tensions à tous les niveaux de la société. Il y avait beaucoup moins de dissensions dans le Nord, ce qui facilitait la cohésion et compliquait considérablement la tâche de Farnèse. Il est clair pour nous, au xxe siècle, que, dans cette lutte, les impulsions décisives venaient du Sud et que le Nord en retirait tout le profit. Il est de fait également que, dans les provinces francophones du Sud, les nobles (les Malcontents) ne se firent guère prier pour tourner casaque et céder à la diplomatie de Farnèse ( Union d'Arras, 1579). Il est faux toutefois de ne voir dans le soulèvement qu'une divergence entre les deux communautés linguistiques présentes aux Pays-Bas.
1566-1576 première phase : le soulèvement général
On peut dater le début du soulèvement de la Fureur iconoclaste qui se déchaîna à partir du mois d'août 1566. Partie de la Flandre méridionale, elle se répandit comme une traînée de poudre via Gand, Anvers, jusqu'à Middelbourg, Amsterdam et Groningue. La profanation de ce qui était sacré aux yeux des catholiques et la violence déployée amenèrent d'emblée une scission de fait : ceux qui étaient attachés à l'ancienne religion ou condamnaient toute atteinte à l'ordre public se rangèrent aux côtés des autorités et de la gouvernante générale des Pays-Bas, Marguerite de Parme. Les calvinistes fanatiques et les nobles profondément ulcérés exigeaient la liberté de culte. Le gouvernement fit preuve de fermeté et réprima le mouvement. Au début de 1567, tout était rentré dans l'ordre. Mais Philippe II ne voulut pas en rester là. Il envoya le duc d' Albe en le chargeant d'une double mission : punir plus sévèrement encore les rebelles, et prendre de nouvelles mesures centralisatrices dans les domaines financier, religieux et juridique. Devant l'arrivée du duc d'Albe et son installation à Bruxelles, beaucoup émigrèrent, entre autres le prince d'Orange, Guillaume le Taciturne. Ce dernier rassembla une petite armée et fit irruption aux Pays-Bas, mais il fut battu par le duc d'Albe près de Heiligerlee. Entre-temps, le duc d'Albe avait institué à Bruxelles le Conseil des troubles et déclenché la chasse aux hérétiques. On établit 10 000 dossiers ; 9 000 personnes furent condamnées par contumace et leurs biens confisqués, plus de 1 000 hérétiques furent exécutés, dont les comtes d'Egmont et de Hornes. C'était vraiment beaucoup pour une population de 3 millions d'âmes. En outre, 20 000 fugitifs émigrèrent à Londres, La Rochelle, Emden, et dans les provinces rhénanes. Le duc d'Albe accrut encore son impopularité en cherchant à introduire de nouveaux impôts (dixième, vingtième et centième denier). Le centième était un impôt sur la fortune, le vingtième sur la vente de biens immobiliers et le dixième – de loin le plus haï – une sorte de TVA sur le transfert de biens mobiliers. Les fonctionnaires locaux, qui n'étaient pas équipés pour lever ce genre d'impôts, manifestèrent une telle opposition que le duc d'Albe dut renoncer à ces mesures.
Parmi les insurgés, les Gueux de mer étaient les plus actifs. Ils contrôlaient les embouchures des fleuves et les côtes, capturaient beaucoup de navires marchands, terrorisaient les régions littorales par leurs raids et leurs pillages, couvraient des transports de troupes amies et bloquaient ceux des Espagnols. En 1572, ils mirent le comble à leur audace en s'emparant par surprise du petit port de La Brielle. En partie grâce à leur aide, beaucoup de villes se débarrassèrent de l'ennemi, d'abord en Hollande et en Zélande, et constituèrent ensemble, en juillet 1572, un gouvernement : l'Assemblée des États de Dordrecht avec le prince d'Orange comme représentant du pouvoir royal. Le duc d'Albe reconquit un certain nombre de villes au Nord et au Sud, et s'y livra à un véritable massacre de la population (Malines, Zutphen, Naarden, Haarlem). Toutefois, les rebelles réussirent à se maintenir sur mer et le duc d'Albe demanda son rappel après la levée du siège de Leyde. Son successeur au gouvernement des Pays-Bas Louis Requesens était plus diplomate et souhaitait parvenir à un accord. C'est aussi ce que voulaient la plupart des États des Pays-Bas. Mais l'Espagne n'entendait pas renoncer à la domination absolue de l'Église catholique romaine et du pouvoir central du souverain. Les calvinistes quant à eux exigeaient la liberté de culte et des entraves au catholicisme, ainsi qu'un gouvernement décentralisé, à l'image de leurs communautés spirituelles. Vérité et réalisme se situaient entre ces deux extrêmes : la pacification de Gand (1576) fut un compromis auxquels parvinrent les divers États sur les questions de religion et d'autorité centrale, ainsi que sur le retrait de toutes les troupes étrangères. Il s'agissait d'un accord conclu dans l'esprit érasmien, cher à Guillaume le Taciturne.
1576-1588, seconde phase : le divorce
Le fanatisme religieux existait toutefois des deux côtés : il y avait aussi bien des ultracatholiques que des ultracalvinistes. Ni les uns ni les autres ne pouvaient se satisfaire de la pacification de Gand : à leurs yeux, pas de salut en dehors de leurs religions salvatrices respectives. Après les compromissions de don Juan, successeur de Requesens, catholiques et protestants s'opposaient à nouveau. Le prince d'Orange n'arriva pas à imposer sa politique de modération dans le domaine religieux. Et le successeur de don Juan, Alexandre Farnèse, duc de Parme, sut habilement tirer parti de ce flottement chez beaucoup de catholiques. Farnèse était aussi bon général qu'habile diplomate. Il parvint à détacher lentement les Pays-Bas du Sud de leurs alliés du Nord. Entre 1579 et 1589, il rétablit l'autorité de l'Espagne et du catholicisme dans les contrées situées au sud des grands fleuves (chute d'Anvers, 1585). En 1579 s'étaient déjà constituées l'Union d'Arras – régions francophones catholiques du Sud – et l' Union d'Utrecht – régions calvinistes du Nord, la Flandre et le Brabant – si bien que la cassure se dessinait clairement. Farnèse réussit à en faire une réalité effective. Les états généraux du Nord cherchaient en vain un souverain. Le « placard d'Abandon » en 1581 répudiait Philippe II au nom de la légitimité du soulèvement contre la tyrannie, dûment mentionnée dans les privilèges (telle la Joyeuse Entrée du Brabant de 1356). On n'en cherchait pas moins un souverain. Le prince Charles d'Anjou, d'abord, la reine d'Angleterre Élisabeth Ire, ensuite, ne donnèrent pas satisfaction si bien que les états généraux finirent par se débrouiller sans souverain parce que, entre-temps, le prince d'Orange avait été assassiné en 1584 à l'instigation de Philippe II. La situation évoluait vers une fédération des états de sept provinces, chacune souveraine, la République des Provinces-Unies. Les provinces méridionales retombèrent au pouvoir de l'Espagne et du catholicisme.
1588-1609, troisième phase : les débuts de la victoire sur l'Espagne
Après la défaite de l'Invincible Armada (1588), Philippe II imprima une nouvelle orientation à la politique extérieure ; à ses yeux, les Pays-Bas et l'Angleterre perdaient de leur importance ; la guerre coûtait trop cher et Philippe II s'intéressait davantage à la France. L'Angleterre reconnut la République et la soutint prudemment. Au sein de la République, Maurice de Nassau constitua une armée très efficace qui, parallèlement à la suprématie sur mer, lui permit de briller également sur terre. Maurice de Nassau reconquit sur l'Espagne quantité de contrées et garantit des frontières sûres à la République. Sur les plans politique et diplomatique, le Grand Pensionnaire Oldenbarnevelt déploya une intense activité. Il parvint, en 1596, à sceller avec l'Angleterre et la France une alliance tripartite qui éloignait définitivement le danger espagnol. Philippe II d'Espagne mourut en 1598 ; il laissait les Pays-Bas du Sud aux archiducs Albert et Isabelle, espérant que ceux-ci reconquerraient le Nord à la catholicité. Les archiducs s'y essayèrent et les combats reprirent aux frontières entre Maurice de Nassau et le général Spinola. Mais la misère était telle dans le Sud qu'ils signèrent en 1609 avec Oldenbarnevelt la trêve de Douze Ans. Celle-ci permettait au Nord, à la République, de consacrer toutes ses forces à la conquête des routes commerciales vers les Indes et l'Amérique. Les Compagnies des Indes orientales et des Indes occidentales étaient d'ores et déjà très actives.
1621-1648, quatrième phase : consolidation et confirmation
Après la trêve de Douze Ans, la guerre reprit entre l'Espagne et la République. Du côté de la République, c'est surtout le prince Frédéric-Henri, fils cadet du Taciturne, qui réussit encore à reconquérir quelques villes sur le Sud. Sur mer aussi, la guerre continuait contre l'Espagne et le Portugal. Entre 1618 et 1648, la guerre de Quatre-Vingts Ans, autre dénomination du soulèvement, se confond avec la guerre de Trente Ans. Les troupes impériales vinrent prêter main-forte aux Espagnols tandis que la République aidait les protestants allemands. Par les traités de Westphalie (1648), l'Espagne reconnaissait, de jure cette fois, la République. Le nouvel État devenait indépendant, également, du Saint Empire et pouvait conserver toutes ses conquêtes dans les Indes orientales et occidentales. L'Escaut demeurait fermé. Les Pays-Bas du Sud retombaient sous l'autorité directe de Madrid.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Christophe DE VOOGD : docteur en histoire, professeur agrégé à l'Institut d'études politiques de Paris
- Frédéric MAURO : professeur d'histoire à l'université de Nanterre et à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine
- Guido PEETERS : docteur en droit, licencié en sciences politiques et diplomatiques
- Christian VANDERMOTTEN : docteur en sciences géographiques, professeur émérite à l'Université libre de Bruxelles, membre de la classe des lettres de l'Académie royale de Belgique, président de la Société royale belge de géographie
- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis
Classification
Médias
Voir aussi
- ÉNERGIE ÉOLIENNE
- OTTON Ier LE GRAND (912-973) roi de Germanie (936-973) et premier empereur du Saint Empire (962-973)
- DENSITÉ DE POPULATION
- NEUTRALISME
- CONTESTATION
- EUROPE, histoire
- EUROPE, géographie et géologie
- RÉSISTANCE EN EUROPE (1940-1945)
- COMPAGNIES DE COMMERCE MARITIME
- ATLANTIQUE ALLIANCE
- PACIFISME
- GUILLAUME III (1650-1702) stathouder de Hollande (1674-1702) et roi d'Angleterre (1689-1702)
- ISLAMISME
- CEE (Communauté économique européenne)
- VOTE DROIT DE
- FLOTTE DE COMMERCE
- LIBERTÉ RELIGIEUSE
- TRAVAIL DES ENFANTS
- ZUIDERZEE
- TOURBE
- HOLLANDAIS EMPIRE COLONIAL
- INDES ORIENTALES COMPAGNIE HOLLANDAISE DES
- NAVIGATION FLUVIALE
- CONFESSIONNELLES FORMATIONS SOCIO-POLITIQUES
- ESCAUT
- CONURBATION
- GAND PACIFICATION DE (1576)
- SABLE
- AMÉNAGEMENT FLUVIAL
- RÉSERVES NATURELLES
- PERSÉCUTIONS RELIGIEUSES
- AMÉNAGEMENT DU LITTORAL
- ASSURANCES SOCIALES
- TRAVAILLEURS ÉTRANGERS
- VAN DEN BOSCH JOHANNES (1780-1844)
- INDES NÉERLANDAISES
- HATTA MOHAMMED (1902-1980)
- COMMERCE, histoire
- ENDETTEMENT
- DIGUES
- FORTUYN PIM (1948-2002)
- HOLLANDE GUERRE DE (1672-1679)
- GUILLAUME IV (1711-1751) stathouder de Hollande (1747-1751)
- GUILLAUME V (1748-1806) stathouder de Hollande (1751-1795)
- BATAVE RÉPUBLIQUE (1795-1806)
- INDÉPENDANCE BELGE (1830)
- GUILLAUME III NASSAU (1817-1890) roi des Pays-Bas et grand-duc de Luxembourg (1849-1890)
- WILHELMINE (1880-1962) reine des Pays-Bas (1890-1948)
- DREES WILLEM (1886-1974)
- MUTINERIE
- GUILLAUME II D'ORANGE (1626-1650) stathouder de Hollande (1647-1650)
- EUROPE, politique et économie
- UTRECHT UNION D' (1579)
- BALKENENDE JAN PETER (1956- )
- CONSTITUTION EUROPÉENNE PROJET DE
- SÉDIMENTATION MARINE
- TRANSGRESSIONS & RÉGRESSIONS MARINES
- DÉTENTE, politique internationale
- BELGIQUE, histoire, des origines à 1830
- BELGIQUE, histoire, de 1830 à 1945
- BELGIQUE, histoire, de 1945 à nos jours
- BRÉSIL, histoire jusqu'en 1950
- STUPÉFIANTS
- ESPAGNE, histoire : XVIe et XVIIe s.
- ENSEIGNEMENT PUBLIC
- ENSEIGNEMENT PRIVÉ
- TERTIAIRE SECTEUR
- POLITIQUE ÉCONOMIQUE
- SOCIAL-DÉMOCRATIE
- SERVICE PUBLIC
- CROISSANCE ÉCONOMIQUE
- EXPORTATIONS
- JAPON, histoire, de l'ère Meiji à 1946
- POPULATION ACTIVE
- URBANISATION
- GERMANIE ROYAUME DE (IXe-XIe s.)
- PAYS-BAS, géographie et géologie
- PAYS-BAS, économie
- PAYS-BAS, histoire, des origines à 1579
- PAYS-BAS, histoire, de 1579 à 1830
- PAYS-BAS, histoire, de 1830 à nos jours
- DÉPENSES PUBLIQUES
- ESPÉRANCE DE VIE
- IMMIGRATION
- INDES OCCIDENTALES COMPAGNIE HOLLANDAISE DES
- JUIF HISTOIRE DU PEUPLE
- ROME, l'Empire romain
- FRANCE, histoire, du XVIe s. à 1715
- FRANCE, histoire, de 1789 à 1815
- ÉGLISE HISTOIRE DE L', du concile de Trente à nos jours
- LUNS JOSEPH (1911-2002)
- ÉTAT-PROVIDENCE
- NÉERLANDAIS, langue
- REVENUS POLITIQUE DES
- POLITIQUE INDUSTRIELLE
- POLITIQUE SOCIALE
- FRISONS
- SOCIALISTES MOUVEMENTS
- SECTEUR AGRICOLE
- TRAVAIL À TEMPS PARTIEL
- CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE
- MAASTRICHT ou MAËSTRICHT TRAITÉ DE (1992)
- QUATRE-VINGTS ANS GUERRE DE
- THORBECKE JOHAN RUDOLF (1798-1872)
- PARTI ANTIRÉVOLUTIONNAIRE, Pays-Bas
- TROELSTRA PIETER JELLES (1860-1930)
- PHILIPS GROUPE
- SHELL
- UNILEVER GROUPE
- FOKKER ANTHONY (1890-1939)
- LUBBERS RUUD (1939-2018)
- EXPLOITATION PÉTROLIÈRE
- WILDERS GEERT (1963- )