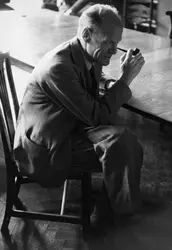- 1. Qu'appelle-t-on penser ?
- 2. L'intentionnalité des pensées
- 3. Une conception « platonicienne » de la pensée : Frege
- 4. La conception cartésienne de la pensée
- 5. Critique de la conception cartésienne : Peirce, Wittgenstein et Ryle
- 6. Pensée, machines et fonctionnalisme
- 7. Langage de la pensée et individuation des contenus intentionnels
- 8. Bibliographie
PENSÉE
Article modifié le
L'intentionnalité des pensées
Au sens large, toute attitude propositionnelle et son contenu impliquent une « pensée » ou sont une forme de pensée : on ne peut pas croire que p sans avoir la pensée que p, ni désirer que p sans avoir la pensée que p. C'est en ce sens que l'on peut dire qu'attribuer des attitudes propositionnelles à un être quelconque, c'est lui attribuer des pensées. Si l'on accepte cette caractérisation générale des pensées comme attitudes propositionnelles, on leur attribuera les propriétés que tous les états mentaux de ce type ont en commun.
En premier lieu, elles sont dirigées vers certains contenus propositionnels, c'est-à-dire des contenus dont l'attribution implique l'usage d'une proposition complétive gouvernée par « que », comme dans « Stanley pense que Livingstone est un explorateur ».
Ces contenus peuvent être appelés « intentionnels », au sens que donnaient à ce terme Brentano et Husserl : les objets qui font partie de ces contenus n'existent pas à proprement parler, mais ont une « inexistence intentionnelle », relative aux actes mentaux qui les visent. Selon Brentano, ce trait constitue un critère du mental comme tel, qui le distingue du physique. Mais on peut reformuler ce critère comme critère non pas du mental, mais de la manière dont nous le décrivons. En effet, les phrases utilisées pour rapporter des contenus de pensée ou d'autres attitudes propositionnelles ont trois caractéristiques qui les distinguent des phrases ordinaires attribuant une propriété à un objet ou décrivant un événement (comme « Pierre est grand » ou « Le bateau part »).
1. Leur valeur de vérité n'est pas fonction de la valeur de vérité des propositions complétives qu'elles gouvernent : la vérité, ou la fausseté, de « X croit (pense, désire, etc.) que p » n'est pas fonction de la vérité (ou de la fausseté) de p (mais seulement du fait que X a, ou n'a pas, la croyance, la pensée ou le désir que p).
2. Les expressions désignant des objets ou propriétés figurant dans les propositions complétives gouvernées par « que » ne peuvent pas être remplacées par des expressions qui ont la même référence (« Pierre pense que Cicéron est un orateur » n'implique pas « Pierre pense que Tullius est un orateur »).
3. On ne peut pas affirmer l'existence des objets désignés par ces expressions (« Pierre pense que le Père Noël apporte des jouets » n'implique pas « Il existe un Père Noël »). Les logiciens (par exemple W. V. O. Quine, 1956) disent que ces phrases sont non extensionnelles ou intensionnelles.
L'intensionnalité du mode de description des contenus d'attitudes propositionnelles peut ainsi être tenue comme un critère de l'intentionnalité de ces contenus.
En deuxième lieu, ces contenus ne sont pas, contrairement aux contenus d'autres états mentaux comme les sensations ou les expériences, intrinsèquement liés à la manière dont ils apparaissent aux sujets qui ont ces attitudes. Une sensation ou une qualité perçue (comme une douleur ou une sensation de rouge) ont un contenu subjectif qui ne se représente pas de la même manière que les représentations « propositionnelles » qui semblent associées aux croyances ou aux pensées. Celles-ci n'ont pas de phénoménologie distinctive (à la différence de la sensation olfactive provoquée par le roquefort, ma pensée « que le roquefort est un fromage » n'est pas essentiellement associée à une sensation – par exemple olfactive – et peut être entretenue indépendamment d'une telle sensation).
En troisième lieu, les contenus de pensée et d'attitudes ont, à la différence des sensations, une certaine structure : ils sont composés de ce qu'on appelle ordinairement des concepts. Il paraît difficile d'attribuer à quelqu'un, par exemple, la pensée « que ceci est un bouquet de roses » si l'on ne peut pas lui attribuer la possession des concepts de rose et de bouquet.
Enfin, les attitudes propositionnelles et leurs contenus ont la propriété de pouvoir être combinés les uns aux autres de manière à rendre compte de la rationalité d'un sujet. Nous attribuons des pensées, des croyances et des désirs à des individus pour expliquer la rationalité de leur comportement. On explique, par exemple, le fait qu'un agent a pris la fuite en disant qu'il croyait « qu'un ours le poursuivait, que l'ours est dangereux » et qu'il désirait « se mettre à l'abri », et ainsi de suite. Ce n'est que si les croyances, pensées et désirs de l'agent peuvent avoir une telle structure rationnelle qu'on est en mesure de lui attribuer ces « raisons » d'agir.
On peut se demander si ces caractéristiques des pensées comme contenus d'attitudes propositionnelles – leur intentionnalité, leur caractère structuré et systématique – ne sont pas intrinsèquement celles de contenus et de significations linguistiques, et si la possession de pensées ne dépend pas de la possession d'un langage. On peut aussi se demander si la possession de pensées en ce sens n'implique pas une forme de conscience. À la différence d'une sensation ou d'une expérience, une attitude propositionnelle peut ne pas être consciente. Mais n'est-il pas également essentiel à une pensée qu'elle puisse être consciente ? Ces deux questions, la relation de la pensée au langage et sa relation à la conscience, sont précisément celles sur lesquelles divergent les théories philosophiques de la pensée. Elles sont, en un sens, contenues dans la célèbre définition platonicienne de la pensée comme « dialogue que l'âme se tient à elle-même » (Théétète). Mais cette définition est ambiguë : signifie-t-elle que ce dialogue se produit in foro interno dans un langage purement mental dont les mots ne sont que l'enveloppe externe ? ou bien que l'âme a besoin des mots d'un langage public pour simplement pouvoir entrer dans ce dialogue ?
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Pascal ENGEL : maître de conférences de philosophie, université de Grenoble-II et C.N.R.S
Classification
Média
Autres références
-
AFFECTIVITÉ
- Écrit par Marc RICHIR
- 12 231 mots
...nouveauté de Kant dans l'histoire de la philosophie, le « renversement » ou la « révolution copernicienne », consiste en sa conception architectonique de la pensée, c'est-à-dire en ce que les termes (concepts) et les choses (Sachen) de la pensée dépendent, dans leur pouvoir de signifier, de l'orientation... -
ALAIN ÉMILE CHARTIER, dit (1868-1951)
- Écrit par Robert BOURGNE
- 4 560 mots
...faibles. « Le relativisme pensé est par là même surmonté. » La partie suffit, autant que chaque partie tient aux autres. Il faudrait donc se guérir de vouloir penser toutes choses, s'exercer à penser une chose sous toutes les idées ou actes par quoi l'esprit ordonne et oppose ses propres déterminations. -
ANTHROPOLOGIE ET ONTOLOGIE
- Écrit par Frédéric KECK
- 1 255 mots
Si l’anthropologie s’est définie contre la métaphysique classique en remplaçant un discours sur Dieu comme fondement de toutes choses par un discours sur l’homme comme sujet et objet de connaissance (Foucault, 1966), elle a renoué depuis les années 1980 avec l’ontologie, définie comme un...
-
ARCHAÏQUE MENTALITÉ
- Écrit par Jean CAZENEUVE
- 7 048 mots
...aller plus loin dans l'interprétation rationaliste, que Durkheim s'est opposé à l'animisme. Pour l'auteur des Formes élémentaires de la vie religieuse, la pensée archaïque nous donne l'image des premières étapes d'une évolution intellectuelle continue, et elle met en œuvre les principes rationnels d'une... - Afficher les 78 références
Voir aussi
- REPRÉSENTATION & CONNAISSANCE
- RÉFLEXION, philosophie
- PHILOSOPHIE, de 1950 à nos jours
- FODOR JERRY ALAN (1935-2017)
- MENTALES FONCTIONS
- COMPORTEMENT
- FONCTIONNALISME, philosophie
- IDÉE
- COGITO
- INFORMATIQUE & SCIENCES HUMAINES
- CALCULABILITÉ
- SENSATION, philosophie
- PHILOSOPHIE, de 1900 à 1950
- INTENSION, logique