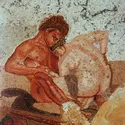PHALLUS
Article modifié le
Le phallus dans la théorie psychanalytique
Se distinguant du terme « pénis », qui désigne l'organe sexuel mâle dans sa réalité anatomique, le terme de phallus s'est imposé dans la théorie psychanalytique pour connoter une fonction symbolique dont la mise en place est essentielle à la juste position du sujet humain quant au désir et dont les avatars sont du ressort des différents types de névroses et de perversions. La fonction phallique occupe une place essentielle dans le destin subjectif tant de l'homme que de la femme, et c'est justement ce qui, d'emblée, marque que l'ordre symbolique se détache chez l'homme de la réalité biologique pour lui imposer sa détermination propre.
La prééminence du terme phallique est, en fait, impliquée dès la découverte faite par Freud, très précocement, de l'étiologie sexuelle des névroses et du rapport électif de la sexualité avec le refoulement et donc avec l'inconscient comme tel : c'est presque d'emblée que la sexualité s'est révélée à Freud comme étant à l'origine du symptôme, dans la mesure même où elle est pour le sujet impasse, aporie et lieu de foncière insatisfaction. La notion prend sa pleine importance à mesure que la théorie freudienne est amenée, voire contrainte par l'expérience même, à centrer toute la dynamique de la névrose et de la cure psychanalytique sur le paradoxe que Freud n'hésite pas à mettre au cœur du « malaise dans la civilisation » : l'être humain, quel que soit son sexe, ne peut tenir son rôle dans la relation du couple que s'il a rompu son identification imaginaire au phallus, c'est-à-dire s'il a été marqué de la castration, et l'organe ne peut rejoindre sa fin biologique qu'en passant par cette condition qui l'élève à la fonction de phallus symbolique. C'est à titre de symbole que le sexuel trouve accès au monde humain, mais au prix, dès lors, d'un sacrifice qui s'inscrit au cœur de la subjectivité.
Le phallus signifie donc ce qui, dans la sexualité, ne peut pas être assumé par l'individu, ou, à proprement parler, ce qui est non subjectivable ; il connote le défaut du sujet à cet endroit, c'est-à-dire qu'il le constitue comme manquant, et du même coup comme désirant. Il est le « concept » de la jouissance, mais au sens où le concept est le meurtre de la chose en même temps que sa libération du hic et nunc ; il est le signifiant d'une jouissance mythique, mais d'une jouissance à laquelle, dès lors, on peut dire que c'est lui qui fait obstacle. C'est ce qui explique qu'il prenne sa place centrale dans la théorie psychanalytique à mesure même que la fonction de la parole s'y trouve reconnue comme déterminante : c'est ici l'axe même que Jacques Lacan a donné par son enseignement à la recherche psychanalytique, et ce n'est pas par hasard que Lacan ait, du même coup, contribué de façon décisive à recentrer la théorie freudienne sur la question du phallus et sur la fonction paternelle.
La phase phallique selon Freud
La découverte de la phase phallique équivaut à reconnaître la suprématie de l'ordre symbolique par rapport au réel et à l'imaginaire, c'est-à-dire à reconnaître, quant à la détermination du sujet, l'antériorité logique du signifiant par rapport à tout effet de signifié.
La découverte par Freud du complexe d' Œdipe impliquait déjà, en effet, la reconnaissance d'un terme tiers comme nécessaire pour rendre compte de la complexité de la structuration subjective : rien de décisif ne peut se fonder, en ce qui concerne la subjectivité, à partir d'un rapport entre deux termes (la mère et l'enfant en l'occurrence) ; et le complexe d'Œdipe fait intervenir dans son caractère irréductible la fonction paternelle, qui introduit dans cette relation la médiation de l'interdiction : c'est le registre de la Loi. Cependant, pour peu que la rivalité entre le père et l'enfant, par exemple, occupe le devant de la scène et mette l'accent sur la dimension imaginaire du complexe, l'essence du symbolique peut être occultée, et cela dans la théorie elle-même.
Il n'en va plus ainsi à partir du moment où Freud est amené à décrire la phase phallique comme étape cruciale de l'évolution libidinale, en la présentant comme identique au départ pour l'un et l'autre sexe. Certes, les chemins divergent ensuite : le garçon, dit Freud, doit renoncer à son objet (la mère), en raison de la menace qui pèse sur son intégrité narcissique, alors que la reconnaissance de l'objet maternel comme aphallique marque pour la fille son entrée dans l'œdipe, c'est-à-dire le report de sa préférence sur son père. Il n'en reste pas moins que l'un et l'autre ont à faire l'épreuve du manque inscrit en leur être (l'étape décisive étant la reconnaissance de la « castration » de la mère) pour se situer par rapport au même ordre symbolique, dont le phallus est la clé de voûte. Dans le destin subjectif, la présence ou l'absence de l'organe est une péripétie par rapport à une donnée plus décisive encore : la prégnance de l'ordre symbolique est, dès lors, pleinement établie et coupe court à toute conception naturaliste, voire adaptative du désir, qui pourrait encore trouver refuge dans l'idée d'une symétrie possible de l'œdipe masculin par rapport à l'œdipe féminin. Le destin de l'homme et celui de la femme ne sont nullement voués à la complémentarité que tend à introduire l'imaginaire lorsqu'il adapte si volontiers le principe mâle au principe femelle : si la découverte freudienne a un sens, c'est justement que le phallus, comme terme tiers, restera entre eux comme le truchement obligé de leur mise en rapport. C'est en tout cas ce que Freud oppose de façon abrupte, tout au long de la grande controverse sur la signification de la phase phallique chez la fille, aux tenants – Ernest Jones en tête – d'une féminité qui serait inscrite dans le développement pulsionnel lui-même et se déterminerait autrement que par son rapport à l'instance phallique. C'est aussi le seul sens possible à attribuer à l'affirmation freudienne qu'il n'existe pas une libido masculine et une libido féminine, mais bien une seule libido, d'essence mâle : étrange asymétrie et privilège peu soutenable, sauf si l'on remarque que Freud parle de son expérience d'analyste et qu'il témoigne donc là que le sujet en analyse, en tant qu'il engage une épreuve de vérité en s'en remettant au seul cheminement de la parole, ne peut que découvrir avec le « phallocentrisme » une autonomie du symbolique, dont il faut bien penser que c'est la relation même de la parole qui en rend compte.
Le phallus, signifiant du désir
Nulle part le vivant sexué ne se trouve plus totalement confronté à la question de son être que là où il rencontre l'autre par excellence, celui que la différence sexuelle sépare de lui. Or, on peut dire que la reproduction sexuée apporte au vivant la mort, puisqu'elle le prive de l'immortalité du protiste en même temps qu'elle fait de l'individu le porteur contingent, voire l'appendice, du stock génétique ; la sexualité ne saurait donc représenter la cause du vivant que de façon partielle, sinon partiale. Mais, chez l'homme, ce qui s'inscrit du fait biologique se joint à ce qu'impose le langage, c'est-à-dire que toute réalisation subjective se trouve suspendue à autrui comme siège de la parole ; et la nature même du langage implique que s'y rende présent de quelque façon cela même qui ne peut y figurer : c'est ainsi que le phallus désigne la place de ce qui, chez l'être parlant, se perd nécessairement du fait de la sexualité.
Comprendrait-on que la fille en vienne à sacrifier sa propre nature pour le prix du pénis ? Mais il s'agit du phallus, et la thèse freudienne signifie que le désir humain ne peut se constituer que dans la dépendance d'autrui comme lieu de la parole, dans la mesure même où le langage conditionne tout accès au monde humain : il y a détour nécessaire par le lieu de l'Autre (la majuscule distinguant cet Autre du partenaire imaginaire et en marquant le caractère strictement topique) et c'est ce qui impose au sujet de ne pouvoir se constituer que comme marqué d'un manque.
Esquissons ce cheminement. L'enfant trouve, à sa naissance, le langage déjà constitué : il est prié de s'y assujettir pour l'expression du moindre de ses besoins. Mais le langage est inapte à véhiculer la particularité de son vouloir : cette particularité s'annule quand elle passe par la demande, puisque dans la demande l'objet n'est intéressé qu'au titre d'un signe d'amour. Dans le moment même où, en parlant, le sujet constitue l'Autre comme lieu véridique où il pourra être entendu, il engage la perte de ce qui, de lui, ne pourra pas se dire (c'est le sens du refoulement primaire pour Freud). Rencontrant l'Autre comme demande, c'est donc de l'impossibilité de l'Autre à répondre à la demande qu'il fait l'épreuve : ainsi se dessine la défaillance de l'Autre, sur quoi va se fonder le désir comme désir de l'Autre. Car le sujet pâtit de la même impossibilité de répondre à la demande de l'Autre : que lui veut-on (que le veut-on) au-delà de ce qu'on lui dit ? C'est là qu'il doit déchiffrer la question de son être, c'est-à-dire la question de ce qu'il a perdu du fait du langage, et il se constitue donc comme désir en étant comme tel le désir de l'Autre.
Ici apparaît la fonction du phallus, car le sujet, en principe, ne sait rien du désir de l'Autre ; cela signifie que son propre être lui est, à lui-même, étranger et problématique : c'est la fonction de l'angoisse que de surgir là où le sujet n'a plus de repère pour savoir ce qu'il est pour l'Autre. D'où la défense primordiale qu'il trouve en structurant le désir de l'Autre comme demande. Et c'est à ce signifiant de la demande – le phallus dans la phase phallique – qu'il va donc s'identifier pour répondre au désir maternel ; mais, du même coup, il en devient la marionnette. Ainsi apparaît la nécessité d'un signifiant qui fonctionne dans l'Autre comme celui de la Loi : dans le danger où se trouve le sujet de succomber à la subversion, propre à l'être humain, que le langage induit dans l'imaginaire, il découvre dans l'ordre symbolique, en tant que celui-ci impose au désir de l'Autre de se diriger vers un terme tiers, le seul pas qui s'offre à lui pour devenir sujet. Son être de sujet se verra dès lors fondé à mesure que le désir sera extrait de sa structuration comme demande.
Car, du côté du sujet, l'entrée en jeu du symbole phallique ouvre au désir, en tant qu'elle signifie du même coup renoncement à la jouissance autoérotique, et nommément, chez le garçon, à une part de la jouissance pénienne, puisque c'est sur elle que s'exerce le prélèvement qui fonde l'objet du désir. Le pénis ne devient phallus que s'il passe par une négativation ; et c'est l'organe mâle qui est pris dans ce procès, dans la mesure où, d'une façon contingente qui tranche avec les données du monde animal, la fonction pénienne et la détumescence soulignent chez l'homme le caractère discontinu et presque séparable de la jouissance sexuelle, et préparent ainsi la voie de l'impact symbolique.
Cette négativation portant sur le pénis entre à son tour dans le jeu intersubjectif en tant que, intéressant l'image narcissique, elle vient marquer celle-ci d'une absence, d'une incomplétude ; et cette place du manque est seule à pouvoir orienter le désir ; qu'elle soit assurée est ce qui interdit au sujet de s'imaginer comme l'objet comblant du désir de l'Autre, donc de son propre désir qui est le même. Mais cela n'est assuré que dans la mesure où, effectivement, pour le sujet, le symbole phallique est venu occuper le point où l'Autre défaille nécessairement : point de fading qui peut toujours rebondir et, par là même, assure le renvoi indéfini dont se soutient tout discours.
En s'engageant dans la voie des énoncés, le sujet aliénait son être : il sera celui qui fait défaut au discours, celui qui manque au compte, mais il ne le peut que si, dans l'Autre, le phallus se met en place comme signifiant même de l'impossibilité du signifiant à engendrer un signifié univoque. Le phallus est donc bien et la marque de la castration et le signifiant qui donne au sujet l'assurance d'être pur sujet, en fixant le manque d'objet dont il se soutient.
Décrire ainsi la fonction du phallus revient, en somme, à souligner la valeur structurante de l'interdit paternel : le phallus est formellement identique au Nom-du-père en tant que garant de l'ordre du langage ; et le mythe freudien de l'œdipe a bien pour sens de montrer que le désir ne se soutient qu'en incluant en lui-même le détour de la demande, qui a pour spécificité d'être le vide que l'interdit porte au cœur du désir : vide cohérent avec ce qui fonde l'absolu de la Loi, à savoir la mort du père, seule à pouvoir assurer cette place où il est comme absent, c'est-à-dire où il est pur signifiant, pure loi subsistante assurant le suspens du désir.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Claude CONTÉ : psychanalyste, ancien chef de clinique à la faculté de médecine de Paris
- Maurice OLENDER : assistant associé à l'École pratique des hautes études, (Ve section, sciences religieuses)
- Moustapha SAFOUAN : psychanalyste
Classification
Autres références
-
CASTRATION, psychanalyse
- Écrit par Pierre KAUFMANN
- 697 mots
Bien que la hantise de la castration ait laissé son empreinte sur la Traumdeutung (L'Interprétation des rêves), la notion n'en a été dégagée par Freud qu'à une époque tardive, dans le contexte initial de l'homosexualité et de la phobie infantile. S'agit-il d'abord...
-
DÉNI, psychanalyse
- Écrit par Pierre-Paul LACAS
- 820 mots
Terme utilisé en psychanalyse et qui se distingue notamment de celui de négation et de dénégation (Verneinung). Le déni (Verleugnung), ce qu'on peut traduire aussi par « désaveu » ou « répudiation » (cf. le disavowal anglais), est un mode de défense particulier, où le sujet...
-
DIFFÉRENCE SEXUELLE (psychanalyse)
- Écrit par Odile BOMBARDE
- 1 309 mots
..., radicalisant la manière dont l'élément organisateur de la sexualité humaine est, selon Freud, la représentation de l'organe masculin, a élevé le phallus à la dignité conceptuelle. Il n'y a du reste pas, dit-il, « de symbolisation du sexe de la femme comme tel ». Le phallus devient le signifiant... -
ÉROTISME
- Écrit par Frédérique DEVAUX , René MILHAU , Jean-Jacques PAUVERT , Mario PRAZ et Jean SÉMOLUÉ
- 19 777 mots
- 6 médias
...du bétail et la palingénésie ? Cette même idée faisait placer dans les champs, aux carrefours et dans les maisons des termes de l'Hermès arcadien avec indication plastique du phallus. La fonction d'éloigner le mauvais œil, propre au phallus, n'a rien d'érotique, pas plus qu'un autre objet qui avait le... - Afficher les 10 références
Voir aussi