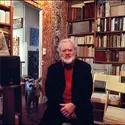PHÉNOMÈNE
Article modifié le
L'usage courant du français d'aujourd'hui serait de désigner par le terme de phénomène l'élément matériel d'un fait empirique. Dans cette tendance subsiste l'influence de la conception kantienne de l'Erscheinung qui situe dans le temps ou dans l'espace l'apparition de l'objet de l'expérience. Mais, dans la mesure même où cette perspective suppose la distinction entre le contenu empirique du phénomène et la construction du phénomène selon une forme a priori qui dépend de l'entendement, on voit que la référence au terme de phénomène renvoie à un problème philosophique antérieurement soulevé : celui de la correspondance entre la nature effective de l'objet empirique et l'apparence phénoménale que lui confère la perception qui s'efforce de s'en emparer. Pour étudier le concept de phénomène, il est indispensable de remonter, par-delà ces présupposés philosophiques, à l'origine scientifique ou même préscientifique du terme. Alors, on constate que le terme de phénomène a d'abord correspondu au statut que les penseurs grecs, prédécesseurs ou contemporains de Socrate, assignaient au perçu ; ensuite, au fur et à mesure que progressait la réflexion philosophique, ce modèle scientifique archaïque ainsi que le terme qui le dénommait ont servi à définir une attitude philosophique imitant l'ancienne position scientifique : alors que la physique et la physiologie anciennes tenaient le phénomène pour une réalité matérielle mixte produite par la synthèse de la lumière propre à l'objet sensible et au sens, la philosophie a, sur un plan non plus expérimental mais proprement spéculatif, posé le problème de la nature du perçu en termes de relation d'un objet et d'un sujet. Définir le concept de phénomène et mettre en relief son importance dans l'histoire de la pensée occidentale, cela revient à indiquer comment un concept scientifique archaïque a pu, au regard de la philosophie, remplir la fonction de modèle au point qu'un concept élaboré par les pythagoriciens et repris par les sophistes, par Platon et par Aristote a constitué le type selon lequel Kant a formulé le problème de la connaissance sensible sous une forme critiquée ensuite par Hegel, puis par la phénoménologie husserlienne.
La conception ancienne du phénomène
La perception sensible
Imaginons d'abord en quels termes la science archaïque, ayant à résoudre le problème de la mise en rapport d'un objet sensible, empirique et extérieur avec le sens ou la conscience interne propre à un sujet, a pu poser le problème de la perception dont la solution engageait le philosophe sur la nature de la rencontre de l'homme avec le monde. Trois hypothèses se présentaient. Ou bien l'on faisait dépendre le sentir du seul sujet, et alors le plus important dans la vision, par exemple, pouvait être pour un pythagoricien comme Alcméon (d'après Théophraste) la lumière issue de l'œil ; on sait que l'œil vivant contient un feu que ne renferme pas l'œil mort ou l'œil aveugle, et que l'œil des oiseaux de nuit illumine les objets sur lesquels se pose leur regard. À l'inverse, on pouvait concevoir, comme les épicuriens et dans une certaine mesure les cyrénaïques, que l'objet est la cause efficiente et directe de l'impression subie par le sens ; le toucher, la vue, l'ouïe, etc., seraient passivement affectés par la présence extérieure de l'objet, dont le contour, la configuration ou l'image s'impriment en l'âme par l'effet d'une impression qui intériorise cette présence. Cependant, l'une et l'autre de ces thèses ont peu d'adhérents. On trouverait dans les témoignages anciens des arguments qui permettent de penser que, d'une part, les pythagoriciens n'ont pas systématiquement professé que la perception relevât seulement du sens, et que, d'autre part, la conception de l'impression ou de l'affection, partagée par les cyrénaïques, ne décrit pas l'état d'une conscience ou d'un sens purement passif. En fait, la théorie la plus répandue est celle qui fait du perçu un être mixte, désigné par le terme de phénomène.
La nature physique du phénomène
Les témoignages les plus significatifs relatifs à la nature physique du phénomène chez les Anciens ont été conservés par Platon et par Aristote. Platon emprunte cette théorie de la perception à Empédocle (Timée, 45 b et 67 c) et à Protagoras (Théétète, 156 e-158 b). Aristote connaît cet examen par Platon de la thèse de Protagoras (Métaphysique, B, IV, 999 b 3) et la reproduit pour la critiquer (ibid., Γ, IV-VI et K, VI). Au commencement du iiie siècle de notre ère, Sextus Empiricus reprendra, touchant Protagoras, une tradition identique (Hypotyposes pyrrhoniennes, I, 216-219). Tous ces témoignages présentent l'image concordante du phénomène comme une réalité physique engendrée dans l'espace intermédiaire entre le sens et l'objet sensible par la disposition du sens et par la nature de l'objet. Ainsi, toujours dans le cas de la vision, on ne saurait dire que l'œil qui perçoit la blancheur entre directement en contact avec l'objet blanc. La cause de la blancheur qui est dans l'objet et la lumière en provenance de l'œil engendrent, à la rencontre de leur flux, dans la transparence diaphane du jour, un corps physique qui est le phénomène de la blancheur. Alors l'œil se remplit de blancheur et l'objet sensible devient lui-même blanc, objet sensible et sens reconnaissant mutuellement, à travers l'image de ce rejeton physique, la part qui revient dans cette génération à leur conjoint inconnu. Disons, pour être tout à fait clair, que les Grecs ont conçu la génération du phénomène comme unissant un père et une mère condamnés à ne jamais se voir et à ne se reconnaître l'un l'autre que dans le portrait de leur enfant. Telle est l'explication scientifique proposée par les Anciens au problème de la perception des objets sensibles : la conséquence épistémologique en est que la nature physique de l'objet n'est jamais connue en soi, tel que l'objet est en lui-même, mais se trouve appréhendée par un intermédiaire physique désigné sous le nom de phénomène. Déjà, avant Socrate, Anaxagore professait que le phénomène est ce que la vision appréhende de la réalité en soi obscure des choses, en se fondant sur une analyse de type atomiste des réalités sensibles dont l'apparence dissimule la présence cachée d'éléments imperceptibles. De même, au iiie siècle après J.-C., le néo-platonicien Plotin constate (Ennéades, II, iv, 5) que le fond des choses est obscur et masqué par la luminosité de la surface. Le clair, le perçu s'interposent entre le sens et le fond occulte de la chose matérielle.
Le relativisme
En même temps que se construit cette explication scientifique, s'élabore sur le même modèle un schéma philosophique : à la réalité physique du phénomène correspond le statut philosophique du relatif. En tant que produit mixte, le phénomène est un relatif. La catégorie du relatif étend à toutes choses le statut de cette médiation. Pour le sophiste Protagoras, toutes les choses sont relatives. De même que les sens du porc, du cynocéphale ou du tétard de grenouille mesurent la qualité phénoménale de l'objet empirique, de même le logos humain impose à toutes choses sa mesure. Mais, alors que Protagoras bornait toute réalité à l'univers sensible et changeant des phénomènes (et en cela il sera suivi par les sceptiques pyrrhoniens), Platon et Aristote considèrent que cette analyse ne vaut que pour le monde sensible et qu'il existe des réalités intelligibles et universelles, formes séparées pour Platon, genre et espèce immanents aux individus pour Aristote, et qu'à défaut des sens l' entendement et l'activité dianoétique peuvent saisir ou voir d'une manière spéculative ou théorétique. Après l'Académie et le Lycée, les stoïciens, qui pour leur part reviendront à un strict empirisme, et par conséquent refuseront l'existence d'intelligibles, devront s'efforcer de justifier que l'imagination est à même, dans la plupart des cas, d'imaginer correctement ou d'appréhender la cause de la représentation phénoménale pour procurer une « représentation compréhensive ». Contre eux, les académiciens puis les sceptiques développeront les arguments destinés à montrer que, quoi qu'on fasse et quoi que prétendent les dogmatiques, notre perception des réalités mondaines demeure toujours marquée par un relativisme originel.
Pourtant, chez Aristote, le concept de phénomène avait pris un double sens : à la fois celui de donné empirique et d'interprétation de ce donné. Mais ces deux sens demeuraient liés, parce qu'il estimait que l'opinion courante et la plus universellement répandue était constituée selon une structure non contradictoire : parce que généralement non contredite, l'opinion le plus souvent partagée respecte la loi de non-contradiction qui est propre à la réalité essentielle. En ce sens, l'opinion coïncide avec le fait puisque le fait échappe à la contradiction ; l'opinion non contredite restitue, au niveau de la pensée commune, les articulations et le relief propres au paysage du réel.
Mais cette conception aristotélicienne est, de l'aveu même de son auteur, une réaction contre le relativisme ; car qui dit relativisme dit impossibilité de constituer une science portant sur l'universel.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Jean-Paul DUMONT : professeur à l'université de Lille-III
Classification
Autres références
-
PHÉNOMÈNE (sciences)
- Écrit par Bernard PIRE
- 790 mots
Selon l'étymologie grecque (phainomenon, « ce qui apparaît »), un phénomène est un événement qui se produit à un certain moment par opposition à ce qui est immuable. Pour les physiciens ioniens (vie siècle av. J.-C.), la science des phénomènes consiste à établir des relations intelligibles,...
-
ACOUSMATIQUE MUSIQUE
- Écrit par François BAYLE
- 7 825 mots
- 5 médias
...chez René Thom, qui d'ailleurs a cité volontiers ce sémiologue du xixe siècle, précurseur d'une conception qualitative du monde : « Les phénomènes qui sont l'objet d'une discipline [...] apparaissent comme des accidents de formes définis dans l'espace substrat de... -
ANTINOMIE
- Écrit par Françoise ARMENGAUD
- 372 mots
N'est pas antinomie n'importe quelle contradiction, mais seulement celle qui joue entre des lois — soit des lois juridiques ou théologiques, soit des lois de la raison (Kant), soit des thèses déduites de lois logiques (théorie des ensembles) —, ni n'importe quel paradoxe...
-
BRADLEY FRANCIS HERBERT (1846-1924)
- Écrit par Jean WAHL
- 3 616 mots
...légère qu'elle apparaisse. Partout, nous sommes donc en contact avec ce qu'il appelle la vie indivise de l'Absolu. Cette vie indivise se fait avec les phénomènes transmués ; mais tous les phénomènes ne sont pas transmués d'égale façon ; car les uns sont plus hauts que les autres. C'est là un point que... -
CHOSE
- Écrit par Françoise ARMENGAUD
- 746 mots
Terme de la langue ordinaire dont la référence, une fois exclus les êtres animés, est purement contextuelle : telle « chose difficile », c'est ce sur quoi porte mon action tandis que je parle ; « la chose en question », c'est ce dont nous nous entretenons sans lui donner son nom usité ; « dites...
- Afficher les 28 références
Voir aussi