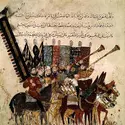PHILOLOGIE
Article modifié le
Situation actuelle
Des buts que visait jadis la philologie, seul le premier (l'établissement du texte authentique) demeure spécifique ; les autres (interprétation, jugement qualitatif) relèvent de disciplines diverses ou même ont cessé d'être considérés comme scientifiques (ainsi, jusqu'à un certain point, la recherche des sources). L'étude philologique d'un document comporte sa datation, son déchiffrement (paléographique, codicologique ou bibliologique), la collation des versions, l'examen comparatif et critique des variantes, la recension du texte (vérification sur l'original ou par rapport à d'autres éditions), l'émendation, le classement et l'interprétation des fautes, le repérage des interpolations, l'établissement des critères d'authenticité ; tâches diverses qui trouvent leur aboutissement commun dans la composition d'une « édition critique ». Celle-ci rassemble et classe un matériel dont l'élaboration finale demeure réservée au linguiste, à l'historien ou au critique : données objectives résultant synchroniquement de l'examen des « leçons » du texte, diachroniquement de la tradition manuscrite, et que réunit, en note ou en appendice, un « apparat critique ». Depuis 1950-1960, une tendance générale s'est marquée à mécaniser, grâce à l'emploi d'ordinateurs, l'établissement des textes critiques : les questions théoriques que pose l'emploi d'une telle technique ont fait l'objet de nombreuses discussions. L'informatique fascina les philologues dans les années 1970-1980. Elle rendit possible la « critique génétique ». Par la suite, l'enthousiasme retombe : utile à la collecte des faits, l'informatique paraît stérile sur le plan notionnel. Si un accord global règne sur la nature et les moyens des opérations philologiques, il n'en va pas de même au sujet de la finalité d'une édition critique. Sur ce point s'affrontent des opinions mal conciliables, fondées en dernière analyse sur des conceptions opposées de la nature de l'écrit : l'on admet (au moins implicitement) ou bien que tout texte possède un état de perfection idéal, extérieur à ses réalisations particulières, ou bien au contraire que toute réalisation particulière possède une authenticité irréductible. Quant à l'interprétation du texte, une fois que celui-ci a été établi, elle est revendiquée par la stylistique, elle-même branche, mal identifiée, soit de la linguistique soit d'une science hypothétique de la littérature ; dans la mesure où cette interprétation fait appel à l'univers sémantique de l'auteur, elle relève de la sémiologie ou de l'histoire des institutions et des mentalités, voire de l'étude des mythes individuels et collectifs telle que la rendent possible aujourd'hui l'ethnographie, la sociologie ou la psychanalyse.
On comprend que, dans ces conditions, la notion de philologie se soit beaucoup appauvrie et que le mot lui-même montre une tendance à tomber en défaveur. Trop large, si on le prend dans son acception ancienne, pour avoir la précision qu'exige la science actuelle, il fait double emploi, dans son sens étroit, avec l'expression plus claire de « critique textuelle ». On remarque du reste, à cet égard, des différences d'usage de langue à langue ; sur le continent européen, le mot entre plutôt dans le champ sémantique des études littéraires, alors qu'en anglais il se rapporte davantage à la langue : comparative philology y désigne en fait la linguistique comparée et historique par opposition à la linguistique descriptive. En français, en dehors de la terminologie figée de l'enseignement, le mot semble moins vivant et de contenu plus restreint qu'en allemand ou en italien. Ce recul et ces variations s'expliquent par la vogue même qu'eut « philologie » aux temps d'un historicisme dépassé.
Il n'en reste pas moins que c'est en Allemagne, où quelque chose de la tradition du xixe siècle s'est mieux maintenu, que le xxe a connu ce qui apparaîtra peut-être un jour comme la dernière génération des grands philologues : ainsi, parmi les romanistes, E. R. Curtius, L. Spitzer et E. Auerbach, morts tous trois dans les années 1960. Tandis que leurs collègues germanistes restaient davantage attachés à l'histoire culturelle dans sa forme la plus large (Geistesgeschichte), ces savants identifièrent le fondement de la philologie avec le rapport intime, très particulier, qu'entretient l'œuvre littéraire avec son lecteur, rapport de possession de la part de celui-ci (alors qu'on ne « possède » pas une œuvre plastique). L'ouvrage écrit a donc un mode d'existence plus libre et multiple (grâce aux éditions) que tout autre, il provoque l'intérêt de manière plus instante. Il est en effet un produit du langage, il accueille de façon plus immédiate une expérience qu'il implique et à laquelle forme et contenu s'accordent spontanément en vertu des fonctions naturelles de la langue. Largement empiristes, caractérisés par leur extrême retenue à l'égard des problèmes théoriques, Curtius et Auerbach en particulier tentèrent de revaloriser la philologie en désignant de ce nom l'effort qu'ils faisaient pour retrouver, dans les écrits de l'humanité, le témoignage qu'elle porte d'elle-même depuis les quelques millénaires qu'elle est apparue au niveau de l'histoire, c'est-à-dire à l'âge de l'expression. Conscient de ses racines idéologiques, Auerbach définissait la « philologie romane » comme l'un des rameaux de l'arbre de l'historicisme romantique, lequel avait ressenti le fait historique de la Romania comme « une totalité sémantique » (Sinnganzes). Il est douteux que l'orientation que prennent actuellement les sciences humaines laisse encore place à des tentatives individuelles de ce genre.
N. E. Enkvist proposa naguère plus modestement un schéma triangulaire des sciences du langage : critique littéraire (esthétique, historique, sociologique), linguistique descriptive et « philologie » (critique textuelle et stylistique), se conditionnant respectivement. Il concluait, il est vrai, que les éléments de ce triangle sont aujourd'hui dissociés, d'où l'absorption de plus en plus manifeste de la critique littéraire par la linguistique.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Paul ZUMTHOR : ancien professeur aux universités d'Amsterdam, de Paris-VII, de Montréal
Classification
Média
Autres références
-
AMPÈRE JEAN-JACQUES (1800-1864)
- Écrit par Encyclopædia Universalis
- 329 mots
Historien et philologue français né le 12 août 1800 à Lyon, mort le 27 mars 1864 à Pau.
Fils du physicien André-Marie Ampère, Jean-Jacques Ampère se consacre à l'étude des origines culturelles des langues et mythologies de l'Europe occidentale. Il entreprend son premier voyage en Allemagne en...
-
ARABE (MONDE) - Littérature
- Écrit par Jamel Eddine BENCHEIKH , Hachem FODA , André MIQUEL , Charles PELLAT , Hammadi SAMMOUD et Élisabeth VAUTHIER
- 29 248 mots
- 2 médias
...méthodologique fut dictée par le mode de transmission orale qui exposait le patrimoine à toutes sortes de vicissitudes, d'où la nécessité de l'approche philologique et chronologique pour authentifier les textes, fixer les étapes d'une évolution et détecter ses variations : travail nécessaire à toute histoire,... -
ARISTARQUE DE SAMOTHRACE (220-143 av. J.-C.)
- Écrit par Alain LABROUSSE
- 175 mots
Critique et grammairien grec, remarqué pour sa contribution aux études homériques. Aristarque se fixa à Alexandrie où il fut un élève d'Aristophane de Byzance et devint, en ~ 153, directeur de la Bibliothèque. Plus tard, il se retira à Chypre. Il fonda une école de philologues (qui recevront,...
-
BIBLE - L'étude de la Bible
- Écrit par André PAUL
- 6 437 mots
...préconisa en effet le recours aux langues anciennes ainsi que l'utilisation de « toutes les ressources que fournissent les différentes branches de la philologie ». Et il affirma que « le texte primitif a plus d'autorité et plus de poids qu'aucune version, même la meilleure, ancienne ou moderne ». Dès... - Afficher les 51 références
Voir aussi