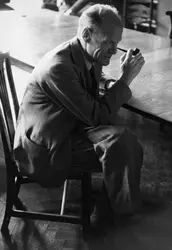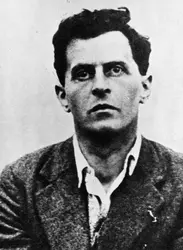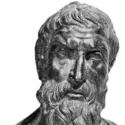PHILOSOPHIE ANALYTIQUE
Article modifié le
Situation et portée du mouvement analytique
Aucune doctrine cohérente n'a fait de ce mouvement analytique une école. Dans un milieu relativement autonome, d'intense remise en question, une structure de discussion apparaît dès le début entre des tendances mathématicienne (Russell, Ajdukiewicz), phénoméniste (Moore, Ayer, Kotarbinski) et phénoménologico-linguistique (Austin, Ryle) ; un dialogue incessant où Russell répond à Stuart Mill, le deuxième Wittgenstein au premier, Russell au deuxième Wittgenstein et à Russell lui-même. Mais cette confrontation, qui s'étend au rameau polonais et américain, n'était possible qu'en vertu d'une certaine communauté de vues sur la nature et le rôle de la philosophie. L'archéologie du mouvement révèle que la théorie implicite de cette pratique renvoie à un acquis définitif de la philosophie logique, à un renversement de la théorie traditionnelle des concepts et des propositions. C'est elle peut-être qui est au fond de l'incompréhension mutuelle qui existe entre analystes et phénoménologues.
Il ne suffit donc pas de dire que la philosophie analytique traduit les questions traditionnelles sous une forme linguistique (on ne demande plus si la réalité est faite de substances ou de propriétés de substances, mais si sujets et prédicats signifient de la même façon). Si la révolution analytique n'était qu'une affaire de commodité, elle se bornerait à systématiser une vieille habitude. Aristote et Abélard savaient disputer en termes alternativement ontologiques et linguistiques. Elle n'est pas non plus l'installation dans les verts pâturages d'un domaine réservé, caractérisée par une certaine façon, concurrente de la phénoménologie, de faire vœu de pauvreté en matière de connaissance : on savait depuis Brentano distinguer recherche empirique et recherche conceptuelle. Ce qui est nouveau, ce n'est même pas la tâche analytique comme telle – après tout, dès qu'on récuse l'adage moniste selon lequel le vrai, c'est le tout et l'absolu, la philosophie se donne essentiellement comme analyse –, mais c'est à la fois le présupposé philosophique de l'analyse et l'unité d'examen analytique.
Le présupposé philosophique de l'analyse
Quand l'éditeur d'Analysispublie une sélection d'articles sous le titre Philosophy and Analysis(1954), il emprunte son épigraphe au Tractatus : « L'objet de la philosophie est la clarification logique de la pensée. » Voilà bien une déclaration à laquelle tous les analystes pouvaient souscrire. Les philosophes diffèrent quant au point de départ qu'ils donnent à la philosophie. L'innovation cartésienne consiste peut-être à donner la première place à la théorie de la connaissance et un sens transcendantal au Je pense ; la philosophie analytique met sûrement la logique au commencement de la philosophie. Son acte de naissance est une double critique logique : critique pluraliste des relations internes, critique antipsychologiste de la signification meinongienne (le Husserl des Prolégomènes est peu connu). C'est pour résoudre les énigmes du réalisme logique que l'analyse formelle s'est développée, pour se libérer du monisme de la totalité, étranger au fait de la science, que l'analyse a cherché son principe dans la forme de toute connaissance qu'est la logique : universalité du principe de non-contradiction, primat du jugement de relation, externalité des relations. « Les grandes lignes de la philosophie analytique, écrit Ryle, ne peuvent être comprises que de celui qui a étudié les progrès fondamentaux de notre logique. Ce progrès est en grande partie responsable du large gouffre qui a séparé en ce siècle la philosophie anglo-saxonne de la philosophie continentale. » Ryle peut bien reprocher aux logiciens d'avoir converti les mots logicet logicalà leurs seules fins ; il n'en affirme pas moins que toute recherche conceptuelle (de « tous », « si », « non », mais aussi de « couleur », « futur », « responsabilité ») est élucidation de la forme logique de nos concepts.
Certes, deux pôles, la référence aux langages construits et le retour au langage ordinaire, correspondent à deux conceptions principales de l'analyse : l'analyse classique réductive et directionnelle de new levelet l'analyse dite linguistique, descriptive, sans hypothèse métaphysique, de samelevel, qui toutes deux revendiquent la finalité du mouvement. Mais l'important n'est pas là. Les considérations décisives restent des considérations logiques. Seulement, là où le philosophe logicien réfléchit sur les pouvoirs d'inférence de concepts qui n'engendrent pas trop de paradoxes, le philosophe de l'école d'Oxford traite de concepts qui engendrent d'authentiques perplexités (percevoir, évaluer...). Le primat du logique (formel ou « informel ») réduit nécessairement la Bedeutungau concept et le concept à ce qui est signifié par une expression ou une phrase. On réduit la signification aux seuls cas où l'on peut discuter sur le sens ou le non-sens d'une expression verbale. Or cette caractérisation n'est philosophiquement neutre qu'en apparence. Certes, on ne s'engage pas sur la sorte d'entité qu'est le concept – idée lockienne ou essence platonicienne –, mais les analystes admettent une bonne fois que nous n'avons rapport qu'avec des significations. Loin que le procès signifiant appelle pour eux un sujet philosophique, la conscience (le mot consciousnessest, en anglais, insolite à bien des égards) est elle-même une signification tardive et compliquée. Au lieu que la phénoménologie a un moyen direct d'accéder à ce que désigne le concept de conscience et mesure sur cette expérience toutes les significations, la subjectivité semble ici tenir son émergence dans l'être de quelque propriété du langage. Le seul donné dont nous disposons pour saisir le travail de nos concepts est l'usage logique en général. Le langage est pour la philosophie analytique comme un mode de réminiscence.
L'unité d'examen analytique
Ce qui est nouveau dans ce mouvement, c'est aussi l'unité de l'examen analytique. Non plus le mot mais la phrase, le concept mais la proposition, la vérité mais le sens. Sans doute, le platonisme offrait déjà de quoi rompre l'illusion d'un lien naturel entre le nom et la signification. Le Cratyledistingue entre le nom et le verbe. Le Sophiste attache au logosle problème du vrai et du faux. Le nom en devenant sujet du verbe représente l'agent d'une action. Mais la phrase platonicienne reste une description réglée sur l'objet dont on parle. La fonction attributive et des considérations purement sémantiques dominent la dialectique comme théorie de la phrase. Les logiciens du xixe siècle suivirent un plus long chemin. Contre l'explication associationniste inspirée de Stuart Mill, qui fait de la pensée une liaison de parties séparables et donne aux termes priorité sur les jugements, ce qui s'impose à eux, c'est avec l'unité fonctionnelle du jugement cette entité distincte du jugement qu'on appelle la proposition. Sous le nom de Satz an Sich(Bolzano), d'Objectiv(Meinong), de beurteilbareInhalt(Frege), la proposition était en logique l'élément initial, vrai ou faux, « asserté » ou nié. Tandis que la théorie du parcours des valeurs, correspondant aux significations dans le calcul, fournissait avec le contenu du jugement matière à la logique propositionnelle, parallèlement la philosophie analytique, en déplaçant l'analyse du sens des termes aux propositions prenait pour thème positif le nouveau rapport de la connaissance à son objet, défini par le rapport entre la proposition et la réalité.
Négativement, l'analyse de la proposition en argument et concept, l'identification de concept et fonction, enfin la théorie des descriptions qui rend compte du concept nominalisé étaient autant d'étapes dans la solution-dissolution du terme général. Elles avaient fait place nette : le rapport de vérité entre la proposition et la réalité, qui remplaçait le classique rapport de représentation, pouvait devenir l'enjeu de la révolution philosophique. Seulement, il lui fallait préciser son option. On peut dire que, depuis soixante ans à l'écart, bientôt contre l'entreprise phénoménologique, finalement sans avoir été influencée par l'héritage posthégélien, la philosophie analytique s'est employée à « répondre à Kant », comme le suggère B. Williams. Lui a-t-elle répondu ? On peut faire à ce sujet quelques remarques.
La réponse aux questions kantiennes
Tout d'abord, le discours qui prend pour thème le rapport entre une formulation linguistique et l'expérience (quel que soit le type de langage utilisé) est philosophique. L'analyse logique de la formulation entre dans ce discours comme son moment formel. Si l'on veut bien prendre garde qu'ici l'acte linguistique joue le rôle d'acte originaire de la connaissance, à la place de l'acte de percevoir, c'est un retour au paradigme kantien. On peut saluer, chez Russell, Ayer, Wittgenstein, Strawson, une préoccupation apparentée à ce que Kant appelait exposé ou recherche « métaphysique » (quid facti). Seulement c'est une analyse logique qui découvre les conditions formelles de toute expression. Et la formulation linguistique, qui occupe toute la distance qui sépare la perception de la science moderne, passe au premier plan de la philosophie analytique, alors qu'elle faisait gravement défaut dans le kantisme. Au fond, les développements extraordinaires de l'analyse linguistique dans la connaissance renouent, chez les néo-positivistes, avec une tradition qui avait découvert la valeur philosophique de cette médiation (cf. Hume, et surtout Locke, Essai, livre III). La véritable forme de l'objet scientifique ne concerne en effet jamais directement un contenu sensible, mais tout d'abord un langage où s'inscrit tout un procès formel.
On peut, d'autre part, faire remarquer qu'en revanche l'analyse logique de l'élément formel n'est philosophique que si l'on ne dissocie pas ce qui est analyse des faits de langage et ce qui est analyse des faits dont parle le langage. Ce qui est à comprendre, c'est toujours le sens de propositions susceptibles de recevoir la sanction du vrai et du faux ; le sens est toujours défini comme ce qui entre dans les conditions de vérité. Exclusif, le souci du formel conduit à substituer aux objets réels de science des constructions syntaxiques. Or, en un sens, le problème proprement transcendantal, qui concerne la détermination de l'usage (quid juris), s'est posé aux analystes. Mais Kant y arrivait par l'analyse régressive dans une philosophie de la conscience, Wittgenstein (qui utilise l'épithète « transcendantal ») et toute la philosophie analytique prétendent y parvenir par élucidation du sens dans une philosophie du concept. L'analyse logique nous livre des configurations possibles d'objets, sa rationalité est celle du fonctionnement des expressions linguistiques. En se voulant analyse philosophique, elle redouble la forme logique en forme transcendantale. De cette forme qui se révèle dans le travail de langage, l'analyse logique donne une formulation, mais comment la thématiser dans un discours ? Réservant le cas de Russell, il semble ou bien que la philosophie analytique tâtonne dès qu'il s'agit de donner un statut au discours proprement philosophique qui traite des conditions d'usage de l'expression, ou bien qu'elle en vienne finalement à supprimer le problème, en renonçant au caractère philosophique de l'analyse.
Certes, le discours philosophique existe. Wittgenstein, dans le Tractatus, transpose plusieurs thèmes kantiens : la priorité de la critique sur la doctrine ; le sens défini par rapport au non-sens ; la place faite à un au-delà du langage et de la connaissance. On retrouve même le paradigme kantien d'analyse transcendantale. Une définition comme « La proposition est image de la réalité », commente G. G. Granger, est toute différente d'une définition implicite apte à entrer dans une structure conceptuelle ; elle remonte en quelque sorte du conditionné à la condition ; en somme, elle est élucidation du « sens » de la proposition et non pas simplement de la forme logique de telle proposition. Seulement le Tractatusne donne pas les moyens d'assigner la rationalité du sens dans la limite des règles constitutives de la signification. Tout son discours est à découvert. Il paye la rançon de l'antipsychologisme radical de toute philosophie du concept qui veut saisir le formel dans le langage et dans le seul qu'elle répute signifiant. Le discours philosophique peut bien refléter l'expérience vécue du vrai discours, il est vide de sens (la forme logique n'est pas un fait, le langage ne peut exprimer que des faits), il est non-sens car il se disqualifie en mentant aux règles mêmes de la signification.
On retrouve le même embarras avec une issue différente chez les positivistes logiques. Ici encore, un discours philosophique existe. Carnap répond à Wittgenstein, justifie l'analyse philosophique comme analyse syntaxique, la philosophie comme métalangue. Plus riche que la syntaxe logique qu'elle analyse, elle est pourtant de même nature et de même type d'argumentation que le discours démonstratif des sciences. Seulement, outre qu'il renonce à thématiser la question du sens en s'attachant aux constructions syntaxiques indépendamment de leur rapport aux objets réels, ce formalisme intégral suscite autant de difficultés qu'il en résout. Cette fois le discours est légitime. On ne succombe plus à la tentation kantienne de croire que nos catégories sont des nécessités de pensée ou de langage en arrêtant la science à un stade de l'expression scientifique (fixisme transcendantal) ; mais, en généralisant les langages construits (comme en ouvrant les procédures analytiques à la variété des pouvoirs linguistiques dans l'école d'Oxford), on en vient à surévaluer la part active du langage dans la constitution des faits et à dissoudre toute théorie générale de la signification. Ne la voit-on pas se réduire parfois à sa définition sémantique et conventionnelle, à des critères sensoriels, de conformité sociale, de commodité pragmatique ? Avec le risque de démission inhérent à tout nominalisme, on recule d'autant la possibilité de rendre compte de l'objectivité des faits.
Il faut juger une philosophie sur ce qu'elle fait et non sur ce qu'elle ne fait pas. Pour répondre à Kant, la philosophie analytique a apporté une méthode, un lieu théorique et une contribution qu'on ne peut plus négliger. Qu'on songe combien de questions kantiennes précises sont puissamment renouvelées : l'existence et la critique de l'argument ontologique, la vérité mathématique, les antinomies et les limitations intrinsèques de la raison pure. Mais, chaque fois que la philosophie analytique va jusqu'à poser le problème transcendantal, elle balbutie plus ou moins consciemment. Il est vrai que le nombre des études anglo-saxonnes qui concernent celui qui s'était voulu d'abord postkantien semble indiquer qu'elle tend à revenir du scepticisme humien, où son génie l'incline volontiers, à sa source frégéenne.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Francis JACQUES : professeur à l'université de Rennes
- Denis ZASLAWSKY : docteur en philosophie de l'université Paris-I, chargé de cours à l'université de Paris-I, ancien assistant au Collège de France
Classification
Médias
Autres références
-
AJDUKIEWICZ KAZIMIERZ (1890-1963)
- Écrit par Françoise ARMENGAUD
- 725 mots
Philosophe et logicien polonais, né en Galicie, mort à Varsovie. Ajdukiewicz étudie à l'université de Lwów avec Twardowski et Łukasiewicz. Ses thèses de doctorat ont pour titres L'Apriorité de l'espace chez Kant et Méthodologie des sciences déductives. Il étudie aussi...
-
ANALYTIQUE PROPOSITION
- Écrit par Françoise ARMENGAUD
- 459 mots
Le mot « analytique » a au moins trois sens.
1. Au sens large, une proposition est dite analytique si elle est vraie en vertu de la signification des termes qu'elle contient. La simple considération des significations suffit à donner l'assurance de sa vérité. À ce sens se rattachent le...
-
ARISTOTE (env. 385-322 av. J.-C.)
- Écrit par Pierre AUBENQUE
- 23 793 mots
- 2 médias
...linguistique et historique, à l'architecture générale de la doctrine, à la forme des questions et aux présuppositions et attentes qu'elles impliquent. Le courant analytique, représenté aujourd'hui par la majorité des auteurs de langue anglaise (J. L. Ackrill, J. Barnes, etc.), fait abstraction de toute... -
ATOMISME
- Écrit par Jean GREISCH
- 1 366 mots
- 4 médias
...la chasse gardée des « sciences dures ». Dans le champ philosophique, l'atomisme va connaître un nouveau printemps grâce à certains représentants de la philosophie analytique. C'est le courant de l'atomisme logique, illustré par Bertrand Russell (1872-1970) et le « premier » Wittgenstein (1889-1951).... - Afficher les 40 références
Voir aussi