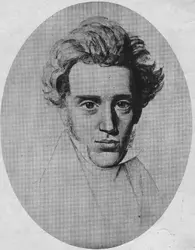EXISTENCE PHILOSOPHIES DE L'
Article modifié le
L'existentialisme en procès
La dernière pensée de Maurice Merleau-Ponty, notamment dans Le Visible et l'Invisible (1904) et les Résumés de cours (1968), voudrait faire sentir quelque chose qui est situé au-delà de la philosophie, même si cette dernière se présente sous forme d'une phénoménologie. Merleau-Ponty cherche à s'évader de la représentation. C'est à la peinture qu'il recourt de préférence pour nous donner le sentiment que profondeur, couleur, forme, ligne, mouvement, contour, physionomie sont des rameaux de l'Être, que chacun de ces éléments appelle l'autre, qu'ils sont pris dans une histoire, dans une temporalité profonde. Il fait alors appel à Klee, après en avoir référé à Vinci : « Je suis insaisissable dans l'immanence. »
Pour compléter sa réflexion, il pense qu'il faudrait s'adresser à la physiologie et à la biologie et faire apparaître, derrière ce qui est, ce qui est possible. Il estime encore qu'il existe une indivision antérieure à la réflexion qu'on doit rechercher. De multiples manières, il faut cheminer au-delà du cogito. Sartre avait parlé du cogito tacite. C'est vers un silence qui n'est même plus pensé que nous allons en suivant les indications de Merleau-Ponty.
La phénoménologie avait été conçue par Husserl comme une philosophie des essences ; Sartre et Merleau-Ponty ont tenté de faire ce que le premier a appelé une ontologie phénoménologique, et, apparemment, cette ontologie phénoménologique débouche sur des phénomènes insaisissables pour la représentation, mais qui nous mettent, par cela même, au sein de l'existence.
Dans Le Visible et l'Invisible, Merleau-Ponty dégage cette surréflexion qui nous fait saisir les liens organiques de la perception et de la chose perçue et qui tente d'exprimer « notre contact muet avec les choses, quand elles ne sont pas encore des choses dites ». Il y a un point où l'on est tout près à la fois de Bergson et de Husserl. Merleau-Ponty décèle cette présence du monde entier à nous-mêmes à partir de la perception. On atteint la région de la foi perceptive par laquelle on retrouve la fréquentation naïve du monde, région où reprennent leur valeur, non pas les idées d'éléments ou de champs, mais les éléments ou les champs eux-mêmes. On y saisit à nouveau la « pulpe même du sensible ». Mais, ici, ce qui est représentation ne peut pas être isolé de l'affectif, de tout ce domaine d'adversités ou de faveurs qui colore le centre même de nos perceptions. Ainsi, de l'existence solitaire de Kierkegaard, on arrive à une existence en communication avec les autres et avec le monde.
Le mouvement de la philosophie s'arrêtera-t-il là ? Sartre estime qu'il faut compléter l'existentialisme par le marxisme. Tel n'était pas l'avis de Merleau-Ponty. Il n'est pas question de revenir à une philosophie réflexive, ni à une philosophie de la vie, ni à une philosophie de la conscience. Il y a un domaine des relations éprouvées, vécues.
Le moment est venu où les cadres classiques ne suffisent plus ; au-delà des oppositions figées, on aperçoit ce règne où se confondent intériorité et extériorité ; et c'est cette fusion réciproque qui constitue l'existence.
Sartre, tout en reconnaissant la valeur de Freud, a pris position contre la psychanalyse freudienne et proposé une psychanalyse existentielle. D'autre part, il considère maintenant l'existentialisme comme un complément et, sur certains points sans doute, comme un correctif du marxisme. Tout en acceptant l'idée d'une dialectique, il n'admet pas une dialectique de la nature. En outre, il maintient qu'on peut expliquer le réel historiquement.
C'est dire aussi que l'existentialisme s'oppose au structuralisme. Il est sans doute difficile de parler d'une façon générale des structuralistes ; car, sur certaines questions, leurs positions sont très diverses. Mais ils opposent à l'importance que le xixe et le xxe siècle ont donnée à l'histoire celle de l'idée de structure. Partis de la linguistique et de l'ethnologie, ils découvrent des schèmes permanents.
Pour l'historien de la philosophie, les philosophies de l'existence s'inséreraient ainsi entre les philosophies de l'essence et les philosophies de la structure. Le penseur de l'existence, tel que le définit Kierkegaard, ne situe pas sa réflexion dans une trame historique ; il déclare nier l'objectivité et il nie peut-être, par là même, l'histoire. Ainsi, quel que soit le cours de l'histoire de la pensée, le penseur existentiel paraît en droit de se maintenir, c'est-à-dire de maintenir en opposition aux explications des classes et des complexes – sans parler des races – l'individu dans son individualité.
On pourrait se demander si la pensée existentielle est finalement surtout une pensée religieuse. Cela dépend évidemment du sens que l'on donne au mot « religieux ». Quelle que soit l'importance de l'influence qu'a exercée sur lui le christianisme, Jaspers ne peut pas être classé comme un penseur religieux. L'Umgreifend (l'englobant comme on le traduit ordinairement) n'est pas le Dieu de la religion commune. À plus forte raison Heidegger n'est-il pas un penseur religieux. Il est vrai qu'il refuserait aussi le titre de penseur de l'existence (qu'accepte Jaspers). Tout au plus arrive-t-il au divin. Grâce à quelques vers de Hölderlin, il nous fait pressentir un Dieu. Nous arrivons trop tard ou trop tôt pour atteindre le Dieu.
Cela ramène à l'idée que poésie et philosophie se rejoignent du point de vue de la pensée de l'existence.
De nouvelles questions naîtraient. Van Gogh, Rimbaud ne sont-ils pas, l'un avec ses toiles (et ses lettres), l'autre avec ses poèmes, des hommes de l'existence ? C'est dans les moments d'intensité que nous atteignons l'existence. Et c'est par l'angoisse, d'après la plupart des philosophes de l'existence, que nous accédons à ces moments d'intensité. Car c'est par elle que nous nous distinguons de la pensée banale, de la pensée de ce que Heidegger appelle le man, de ce qu'on a traduit par le « on ».
Gabriel Marcel a insisté, d'une part, sur les faits visibles par n'importe qui, ceux où je suis interchangeable avec l'autre, et, d'autre part, sur les faits qui ne peuvent être éprouvés que par moi. Dans la même ligne, Kierkegaard disait que la subjectivité est la vérité.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Jean WAHL : professeur honoraire à la faculté des lettres et sciences humaines de Paris
Classification
Médias
Autres références
-
EXISTENCE (notions de base)
- Écrit par Philippe GRANAROLO
- 3 075 mots
Ce n’est qu’au xxe siècle que la notion d’existence a pris une place centrale en philosophie avec le courant « existentialiste », dont la thèse a été formulée de façon particulièrement elliptique par Jean-Paul Sartre (1905-1980) : « L’existence précède l’essence. » Mais si cette...
-
ABBAGNANO NICOLA (1901-1990)
- Écrit par Sergio MORAVIA
- 873 mots
Esprit extrêmement précoce, Abbagnano débute sur la scène intellectuelle dans les années 1920 – un début caractérisé par une vive, surprenante originalité. Dans Le Sorgenti irrazionali del pensiero (1923) et dans Il Problema dell'arte (1925), il repousse nettement le néo-idéalisme...
-
AINSI PARLAIT ZARATHOUSTRA, Friedrich Nietzsche - Fiche de lecture
- Écrit par Philippe GRANAROLO
- 1 270 mots
En août 1881, au bord du lac de Silvaplana, proche du village de Sils-Maria, dans l’actuel canton suisse des Grisons où il passait ses étés, Friedrich Nietzsche (1844-1900) eut une illumination : la « vision du Retour Éternel » (parfois dénommée « vision de Surléï »), qui le conduisit quelques...
-
ANGOISSE EXISTENTIELLE
- Écrit par Jean BRUN
- 2 552 mots
- 1 média
...constituent et qui nous coupent la parole ? Telles sont les questions que pose la philosophie de Heidegger, philosophie de l'Être et non de l' existence : l'angoisse y est tenue pour cette relation de la réalité humaine au Néant qui en fonde les négations à partir de l'Être et qui fait d'elle... -
CONTINGENCE
- Écrit par Bertrand SAINT-SERNIN
- 4 902 mots
...l'homme, ou bien on en rend sa liberté responsable. La première version peut se rattacher à la précédente, et c'est certainement la seconde qui, dans les philosophies de l'existence, a l'importance la plus grande. Ainsi entendue, la contingence signifie la liberté humaine elle-même, se frayant un chemin... - Afficher les 45 références
Voir aussi