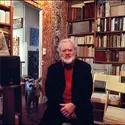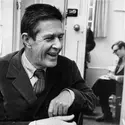BOULEZ PIERRE (1925-2016)
Article modifié le
Le compositeur
Le compositeur aborde, dès ses premières œuvres, d'essentiels problèmes de forme : dialectique du « fixe » et « flou », aspect « réseau » plus que « schéma » d'une structure musicale, idée que la forme se crée à partir de déplacements. Plus précisément, que c'est par un ensemble de « déductions » que le créateur passe de l'Idée à l'œuvre. En d'autres termes, ce seront les « conséquences » du matériau qui détermineront la structure.
Par ailleurs, il faut remarquer l'attachement du compositeur à la notation, à l'écriture de la partition. Il n'y consacrera pas moins de trois leçons au Collège de France. Sa grande expérience de l'orchestre l'autorise à juger de l'efficacité de la notation, et de statuer qu'au-delà d'une certaine complexité il ne peut y avoir qu'approximation et désordre.
Cette position a sûrement déterminé la relative économie avec laquelle il use de ce prodigieux instrument qu'il a créé en 1977 et dirigé pendant quinze ans, jusqu'en 1992, l'I.R.C.A.M. (Institut de recherche et de coordination acoustique/musique). Alors qu'aujourd'hui les sirènes de l'informatique musicale ensorcellent trop de compositeurs et les conduisent parfois à un automatisme stérile, on ne peut qu'admirer l'emploi qu'en fait le compositeur de Répons ; usage parfaitement contrôlé, parfaitement maîtrisé. L'I.R.C.A.M. n'en reste pas moins un prodigieux laboratoire où s'élaborent des logiciels très performants dont s'empareront avec grand talent et en dehors de tout « bricolage » des compositeurs comme Philippe Manoury ou Tristan Murail, entre autres.
Fait singulier, il apparaît difficile de classer l'œuvre de Pierre Boulez en époques ou périodes, car souvent une œuvre se trouvera modifiée, réorchestrée, repensée au cours des années. D'autres, au contraire, seront fixées définitivement dès leur création ; certaines, enfin, parcourent la vie du créateur tel un « journal ».
C'est d'ailleurs le mot qu'emploie le compositeur dans le programme du concert du 7 novembre 2006 à propos de la dernière version de Dérive 2 : « ...une sorte de journal reflétant l'évolution des idées musicales proprement dites, mais également la façon de les organiser dans une sorte de mosaïque narrative ».
Et l'on peut considérer comme de véritables « works in progress » Le Visage nuptial (1946-1951-1989), Le Soleil des eaux (1948-1958-1965), Le Marteau sans maître (1953-1957), tous trois d’après des poèmes de René Char, Improvisation III sur Mallarmé (1959-1984), Pli selon pli (1957-1962-1984-1989), Cummings ist der Dichter... (1970-1986).
D'autres œuvres restent en permanence sur l'établi et croissent au fil des années : Répons, Incises, Anthèmes et Dérive, par exemple.
Mais plus étonnant est le destin des Douze Notations, pour piano, datées de 1945 et qui deviennent le matériau initial des Notations I-IV, pour grand orchestre (1978-1984).
Toujours sans doute sur le métier les Notations V-XII, pour orchestre, pour lesquelles le catalogue indique pudiquement : 1984-... !
On pourrait cependant articuler chronologiquement cette œuvre autour de quatre faîtes essentiels : la Deuxième Sonate pour piano, la Troisième Sonate pour piano, Le Marteau sans maître, Éclat et Éclat/Multiples, Répons.
1948 : la Deuxième Sonate pour piano surgit à la manière d'un plissement géologique aussitôt fixé, et conteste violemment les sécurités sérielles ou rythmiques de l'époque. Œuvre beethovénienne, d'un grand lyrisme pianistique, dans laquelle la notion de structure musicale se trouve radicalement repensée.
Le Visage nuptial et Le Soleil des eaux, œuvres pour voix et orchestre, sont passées, elles, par plusieurs stades, soit de conception, soit seulement d'écriture.
Les Structures pour deux pianos, enfin, dont la composition débute en 1950, représentent le journal intime d'une évolution musicale en même temps qu'un champ d'expérimentation constant. On ne peut s'empêcher d'évoquer, à ce propos, L'Offrande musicale ou L'Art de la fugue de Jean-Sébastien Bach.
En 1955, Le Marteau sans maître (voix et ensemble instrumental) soulève une nouvelle fois l'écorce musicale, singulièrement dans la relation entre texte et musique. Accueillie par beaucoup comme « facile » (on ira jusqu'à dire « de salon »), l'œuvre manie le principe sériel d'une façon beaucoup plus élargie et totalement neuve. Mais plus encore, l'essentiel franchissement réside dans une dialectique du choix et de l'obligation, prophétisant celle de la Troisième Sonate pour piano, qui suivra. Le choix, dans Le Marteau sans maître, est celui du créateur ; dans la Troisième Sonate, il sera laissé à l'interprète. Choix sous haute surveillance, puisqu'il s'agit plutôt de « parcours » soigneusement balisés que de hasards plus ou moins heureux. Mais les deux œuvres illustrent déjà, bien qu'à des niveaux différents, cette notion d'« itinéraire » à laquelle Pierre Boulez est profondément attaché. « On devrait s'y promener, a-t-il souvent déclaré, comme dans un labyrinthe... »
Le « Livre » de Mallarmé, livre à feuillets mobiles que le lecteur peut ordonner à son gré, devait venir confirmer (lorsque Jacques Scherer en publia les premiers fragments, en 1957) cette démarche, proprement boulézienne, des parcours multiples à l'intérieur d'une œuvre, et qui allait aboutir à une notion de liturgie.
La liturgie associe un « commun », texte de base, à un « propre », texte lié à une circonstance. L'auteur de la Troisième Sonate oppose une structure principale inamovible à des pièces indépendantes et mobiles se déplaçant autour de cet axe. Il s'agit d'un « rite », engendrant une forme perpétuellement renouvelée.
Dans Éclat, créé à Paris en 1966, la notion de jeu (celui du chef d'orchestre avec ses musiciens) fait de ce rite un rite collectif. Le spectacle musical est fascinant et un rapport nouveau s'établit entre celui qui ordonne, ceux qui répondent, ce qui est entendu et ceux qui écoutent. Une démarche de même type s'établit en 1968 avec Domaines, pour clarinette et vingt et un instruments ; elle suit la création du Livre pour cordes et une première approche de la relation interprète-machine se constitue en 1972 dans ...Explosante-Fixe..., pour huit instruments et électronique.
Puis se succèdent : en 1974, Cummings ist der Dichter ; en 1975, Rituel, In memoriam Bruno Maderna ; en 1978, Messagesquisse ; en 1980, Notation I et Dialogue de l'ombre double en 1985.
La réalisation de la première version de Répons, en 1981, pour ensemble instrumental et ordinateur en temps réel, est non seulement un des sommets de l'œuvre boulézienne mais constitue aussi un événement majeur de la création musicale contemporaine. L'exécution de l'œuvre exige un espace spécial (cubique ou sphérique), très différent de la salle de concert traditionnel ; la salle de la Philharmonie de Berlin pourrait en être le modèle. Situés en hauteur tout autour, six solistes aux instruments particulièrement résonnants dialoguent avec l'ensemble instrumental, disposé au centre. Leurs sons sont traités électroniquement en temps réel par les machines élaborées à l'I.R.C.A.M. Le public se trouve, lui, en couronne, entre les deux groupes. Il lui sera demandé, après une première exécution, de changer de place pour une nouvelle écoute. Sa relation de proximité avec les instruments et les diffuseurs de sons déterminera alors une audition différente. Outre la qualité du texte musical, le dispositif de réalisation donne à cette œuvre un relief saisissant. Il fait de son public un « participant ». Participant qui attend régulièrement le prochain épisode du feuilleton, puisque cette partition ne cesse, au fil des années, de proliférer. Sera-t-elle jamais achevée ?
Dans le même temps, la « Technique I.R.C.A.M. » (c'est ainsi qu'elle est mentionnée dans les programmes de concert) progresse à grands pas ; elle devient plus sûre, plus mobile. Le compositeur y recourt de plus en plus souvent, assisté d'Andrew Gerzso, qui élabore et gère le dispositif informatique.
Et c'est alors Dialogue de l'ombre double (1985), un clarinettiste solo dialogue, littéralement, avec son « ombre » électroacoustique, spatialisée dans toute la salle. Anthèmes, pour violon (1992), devient en 1997 Anthèmes II, pour violon Midi et électronique, avant d’être transcrite en Anthèmes II, pour alto et électronique live (2008) ; la pièce initiale se trouve là considérablement développée et, en temps réel, le son du violon analysé, « reformé » pour produire un résultat sonore différent en interaction avec l'instrumentiste. ...Explosante-Fixe... (1972) est reprise en 1993 dans une version pour flûte Midi, deux flûtes solistes, ensemble et électronique.
Une profonde et riche pensée musicale maîtrise désormais la complexité des machines ; le terrain, préalablement défriché, est ici irrigué, mis en valeur, et donc producteur de récoltes nouvelles.
Retour à l'écriture (ou plus exactement à la réécriture) exclusivement instrumentale cette fois avec Dérive 2, primitivement conçue pour six instruments (1984), puis pour onze instruments (1990) et dans une nouvelle version (2006).
Dérive 2 constitue l'exemple d'une œuvre en perpétuel devenir, d'une rigueur exigeant du compositeur un réexamen de son passé à la lumière d'expériences nouvelles. Sa pratique constante de l'orchestre autant que sa pensée musicale toujours en mouvement (Penser la musique aujourd'hui !) en sont le moteur.
Et l'on ne peut s'empêcher de rapprocher ce comportement de celui d'un Gustav Mahler, lui aussi chef d'orchestre, profitant de la direction de ses œuvres pour remanier certains dispositifs d'orchestration. Les points communs entre les deux musiciens ne s'arrêtent pas là : comme Boulez, Mahler était aussi animateur institutionnel (comme directeur d'opéra), militant de la musique nouvelle et, surtout, « résistant ».
Résistant tout autant que dans sa jeunesse, Boulez poursuit obstinément sa lutte pour la défense d'une musique dans laquelle il est entré comme on entre en religion. Son exigence, dans toutes les disciplines qu'il pratique, reste un modèle.
Enfin, à une époque où la contestation se porte précisément sur l'existence même de l'œuvre et de l'artiste, où s'opposent formalisme et informel, réflexion solitaire et jeu collectif, expérience pratique et pensée théorique, on demeure ébloui par une expression créatrice multidimensionnelle qui ne cesse d'abolir ces contradictions. C'est une rare poétique de l'invention musicale qu'il y a lieu de parcourir dans l'œuvre et la vie de Pierre Boulez. Et probablement aussi une éthique que l'on peut dégager d'une de ses déclarations : « Il faut avoir vis-à-vis de l'œuvre que l'on écoute, que l'on interprète ou que l'on compose, un respect profond comme devant l'existence même. Comme si c'était une question de vie ou de mort. »
Pierre Boulez meurt à Baden-Baden (Allemagne), le 5 janvier 2016.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Michel FANO : compositeur
Classification
Médias
Autres références
-
PIERRE BOULEZ (exposition)
- Écrit par Alain FÉRON
- 905 mots
- 1 média
Organisé autour des œuvres phares de Pierre Boulez, l’hommage en forme d’exposition que nous propose la Philharmonie de Paris, du 17 mars au 28 juin 2015, se révèle très intelligemment conçu.
Agrémenté d’un grand nombre de documents (photos, lettres, manuscrits de partitions, extraits...
-
RÉPONS (P. Boulez)
- Écrit par Juliette GARRIGUES
- 288 mots
- 1 média
La version initiale de Répons, de Pierre Boulez, est créée le 18 octobre 1981 au festival de Donaueschingen, sous la direction du compositeur. Avec cette pièce pour solistes, ensemble instrumental et dispositif électroacoustique, l'idée, chère au monde occidental, de l'œuvre-objet, produit fini...
-
ACOUSMATIQUE MUSIQUE
- Écrit par François BAYLE
- 7 825 mots
- 5 médias
1980. Utilisation du système 4X par Pierre Boulez à l'I.R.C.A.M. (Institut de recherche et de coordination acoustique/musique) dans son œuvre Répons pour la projection/transformation du jeu des six solistes. En 1988, la Matrix 32 assurera une répartition programmée des mouvements du son dans... -
ALÉATOIRE MUSIQUE
- Écrit par Juliette GARRIGUES
- 1 302 mots
- 4 médias
...arrivée fixés pour toujours. Le « Livre » de Mallarmé – qui n'a ni commencement ni fin obligés et dont les pages peuvent être lues dans n'importe quel ordre – exerça ainsi une influence très forte sur Pierre Boulez, qui tenta d'en donner l'équivalent musical dans sa Troisième Sonate pour piano (1957). -
AMY GILBERT (1936- )
- Écrit par Alain FÉRON et Juliette GARRIGUES
- 2 710 mots
Sa rencontre avec Boulez, en 1956, va être décisive pour son processus compositionnel, de même que sa fréquentation des cours d'été de Darmstadt en 1958 et 1960, où il découvre Karlheinz Stockhausen et fait la connaissance de Bruno Maderna, Luigi Nono et Henri Pousseur. En 1957, sa Cantate... -
ANALYSE & SÉMIOLOGIE MUSICALES
- Écrit par Jean-Jacques NATTIEZ
- 5 125 mots
- 1 média
...« La musique est, par son essence, impuissante à exprimer quoi que ce soit [...]. L'expression n'a jamais été la propriété immanente de la musique » (I. Stravinski, 1962, p. 110). Et Boulez affirmait, sans concession : « La musique est un art non signifiant » (1961, in P. Boulez, 1985, p. 18). - Afficher les 20 références
Voir aussi