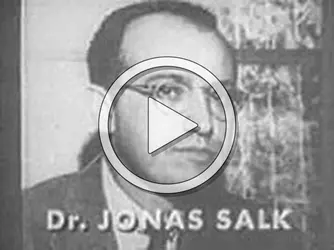POLIOMYÉLITE
Article modifié le
Épidémiologie
La poliomyélite est essentiellement une maladie de l'homme et l'accompagne dans ses déplacements : l'homme est la source du virus, comme il en est le réservoir principal sinon unique.
Sources potentielles d'infection
À partir d'un sujet atteint d'infection inapparente, les sources potentielles d'infection sont représentées, d'une part, par les sécrétions rhino-pharyngées et l'expectoration, d'autre part, par les matières fécales. Leur importance est loin d'être égale.
– L'élimination rhino-pharyngée du virus est précoce, mais de courte durée (de 48 h avant les premiers symptômes à la fin de la deuxième semaine).
– Au contraire, on a recueilli du virus dans les selles de sujets infectés jusqu'à trois semaines avant l'apparition des symptômes ; durant la première semaine de la maladie, tous les sujets sans exception éliminent du virus dans les selles ; après deux semaines, on le retrouve chez 67 % des malades ; après cinq à six semaines, chez 25 % ; et, après quatre mois, chez 1 à 3 %. L'élimination intestinale dure d'autant plus longtemps que l'infection est plus latente et que les symptômes cliniques font défaut. Il est donc pratiquement impossible d'opposer une barrière à la diffusion du virus par le seul isolement des malades atteints de formes fébriles paralytiques. L'introduction d'un sujet contagieux dans une communauté entraîne la diffusion rapide de l'infection, la plupart du temps sous forme inapparente, chez 60 à 90 % des membres du groupe. Déposé dans les milieux extérieurs par les déjections contaminées, le virus peut, à distance, infecter d'autres sujets réceptifs, par l'intermédiaire de l'eau, du lait, ou encore des légumes crus.
Voies d'entrée et propagation du virus
La voie d'entrée du virus est le tube digestif sur toute sa longueur, ce qui explique la possibilité de contamination, aussi bien directe au niveau de la muqueuse pharyngée (par aérosols respiratoires ou mains sales du porteur de virus) qu'indirecte par la muqueuse intestinale (eau, aliments contaminés). Le virus se multiplie d'abord dans la paroi intestinale, puis gagne le système lymphatique (ganglions mésentériques, en particulier) et de là passe dans le sang (virémie de la période terminale de l'incubation). On ne sait pas encore si la localisation du virus dans le système nerveux se fait par la voie sanguine ou par cheminement le long des nerfs (neuroprobasie) à partir de la porte d'entrée. L'expérimentation fournit autant d'arguments en faveur d'une théorie que de l'autre, et il est probable que les deux modes d'atteinte du système nerveux central sont également vérifiés dans l'infection naturelle.
Immunité naturelle
Pourquoi alors, dans une population non vaccinée, le nombre des cas de poliomyélite paralytique est-il malgré tout relativement restreint ? L'explication réside dans les anticorps neutralisants que l'on a trouvés non seulement chez les convalescents de la maladie (A. Netter et C. Levaditi, 1910), mais aussi chez presque tous les individus normaux d'une population adulte (S. D. Kramer et W. L. Aycock, 1931). Ces anticorps sont le résultat d'infections inapparentes précoces survenant chez l'enfant ; ils traduisent l'immunité spontanée observée surtout chez certaines populations.
Dans les pays où la poliomyélite est absente ou rare et affecte seulement des enfants, on constate que, du fait des conditions d'hygiène déficientes, les nouveau-nés, pratiquement sans exception, présentent dans leur sérum, dès la naissance, des anticorps pour les trois types du virus ; ce sont des anticorps transitoires reçus par voie transplacentaire de mères elles-mêmes immunisées. Au cours des six premiers mois de leur vie, les nourrissons étant infectés de façon répétée par des virus sauvages contre lesquels ils sont protégés par les anticorps maternels, le taux des anticorps remonte au lieu de s'annuler, de sorte que, à l'âge d’un an pour certains pays, à deux ou trois ans dans d'autres, tous les enfants ont à nouveau dans leur sérum des anticorps acquis simultanément pour les trois types du virus.
Dans les pays évolués, au contraire, où les nouveau-nés sont placés dans des conditions strictes d'hygiène et où leur alimentation fait l'objet d'une surveillance minutieuse, on constate un décalage progressif dans l'apparition des anticorps qui, le plus souvent absents au moment de la naissance, ne surviennent en pratique qu'à partir de l'âge de quatre ou cinq ans, ou même plus tard, l'immunité étant acquise d'abord pour un seul type, puis pour deux, et tardivement, sinon jamais, pour les trois. Une population est d'autant plus sensible au virus que les trois anticorps spécifiques apparaissent plus tardivement et avec un plus grand décalage. L'état de prédisposition d'une population à la poliomyélite est jugé par l'âge où 50 % de cette population présente des anticorps vis-à-vis des trois types du virus (A. M. M. Payne, 1957).
Si la poliomyélite a pu prendre un cours galopant avec des épidémies de plus en plus massives et dangereuses dans les pays connaissant une hygiène évoluée, c'est qu'un nombre croissant d'enfants et de jeunes sujets arrivaient à l'âge adulte sans avoir jamais acquis cette immunité spontanée qui, autrefois et au prix d'une mortalité infantile élevée, assurait une protection durable due à des infections latentes et répétées par les virus sauvages des trois types du poliovirus.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Pierre LÉPINE : professeur honoraire de l'Institut Pasteur, membre de l'Académie des sciences et de l'Académie nationale de médecine
Classification
Médias
Autres références
-
KOPROWSKI HILARY (1916-2013)
- Écrit par Melinda C. SHEPHERD
- 491 mots
Le virologue polonais Hilary Koprowski mit au point un vaccin vivant atténué efficace contre la poliomyélite, administré par voie orale. Il effectua le premier essai clinique en 1950, soit deux ans avant que l’équipe de Jonas Salk teste son vaccin inactivé injectable, neuf ans avant qu’Albert...
-
LANDSTEINER KARL (1868-1943)
- Écrit par Paul SPEISER
- 913 mots
- 2 médias
En injectant à un singe de la moelle épinière homogénéisée d'un enfant mort depoliomyélite, Landsteiner réussit à reproduire les altérations caractéristiques de cette maladie (lésions de la moelle, paralysie). En collaboration avec C. Levaditi (Institut Pasteur, Paris), il décrit une méthode sérologique... -
LÉPINE PIERRE (1901-1989)
- Écrit par Léon LE MINOR
- 1 367 mots
Né à Lyon en 1901, Pierre Lépine s'engagea lui aussi dans la carrière médicale. Il fut externe, puis interne des hôpitaux de Lyon et, très tôt, s'intéressa au travail de laboratoire : au cours de ses études médicales, il fut moniteur de physiologie à la faculté des sciences, puis assistant de parasitologie...
-
LEVADITI CONSTANTIN (1874-1953)
- Écrit par Jean LEVADITI
- 506 mots
Né à Galati (Roumanie), Constantin Levaditi, médecin français, est d'abord, en 1896, interne des hôpitaux à Bucarest et se consacre à des recherches expérimentales. Après avoir été préparateur du professeur Babes à Bucarest, il est nommé à Paris préparateur du professeur Charrin au Collège de France....
- Afficher les 11 références
Voir aussi