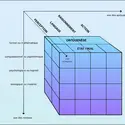PRAGMATIQUE
Article modifié le
La leçon philosophique
L'approche pragmatique intéresse le philosophe à plusieurs titres ; tout d'abord, dans la mesure où sa genèse est complexe et où son programme requiert des interprétations multiples ; ensuite, du fait qu'elle requiert des arbitrages interdisciplinaires entre linguistes, logiciens, sémioticiens, socio-linguistes et spécialistes de la communication ; troisièmement, cette approche permet de reprendre à nouveaux frais certains problèmes philosophiques.
Selon Apostel (1981), c'est le cas, en premier lieu, pour l'entreprise kantienne de déduction des catégories transcendantales. Si toute pensée que p doit pouvoir en principe être accompagnée d'un « je pense que p », on pourra inférer, à partir des relations entre le langage et son utilisateur, certaines propriétés des objets possibles dont il est question dans le langage. Ajoutons que l'existence de controverses métathéoriques obligerait sans doute à revoir la formulation de la question critique. En deuxième lieu, la philosophie des sciences reconnaît de plus en plus nettement que les concepts tels que « soutenir une théorie », « considérer un énoncé comme une loi », « utiliser un argument à l'égard de quelqu'un pour expliquer un fait » sont des relations pragmatiques.
Apostel fait remarquer, en troisième lieu, que les rapports entre les acteurs de la pensée, de la perception ou de l'imagination, et les objets correspondants pourraient recevoir un traitement pragmatique. En quatrième lieu, le « cogito, ergo sum » cartésien pourrait être reformulé de manière significative. Ainsi : « Quand j' asserte que je doute de mon existence, je dois exister en tant que j'accomplis l'acte de langage d'asserter quelque chose. » La connexion exprimée par cette paraphrase entre un énoncé et l'agent produisant cet énoncé a sa place en pragmatique. L'énoncé « je n'existe pas » a un statut paradoxal d'inconsistance pragmatique. Comme l'observe Recanati (1979), il n'est pas vraiment contradictoire comme un énoncé analytique, ni simplement falsifiable à la manière d'un énoncé synthétique. On a affaire à une contradiction sui generis entre ce qui est dit, le contenu propositionnel et le fait de le dire en tant qu'il est indiqué dans la proposition et qu'il se reflète dans le sens même de l'énoncé. L'inconsistance de « je n'existe pas » signifie que quiconque essaie d'en persuader quelqu'un (lui-même aussi bien) détruit sa propre énonciation. Personne ne peut faire croire à son interlocuteur qu'il n'existe pas en le lui disant. Ajoutons (Jacques, 1982) que, si l'on définit l'énonciation comme une activité de mise en discours où les instances énonciatives sont indissociables de leur relation actuelle, l'assertion « tu n'existes pas » est tout autant réfutée par un acte de discours actuel et effectif que l'assertion « je n'existe pas ». Il semble bien que la certitude du cogito ne tienne pas à un enchaînement déductif d'énoncés et ne relève pas d'une simple performance, mais d'un authentique argument qui comporte un aspect pragmatique constitutif. Il en résulte que cette certitude ne dépend pas de la primauté d'une expérience interne immédiate, mais d'une situation simultanément communicationnelle et réflexive. Toutes les fois qu'il est prononcé, l'énoncé « je pense » ou « je doute que j'existe » ou « je n'existe pas » présuppose l'existence de ces déterminants pragmatiques que sont je et tu. La relation interlocutive paraît être un événement de l'esprit aussi ancien que le cogito lui-même. C'est assez dire que les problèmes de l'identité personnelle, de l'altérité, de la subjectivité et de la différence gagneraient à être posés et instruits en fonction d'une approche pragmatique.
L'idée même de rationalité pourrait être repensée. Plusieurs auteurs ont vu dans la pragmatique le moyen technique nécessaire pour étayer une « transformation de la philosophie appelée par le renouvellement » de la théorie du langage. Qu'il s'agisse d'une philosophie de l'action, comme c'est le cas de la pragmatique praxéologique (Apostel, 1981), d'une philosophie du langage comme la pragmatique « rationaliste » de Kasher (1977), ou qu'il s'agisse de réinterpréter la philosophie de la connaissance dans le sens d'une pragmatique transcendantale (Apel, 1976), ou universelle (Habermas, 1982). Pour Apel, on doit « réfléchir sur les conditions de possibilité d'une connaissance formulée verbalement et virtuellement valide d'un point de vue intersubjectif ». Habermas, quant à lui, situe l'action communicative ou universelle parmi les autres types d'interaction sociale. La composante illocutoire actualise un jeu de rôles socialement institués. Tout comme Apel, il veut caractériser des formes essentiellement pacifiées du discours. C'est pourquoi il retient un arrière-plan normatif introduit de l'extérieur plutôt qu'il ne tente une analyse transcendantale de la communication par signes. L'attitude pragmatique de Jacques (1982) consiste à reconstruire le réseau des stratégies constitutives de la compétence communicative du sujet. Il s'agit aussi de faire place au dissentiment en face du consensus, qui sont entre eux dans un autre rapport que la norme de la « communauté idéale de communication » (Apel) et la discordance empirique dans les discussions réelles (Habermas). C'est la relation interlocutive qui est ici le fait fondateur. Parret (1980) retient, lui aussi, le fait relationnel parmi les axiomes de la communicabilité. Sa pragmatique stratégique veut être une analytique de la compétence discursive des sujets parlants. Plusieurs types de « stratégies » (que l'auteur préfère aux règles au sens chomskien) ont une valeur compétentielle, translinguistique et normative.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Francis JACQUES : professeur à l'université de Rennes
Classification
Autres références
-
ACQUISITION DE LA PRAGMATIQUE DU LANGAGE
- Écrit par Josie BERNICOT
- 1 255 mots
L’acquisition de la pragmatique du langage (S. Ervin-Tripp) correspond à l’acquisition des usages du langage considérés du point de vue cognitif, social et culturel. Les recherches sont réalisées dans le cadre théorique de la philosophie du langage. Tout énoncé est considéré comme un acte...
-
COGNITIVES SCIENCES
- Écrit par Daniel ANDLER
- 19 265 mots
- 4 médias
...syntaxique et sémantique, malgré leur caractère absolument central dans l'étude du langage, et choisissons notre deuxième exemple dans le domaine de la pragmatique. La question est ici celle de la compréhension d'un message dont l'analyse phonologique, syntaxique et sémantique est accomplie, fournissant... -
CROYANCE
- Écrit par Paul RICŒUR
- 11 990 mots
...concentre sur la valeur de vérité des énoncés. G. Frege en est le fondateur, avec sa distinction fameuse entre sens et référence (ou dénotation). Les énonciations relèvent de la pragmatique, dont une des tâches est de rendre compte des changements de sens et de référence des propositions en fonction... -
ÉNONCÉ, linguistique
- Écrit par Catherine FUCHS
- 1 329 mots
En linguistique, un énoncé peut être défini comme une séquence orale ou écrite résultant d'un acte d'énonciation, c'est-à-dire produite par un sujet énonciateur dans une situation donnée. En français, la phrase minimale comporte nécessairement au moins un sujet et un verbe conjugué....
-
GRAMMAIRES COGNITIVES
- Écrit par Catherine FUCHS
- 1 352 mots
Couvrant un champ plus vaste qui s'étend jusqu'à lapragmatique, la théorie proposée par G. Fauconnier (Espaces mentaux, 1984) vise à décrire la dynamique d'élaboration et d'altération des configurations cognitives (« espaces mentaux ») construites au fil du discours. Ainsi l'énoncé... - Afficher les 22 références
Voir aussi