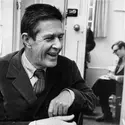PRATIQUE ET PRAXIS
Article modifié le
Pratique technique et pratique morale
En tant qu'il pense, c'est-à-dire parle de façon cohérente de ce qui est et le distingue de ce qui n'existe qu'en apparence, l'homme ne se réduit cependant pas au rôle d'objet. Il est également, et surtout, celui qui agit dans la pratique de la science : tout ce domaine est proprement le sien, parce qu'il le constitue et ainsi le connaît en agissant.
Le pragmatisme et le problème kantien du sens
Le pragmatisme, au nom significatif, en tire les conséquences : les spéculations des métaphysiciens, que ceux-ci soient dogmatiques ou critiques, sont dénuées de sens, étant donné qu'aucun prolongement concret n'est donné à leurs thèses, qu'on les accepte ou qu'on les nie ; qu'il n'y ait qu'un monde ou qu'il y en ait plusieurs n'importe pratiquement à personne, de même qu'il est parfaitement indifférent qu'une liberté de l'homme existe ou n'existe pas aussi longtemps que nous admettons que du nouveau, de l'inattendu apparaît dans nos vies. Une théorie désintéressée, si une telle théorie n'était pas un pur rêve, serait sans intérêt ; seul ce qui influe sur notre façon d'agir compte pour nous, et seul ce que nous pouvons soumettre à notre observation et à notre expérimentation, à notre praxis, est pour nous vrai ou faux ; le reste est dénué de sens. La science est véritablement science agissante, et l'action, à l'aide de cette science, la parfait, et se parfait, en un progrès de notre savoir et de notre puissance, auquel aucun terme ne peut être assigné et dont l'idée suffit à nous orienter dans notre pratique.
Un siècle avant les débuts du pragmatisme, Kant avait posé précisément la question du rapport entre la théorie pratique et l'orientation de l'homme. Selon lui, deux familles de théories se distinguent sur le plan de la science : une première, assez proche de ce que le pragmatisme entend sous le terme de théorie, forme un système de règles générales dont l'application dépend de circonstances que la théorie écarte et qui se révèlent seulement dans l'exécution, dans la pratique, de telle façon que le praticien, tout en profitant des efforts du théoricien, reste supérieur à celui-ci jusqu'à ce que la théorie ait rattrapé la pratique ; une seconde famille est formée par des sciences fondamentales dont celles du premier groupe ne sont que des applications qui doivent être comprises (par une logique « transcendantale ») dans leur « possibilité », c'est-à-dire dans leur prétention de donner une connaissance apodictique d'une réalité qui, au premier abord, se présente comme indépendante de l'esprit qui la saisit. Or une théorie d'une nature tout autre s'oppose aux deux : elle se propose de formuler et de résoudre le problème des fins. Aussi bien avec la première qu'avec la seconde espèce de théories, il s'agit, en effet, d'entreprises humaines, et, sous cet angle, aucune différence ne distingue la théorie du praticien de celle du théoricien des sciences fondamentales : lui aussi a choisi une fin à lui et aurait pu tout aussi bien se tourner vers d'autres buts. Un tel choix est-il arbitraire ou justifié ? En général, un choix peut-il être justifié ? comment ? par qui ? Certainement pas par la théorie scientifique, qui ne connaît que des relations de faits et ne saurait distinguer le préférable de ce qui ne l'est pas.
La question ainsi posée est celle du sens, celle-là même que le pragmatisme, confiant dans la marche du monde et de son progrès, ne sent pas le besoin de poser et à laquelle, à plus forte raison, il ne répond pas : nous poursuivons toujours certains buts, mais ces buts méritent-ils d'être poursuivis ? La réponse ne peut pas venir de la pratique observée ou observable, puisque celle-ci ne montre les choix que comme des faits, c'est-à-dire sans référence à cette justification qui est ici demandée : de ce qu'un homme agit d'une certaine façon, il ne découle nullement qu'il doive ou ne doive pas agir ainsi. Une autre théorie, une autre pratique se dessinent, une théorie de ce qui doit être réalisé par les hommes, une pratique qui n'influe en rien sur la théorie, mais ne sera que la réalisation d'un but fixé par cette théorie contre laquelle aucune invocation de l'expérience psychologique ou historique ne saurait prévaloir. La plus ordinaire observation montre que la morale, la volonté de l'universel, de l'humanité de l'homme, d'une vie de liberté responsable ne règne pas en ce monde ; cela ne prouve d'aucune manière que la morale ne doive pas dominer. Il y a une théorie vraie de la vie pratique, d'une pratique qui reprend son sens antique de décision à l'action, à l'action sensée.
Ce que Kant énonce (et annonce) ainsi n'est pas seulement un principe pour la direction de la vie morale de l'individu. Disciple reconnaissant de Rousseau, il admet que la vie de l'individu, si elle doit avoir sens et dignité, ne peut les trouver que dans une pratique de la vie tout entière et ne saurait donc consister dans le seul progrès des connaissances scientifiques, des techniques, de l'organisation sociale : la vie trouve son sens dans une attitude de libre détermination selon la raison et à la raison. Mais Kant ne suit plus Rousseau quand celui-ci ou bien sépare l'individu de la société présente, définitivement pourrie, ou bien n'oppose à l'état de choses présent qu'un idéal de communauté que lui-même déclare irréalisable. Il est vrai que la civilisation, comme le déclare Rousseau, apporte à l'humanité des souffrances que l'état de nature ignorait ; aux yeux de Kant, l'histoire n'est pourtant pas simple déchéance, au contraire : en son évolution morale, l'homme commence par le mal, il va vers le bien, et précisément l'époque présente, celle de la Révolution française, montre que l'humanité, conduite jusqu'ici par une nature qui voulait le développement des facultés de l'espèce, est parvenue au point où elle peut prendre en main son avenir et se déterminer à une marche consciente vers la réalisation d'un monde moral. La théorie morale, loin d'être pure théorie d'une pratique exigée, devient pratique en faisant agir les hommes. Le « royaume des fins », but absolu de la pratique humaine, ce royaume dans lequel le bonheur sera proportionné au mérite moral, ne sera jamais le royaume de ce monde ; mais c'est en ce monde, en l'histoire pratique, qu'il doit être cherché, et c'est là qu'il sera réalisé dans toute la mesure où la nature finie et indigente de l'homme permet son avènement, dans un progrès qui, tout en n'aboutissant jamais, n'en est pas moins progrès de l'humanité.
La pratique morale devient ainsi pratique historique, et son sujet n'est plus le seul individu, mais l'humanité. L'individu sera sans doute toujours ambilavent : violent en tant qu'animal indigent, raisonnable par ce qui l'élève, du moins en puissance, au-dessus de ses désirs vers ce qui, universel, fait de lui le représentant de l'humanité et le soumet, le fait se soumettre librement à la loi fondamentale qui exige que l'inspiration de ses actes puisse être celle de tout être raisonnable. Mais il n'accédera à cette conscience de la morale, qui est en même temps conscience morale, que dans une communauté qui est déjà informée par cette universalité extérieure qui a nom « loi ». Ce qui reste à faire, c'est que cette loi positive devienne elle-même raisonnable, qu'elle guide les hommes d'action, les princes, les gouvernements, vers le but d'une unité du genre humain telle que tous les rapports entre individus et États soient devenus clairs pour tous ceux qui veulent les penser, où la ruse, le mensonge, la violence, l'oppression aient disparu. Une paix perpétuelle installée, c'est-à-dire l'établissement d'un État mondial, pourrait signifier la pire des tyrannies, puisqu'un gouvernement mondial n'aurait plus à craindre la défection des citoyens et l'intervention étrangère : c'est néanmoins l'idée d'une telle paix qui seule peut légitimer l'action politique en lui prescrivant des méthodes qui, si elles ne peuvent pas conduire l'individu à une vie pleinement morale parce qu'elles lui sont imposées, du moins ne rendent pas sa moralisation humainement impossible.
De la conscience historique à la praxis marxiste
Le discours du philosophe agit en élevant à la conscience ce qui depuis toujours a été l'aspiration la plus profonde des hommes, aspiration que la nature lui a implantée et qui ainsi constitue sa vraie nature ; être libre, il peut sans doute toujours fausser cette nature mais, éduqué par des lois justes et instruit par le philosophe, il peut aussi toujours y retourner.
C'est ce passage de l'exigence passionnelle, à la conscience qui constitue pour Hegel, comme pour Kant, le principe de compréhensibilité de l'histoire et son moteur. Ce qui les sépare, c'est le rôle que Hegel reconnaît au travail et à la structure de la société, d'une part, à la passion, de l'autre : l'organisation (ou le manque d'organisation) du processus du travail social et objectivement socialisé constitue la base de l'action politique, laquelle, il est vrai, n'est pas déterminée par là, mais y trouve les limites de ses possibilités. L'homme aspire, en effet, à la liberté et à la dignité ; en d'autres termes, il veut être reconnu comme valeur absolue par tous et, surtout, par les institutions ; il veut que les exigences de la société et de l'État soient justifiées en raison de telle façon qu'il les puisse accueillir en sa conscience d'individu raisonnable. La morale théorique (la théorie morale) est donc vraie ; mais sa vérité est abstraite, « théorique » : c'est dans la pratique de la vie historique, dans la politique concrète que le problème posé par la théorie sera, sinon résolu, du moins traité par la société, par les décisions du gouvernement qui doivent limiter les risques de la lutte des intérêts dans la société, par les contacts entre gouvernants et gouvernés, par la pratique de ceux qui sont chargés, au nom de l'État et comme représentants de l'intérêt général, de l'administration des affaires. Leur pratique, qui est de tous les jours, révèle les problèmes concrets qui chaque jour se posent pratiquement.
Le niveau où vivent les individus est celui des intérêts : il faut en reconnaître aussi bien la légitimité que les limites dans lesquelles ils sont légitimes par rapport à l'intérêt commun. Il n'y a plus de place pour un « souverain bien », sinon sur le plan d'une religion qui n'a pas à intervenir (comme Église) dans les affaires de l'État et de la société : l'homme, ce qu'on appelle l'homme tout court, est réel dans la société, et ce n'est qu'à travers celle-ci qu'il prend part à la politique comme membre de ce corps social dont le gouvernement est l'âme. La philosophie, en tout cas, ne saurait prescrire des recettes aux acteurs ; elle peut comprendre ce qui est, même ce qui, dans ce qui est, est tension vers un avenir, c'est-à-dire refus du présent. Mais cet avenir ne sera pas créé par la réflexion ; il naîtra de la passion de la liberté et de la dignité, non de leur concept abstrait ; et il sera l'œuvre des penseurs pratiques, des praticiens pensant cette passion pour la servir en la rendant raisonnable et ainsi efficace. La philosophie arrive, tel l'oiseau de Minerve, à la tombée de la nuit ; son apparition montre qu'une époque est devenue compréhensible, qu'elle a entièrement développé son principe et qu'elle est close ; si son chant est par là aussi celui du coq qui annonce la levée d'un nouveau jour, ce n'est pas elle qui en détermine le cours. Ce qu'elle peut faire, c'est de permettre aux praticiens responsables de penser, à partir de son concept, de la structure qui la fait être ce qu'elle est, leur époque, avec ses contradictions, ses aspirations profondes, ses exigences sensées ou aberrantes.
C'est la passion qui forme le ressort de la théorie pratique (ou de la pratique théorique) de Marx. Hegel, lecteur des économistes classiques, avait bien vu que, par une nécessité inhérente à la forme de son travail et à la distribution du pouvoir économique, la société bourgeoise produit une masse humaine qui, indispensable à la marche du travail social, se voit privée de tous les avantages de cette société, matériels aussi bien que moraux, privée de ceux-ci parce que privée de ceux-là. La société capitaliste se caractérise ainsi par une contradiction intérieure qu'elle est incapable de surmonter. Marx part de cette analyse, mais refuse de croire à une solution qui recoure à la raison des capitalistes ou des gouvernements. Il serait vain d'en appeler, comme l'avaient fait les socialistes utopiques, à l'intelligence ou aux bons sentiments des détenteurs du pouvoir économique : une analyse scientifique du mécanisme social démontre que les actions des joueurs ne dépendent pas d'eux, mais de conditions objectives et que l'évolution sociale, à travers les crises de surproduction et de sous-emploi, conduit à une prolétarisation progressive en même temps qu'à une concentration toujours plus poussée du capital. Conséquences d'une concurrence sans cesse plus âpre, des crises économiques provoqueront la catastrophe, ou plutôt elles le feraient si le prolétariat, le seul groupe social qui n'en ait au-dessous de lui aucun autre qu'il pût vouloir exploiter, ne réussissait pas à prendre le pouvoir pour organiser rationnellement la production et la distribution. Il y parviendra sous la conduite d'un parti qui, parce qu'instruit par la nouvelle science de la société, élaborera en connaissance de cause une stratégie et une tactique également scientifiques.
Cette science ne constitue pas une théorie en opposition à une technique qui l'emploierait comme un savoir établi une fois pour toutes : à partir de son fondement, elle déterminera ce qui est facteur réel, et seulement effet et superstructure, dans la pratique de la lutte sociale, d'une lutte qui, à chaque moment, se référera à la science des lois générales de l'évolution sociale. Lénine, de manière plus tranchante que Marx, insistera sur le rôle des « révolutionnaires professionnels » qui, agissant en pensant, pensant à partir de l'action et des possibilités de la situation, incarnent cette conscience historique à laquelle le prolétariat, abandonné à sa spontanéité, ne parviendrait pas, à laquelle cependant le parti révolutionnaire le conduira, à condition de ne pas perdre le contact avec les masses laborieuses. La praxis est la théorie en acte, la théorie est la conscience que l'action prend de sa nature et de sa situation historique. La théorie ne se contente pas de comprendre le monde, comme c'était le cas de la philosophie de Hegel, elle veut le transformer, comme elle devait le faire aux yeux de Kant, avec cette différence que le sujet de l'action (action sur soi-même comme sur le monde) n'est plus l'individu moral ni l'espèce, mais le groupe objectivement sans intérêt particulier et ainsi appelé à réaliser l'universalité.
Les discussions au sujet de la pratique et de la praxis sont assez déroutantes parce que les fronts ne sont pas nettement tracés : quand on parle, par exemple, de l'opposition entre physique théorique, physique expérimentale et technique, l'accord se fait assez facilement, puisque tout le monde admet, du moins implicitement, une interprétation (d'inspiration kantienne) qui unit les éléments pragmatiques à des facteurs théoriques et qui, en ce sens, est dialectique. Une analyse poussée pourrait montrer qu'il n'en est pas autrement en ce qui concerne l'interprétation de la pratique politique. Mais ici, une certaine confusion naît du fait que le caractère de science fondamentale auquel prétendent les théories d'inspiration marxiste est contesté par leurs critiques, tandis que le caractère scientifique de la physique est universellement reconnu, quoiqu'il soit diversement interprété. Aussi ces critiques voient-ils dans la théorie le simple camouflage d'une politique purement pragmatique, sans véritable lien avec cette prétendue science dont seuls les principes premiers, c'est-à-dire ses exigences humanitaires, pourraient être vrais, mais d'une vérité philosophique, non scientifique, et incapables par conséquent de guider l'action positivement ; eux-mêmes élaborent des programmes qui ne se réclament pas d'une science universelle et se fondent sur des valeurs qu'ils considèrent comme dernières (politique chrétienne, traditionaliste, etc.). La sociologie moderne, il est vrai, tend, elle aussi, vers une connaissance scientifique des faits sociaux, des facteurs, des relations dont la connaissance peut être utile, voire indispensable au succès de tout projet ; mais, comme elle se veut neutre en éliminant les valeurs, c'est-à-dire les directives, pour la praxis, elle abandonne (comme la physique, mais en oubliant que, en opposition à celle-ci, elle a affaire aux hommes) ce qu'elle découvre aux praticiens, lesquels se situent d'ordinaire du côté du pragmatisme positiviste et poursuivent des buts appelés « évidents ».
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Éric WEIL : professeur à l'université de Nice
Classification
Autres références
-
ALTHUSSER LOUIS (1918-1990)
- Écrit par Saül KARSZ et François MATHERON
- 4 571 mots
...partis communistes européens, l'émergence d'aspirations politiques nouvelles). Et parce que, en même temps, il travaille ces disciplines et ces expériences en y mettant Marx à l'épreuve, en l'y investissant, Althusser reprend à son compte ce qu'on appelle classiquement le rapport « théorie/ pratique ». -
ARISTOTE (env. 385-322 av. J.-C.)
- Écrit par Pierre AUBENQUE
- 23 793 mots
- 2 médias
Aristote distingue entre lapraxis, qui est l'action immanente n'ayant d'autre fin que le perfectionnement de l'agent, et la poièsis, c'est-à-dire, au sens le plus large, la production d'une œuvre extérieure à l'agent. Cette distinction apparemment claire fonde la distinction entre... -
DÉVIATIONNISME
- Écrit par Jacques ELLUL
- 555 mots
Lors de la critique par Kautsky de la théorie de Bernstein était apparu le concept d'opportunisme, qui allait être largement élucidé par Lénine. Celui de déviationnisme fut introduit un peu plus tard, lorsque la théorie du centralisme démocratique dans les partis communistes se...
-
ESTHÉTIQUE - L'expérience esthétique
- Écrit par Daniel CHARLES
- 5 085 mots
- 2 médias
Et comment s'y prend-elle ? En recourant à unepraxis bien précise, celle de « la première chaîne de montage » qui s'amorce avec la division du travail temporel entre les Parques. Comment ne pas songer ici à ce penseur de la praxis qu'était Ernst Bloch, et à sa théorie du montage... - Afficher les 16 références
Voir aussi